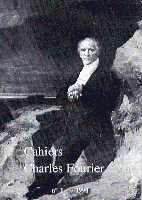
Alphonse Toussenel (1803-1885) occupe une place tristement célèbre dans l’histoire de l’antisémitisme en France. Rappelons qu’en rédigeant La France juive (1886) Edouard Drumont a voulu rivaliser avec son illustre prédécesseur, auteur des Juifs rois de l’époque (1847) : « Ma seule ambition, je l’avoue, après de longues années de labeur littéraire, serait que mon livre pût prendre place auprès du sien dans la bibliothèque de ceux qui voudront se rendre compte des causes qui ont précipité dans la ruine et dans la honte notre glorieux et cher pays [1]. » Toutefois mon but principal ici n’est pas de revenir sur la question de l’antisémitisme de Toussenel, mais d’éclairer un autre aspect de sa pensée : sa vision du rôle dévolu à la femme. J’étudierai surtout les deux ouvrages d’histoire naturelle : L’Esprit des bêtes. Zoologie passionnelle (1847) et Le Monde des oiseaux. Ornithologie passionnelle (1853-1855) [2]. Ces deux textes ne méritent nullement l’oubli dans lequel ils sont tombés. Cette zoologie passionnelle est tout le contraire d’une étude sèche et rebutante. Toussenel écrit avec verve, avec brio, avec audace. L’imagination reprend ses droits pour nous révéler l’unité mystérieuse du monde [3]. Toussenel pose avec force le problème du rôle et du destin de la femme, mais il le fait dans le contexte d’une réflexion sur le monde animal. Nous avons affaire non seulement à la femme rédemptrice chère aux romantiques, mais à un corps inséré dans l’histoire et dans la nature [4]. Le cas de Toussenel illustre la mise en place d’une série d’oppositions : masculin/féminin, nature/société, harmonie/civilisation. Son rêve est de concilier les extrêmes, d’accorder à la femme le rôle supérieur qui lui est dû mais qui lui est refusé par un monde hypocrite, organisé par le pouvoir masculin. Le triomphe de la femme marquera la victoire du beau, de l’harmonieux, du désir. Ce sera la fin du mensonge. Jusqu’à présent la femme a été prise dans le discours masculin qui la définissait comme impure, inférieure, coupable. En s’émancipant elle transformera la société. Cependant, au lieu de s’ouvrir sur la transparence et la communauté rêvée, la loi nouvelle appelle de nouvelles exclusions - et surtout celle du Juif. L’harmonie s’accommode ainsi de l’idée de normativité. Le cas de Toussenel révèle comment la vision progressiste de la réhabilitation de la femme peut devenir discours de vérité, intolérant et brutal. Désormais la femme réclamera la soumission de l’homme ; ce sera une soumission légitime, consentie - mais somme toute restreinte. L’important du reste est ailleurs. A ce couple, à cette alliance qui fonde l’unité et l’ordre nouveau il faut son Autre. Et cet Autre sera le Juif, celui qui est hors du vrai.
Les idées de Toussenel procèdent directement des théories de Fourier, dont il partage la critique de la civilisation et l’analyse de l’histoire. Il partage surtout sa vision du monde naturel conçu comme un réseau de correspondances, d’analogies. Cette interprétation de la nature, cette « zoologie passionnelle », fournit le sens de l’idée fouriériste de l’homme et définit la nature de la lutte qu’il veut entreprendre contre le commerce, le capital et la « féodalité financière ». La rationalité règne dans la nature, mais c’est une rationalité qui ressemble à la déraison aux yeux de ceux qui se disent civilisés. Le ressort de la vie c’est le désir. La matière est le principe passif ; elle est mise en mouvement par l’amour. Croire en l’amour, c’est libérer des possibilités et aider l’humanité à progresser vers l’harmonie. L’amour est le principe unificateur du cosmos : « Une seule loi régit l’univers : l’Amour. L’Amour est le moteur divin, irrésistible, qui attire la Terre vers le Soleil, l’amant vers sa maîtresse, la sève vers l’extrémité des rameaux, la molécule métallique soi-disant insensible vers la molécule de même nature [5]. » Que l’homme se libère de l’idée d’un dieu distributeur de récompenses et de punitions : « Dieu nous a mis au monde pour aimer et jouir ; aimons, soyons heureux pour faire plaisir à Dieu [6]. » A l’instar de Fourier, Toussenel dénonce la fausse morale, celle qui réprime les passions, celle qui est responsable des guerres, de l’oppression, de la servitude. Il développe également le côté extravagant de la pensée de son maître : les arômes planétaires, la sexualité stellaire, les analogies. L’analogie fournit une explication générale de l’univers, révèle l’unité du monde. L’humain n’est pas séparé du naturel. Au contraire : les bêtes, les fleurs, les minéraux sont autant de « moules divers pétris par la puissance créatrice des Planètes, pour représenter la passion humaine [7] ». Les créatures inférieures sont en réalité le miroir de nos passions : « la bête n’est qu’une fraction passionnelle de l’être supérieur appelé homme [8]. » Tout se tient et tout a un sens, et ce, malgré des effets en apparence contradictoires. Tout est lié : les passions de l’homme et la vie des planètes, les sons et les couleurs. La perception humaine, limitée par le temps, ne peut que difficilement embrasser la totalité des choses : « L’homme est de toute éternité dans la pensée de Dieu, comme tous les autres jalons de la série universelle des êtres, et du moment que Dieu le pense, IL EST. Et le moule inférieur annonce le supérieur créé ou à créer ; et le supérieur résume et contient tous les inférieurs [9]. » C’est ainsi que si Toussenel ne croit pas en un Dieu personnel intervenant dans sa création, il reste convaincu de l’action providentielle et de la présence d’un principe supérieur qui s’actualise dans le temps et dans l’espace. Un ordre sous-jacent sous-tend et gouverne le mouvement cosmique dont le but est la réalisation de l’harmonie. Le monde moral est impliqué dans le monde physique - tel est le présupposé de la théorie des animaux emblèmes des passions humaines. Et en dernière analyse, tout repose sur la loi des nombres, mais les nombres eux-mêmes possèdent des « propriétés passionnelles » [10]. La vie ressemble à une poursuite amoureuse. Une force désirante traverse le cosmos, force que Toussenel identifie à l’électricité :
« Toute substance pénétrable par l’électricité est susceptible d’aimer et de sentir, et tous les corps sont pénétrables par l’électricité, qui joue dans la nature le rôle d’agent universel d’attraction, de vie et de fécondité. [...] L’électricité opère sur tous les corps en leur donnant un sexe, c’est-à-dire en les dédoublant, de façon à ce que chacune des deux parties disjointes éprouve un désir furieux de rejoindre l’autre. Aimer, c’est être électrisé ; c’est sentir qu’on est dédoublé et éprouver le besoin de se recompléter. L’homme et la femme, qui sont deux sur la terre, ne sont qu’un dans l’autre vie, je veux dire la vie aromale, et c’est même pour cela que le nombre des femmes est égal à celui des hommes sur la surface de tous les globes. L’électricité prêche d’exemple, et la poursuite acharnée que se font ses deux sexes est la cause de toutes les grandes crises de la nature, y compris la reproduction des êtres et leur développement. Les typhons, les ouragans, les tremblements de terre ne sont pas autre chose que des explosions de fluide électrique, c’est-à-dire d’amour comprimé. L’éclair est le baiser des nuages, orageux mais fécond [11]. »
Il fallait laisser ce passage se déployer pour saisir comment Toussenel valorise l’amour comme source du sens et origine du mouvement universel. Des affinités secrètes existent entre les différents corps qui constituent le monde phénoménal. Toussenel fait de la zoologie passionnelle l’expression des grandes vérités fondamentales. Il suit Fourier en ce qu’il fait de la circulation des énergies passionnelles la clef de sa démonstration. Il croit à l’universalité de son schéma. La femme est un objet de désir à qui « Dieu n’a donné le charme et le don de séduire que pour maintenir l’homme en puissance de passion » [12]. Mais la femme reste un être mystérieux : « La science n’a jamais pu calculer, même approximativement, la puissance de fascination qui se condense quelquefois en un simple regard de femme [13]. » A la manière de Fourier, Toussenel souligne l’importance de la liberté dans l’amour ; la passion est sainte puisqu’elle vient de Dieu. Mais les habitants de ce monde hypocrite trouvent difficile d’admettre que « la liberté d’amour, que la liberté du choix est la première condition de la dignité de la femme et du bonheur de l’homme » [14]. Toutefois, Toussenel ne développe pas le discours sur la sexualité de la même façon que son maître. S’il critique fortement l’institution du mariage, il ne prône pas pour autant la liberté sexuelle, du moins pas comme Fourier l’envisageait dans le Nouveau monde amoureux. Pour Toussenel, comme pour Considerant, la théorie des passions reste généralement plus circonscrite et vient s’intégrer à une vision de l’organisation sociale qui ne débouche pas véritablement sur la libération du désir. Cependant Toussenel partage sans hésitation les idées majeures de Fourier sur l’importance de l’affranchissement de la femme. Toussenel cite la page de la Théorie des quatre mouvements où Fourier observe que « les progrès sociaux et changements de périodes s’opèrent en raison des progrès des femmes vers la liberté [15] ». Toussenel précise que ce qu’il appelle la formule du gerfaut en est la traduction : « Le bonheur des individus et le rang des espèces sont en raison directe de l’autorité féminine... [16]. » Le principe féminin incarne le progrès et s’oppose à l’ordre mâle, celui de la guerre et du pouvoir répressif. Les études d’ornithologie passionnelle renferment des longues discussions sur les différentes espèces, mais le savoir que Toussenel déploie - et auquel se joignent des souvenirs personnels, des réflexions philosophiques, des commentaires politiques - reste en fin de compte un prétexte. A travers la vie des oiseaux, l’auteur vise autre chose. L’ornithologie porte témoignage de l’actualisation d’une série de rapports entre les sexes ; la mise en place de ce système de relations permet de rendre compte de l’organisation du champ social. Ce sont les virtualités de la société idéale qui nous sont présentées, ou plutôt qui affleurent avec une charge poétique dans ces textes injustement négligés. (On voit mal Toussenel produire un texte plat du genre « visite au phalanstère »). Les forces libératrices, nécessaires à l’homme, sont à l’œuvre dans la nature. Choisir d’écrire sur la nature n’équivaut nullement à un refus de la société. Les passions humaines, on l’a vu, se retrouvent dans la nature, sont inscrites dans des créatures qui sont à la fois des formations du désir et la manifestation d’une subjectivité transcendentale, divine. Toussenel ne se dérobe pas, ne s’avance pas masqué. Dès l’avertissement à son Ornithologie passionnelle, il prévient le lecteur que le monde des oiseaux n’est que « le sujet accessoire » de son livre, tandis que « le monde des hommes en est le sujet principal [17] ». L’oiseau représente l’aspiration à l’amour, à la liberté, à une société meilleure : « L’amour est facile aux oiseaux, car il n’y a parmi eux ni moins beaux, ni moins riches ; c’est comme chez les hommes en période d’harmonie [18]. » L’oiseau devient l’emblème de l’amour : « La vie de l’oiseau n’est qu’un épithalame. L’oiseau n’existe que pour aimer [19]. » L’amour tel qu’il est figuré par l’oiseau se présente comme un accomplissement qui permet le passage à un ordre nouveau : « C’est le monde des oiseaux qui offre à l’observation du philosophe les plus nombreux et les plus ravissants exemples de l’ordre dans la liberté amoureuse, de la fidélité conjugale et du dévouement maternel [20]. » Pour Toussenel - et Michelet le suivra dans bien des pages de L’Oiseau - c’est le rôle de la femelle qui est essentiel, dans la construction du nid, dans l’incubation. La liberté dans l’amour ne semble donc pas conduire à la licence. Chez les oiseaux, Toussenel découvre la vertu, la charité et le dévouement. Certes il y a des exceptions : le coq est tapageur et mauvais coucheur, un Lovelace de bas lieu. Le faisan est polygame. Et chez le faisan doré Toussenel découvre une histoire de violences sexuelles, de viol et d’infanticide :
« Le coq, dans cette espèce, est [...] le plus grand ennemi de la famille qui existe. J’en ai vu qui, après avoir assassiné de sang-froid douze à quinze faisandeaux en moins d’une demi-heure, n’avaient pas honte de réclamer de la propre mère des victimes le prix de leur forfait. Que des mères qui ont subi de pareils assauts redoutent de s’exposer à la récidive, on le comprend sans peine ; on conçoit même que la folie s’empare d’elles à la suite de tels accidents, et que cette folie les porte à renoncer pour toujours aux joies de la maternité et à changer de sexe [21]. »
Dans son étude sur les oiseaux, Toussenel oppose l’orgigamie à la monogamie. L’orgigamie est un monde de luxure et d’impudicité, un monde où le mal domine, « un monde de juiverie, d’avarice et de turpitude omnimode » [22]. La femelle y est l’esclave du mâle. Le contraste entre orgigamie et monogamie est lourd de sens : « Là-bas sur le fumier, sur les eaux, dans la vase, sensualité grossière, voix discordantes, incapacité artistique. Ici sous la feuillée, au bord des toits, aux versants des collines, voix mélodieuses, nids d’amour, génie et liberté [23]. » La monogamie semble donc être l’expression véritable de la formule du gerfaut. Et grâce à l’analogie, Toussenel propose de nombreux rapprochements entre les oiseaux et les hommes, comme en témoigne ce développement consacré au coucou :
« Le coucou est l’emblème trop fidèle des fainéants qui sont incapables de tout travail et de toute industrie par eux-mêmes, et que la loi de la nature condamnerait à mourir de faim, si le travail n’était pas condamné à nourrir la paresse. Le rouge-gorge et le proyer, qui élèvent le jeune coucou au détriment de leur propre famille, symbolisent les pauvres jeunes filles des champs qui sont obligées de refuser aux fruits de leurs entrailles le lait de leur mamelles, pour le vendre aux enfants des riches étrangères. La femelle du coucou, c’est la femme incomplète qui méprise les joies de la maternité et n’accepte l’amour que sous bénéfice d’inventaire [24]. »
Dans le second tome du Monde des oiseaux, Toussenel revient au coucou. Cette fois l’oiseau est présenté un peu différemment, comme incarnation d’une sexualité débridée et irresponsable :
« Cette femelle odieuse du Coucou, cette impudique Messaline qui change d’amant tous les trois jours et n’a pas le temps de s’occuper de sa progéniture, ressemble à s’y méprendre à ces dames de haut parage que l’ardeur du plaisir entraîne à l’oubli des plus saints devoirs [...]. Il n’y a pas plus d’amour des parents aux petits, chez les Coucous, qu’il n’y en a eu du père à la mère. Ce coureur et cette coureuse se sont rencontrés par un beau matin de printemps dans le sein de quelque orgie furibonde, où le mâle a eu sa part des faveurs de la Messaline. Un œuf est né de cette union fugitive, appartenant à Dieu sait qui [25]. »
Pourquoi donc l’opinion publique est-elle indulgente à l’égard du coucou, c’est à dire à l’égard du séducteur qui déshonore les maris et sème la discorde dans les ménages ? Pour Toussenel, comme pour Fourier, la réponse se trouve dans le fait qu’en civilisation, l’adultère représente une protestation contre le mariage sans amour :
« Il n’y a qu’une union légitime aux yeux de Dieu, celle où l’union des âmes précède celle des corps. Dieu réprouve toutes les autres, notamment les traités infâmes, dits mariages de raison par antiphrase ou mariages d’argent, et l’adultère est le grand Justicier des crimes de lèse-amour. Car c’est vainement que les vieux, qui depuis que le monde est monde tiennent en main le pouvoir, la richesse et les clefs des saints tabernacles, c’est en vain, dis-je, que les vieux se sont fait octroyer partout, par leurs dieux complaisants, le privilège de posséder autant de femmes qu’ils en pourraient nourrir. La nature n’a jamais ratifié ces saintes impostures. La nature, dont la mission suprême est de veiller au triage des types reproducteurs des espèces, ne pouvait, en effet, favorablement accueillir ces prétentions scandaleuses des perclus et des impotents à l’accaparement exclusif du droit de paternité et d’amour [26]. »
Dans la société moderne, la femme reste l’esclave de l’homme et attend toujours son émancipation. Dans Les Juifs rois de l’époque, Toussenel se réfère à l’étude célèbre de Parent-Duchâtelet sur la prostitution. Il dénonce l’exploitation sexuelle de l’enfant en Angleterre : « Le viol des enfants de dix à douze ans est tarifé à Londres [27]. » La lecture de Dickens est d’ailleurs conseillée à ceux qui voudraient connaître plus en détail la dure réalité de la vie des prolétaires anglais. En Angleterre, le taux d’infanticide est élevé : « Beaucoup de mères [...] allaitent leurs enfants avec du laudanum, pour se débarrasser de leurs caresses importunes [28]. » Mais partout dans le monde moderne, industriel et capitaliste, c’est la femme qui souffre, la femme qui est opprimée. Le mariage est synonyme de misère morale. Toussenel dénonce ces « marchés infâmes où des mères sans cœur vendent la chair de leurs filles à des vieux, pour un peu d’or ou pour des titres ; unions illégitimes, s’il en fut, aux yeux de Dieu, car Dieu ne consacre que celles dont l’amour est le lien » [29]. N’est-ce pas justement la société, la loi masculine, qui rend la femme parfois perfide : « S’il y a des femmes perfides et qui mentent pour mentir et sans y être forcées, soyez bien sûrs que c’est l’injustice de l’homme et l’habitude de l’esclavage qui les ont dénaturées ainsi [30]. » Négation de l’ordre de la nature, le mariage se situe au centre d’une logique sociale mâle qui se moque du potentiel féminin. Dans son désespoir, l’épouse cherche à se libérer des entraves du mariage par le crime :
« Le crime d’empoisonnement sur la personne des maris est devenu si commun depuis quelques années, que les jurés le tolèrent, et que les journaux judiciaires n’en veulent plus. Je ne sais guère de cour d’assises, en effet, qui n’ait, bon an mal an, son empoisonnement conjugal à juger ; ce qui n’empêche pas les moralistes de soutenir que le mariage est la base de la société actuelle et le foyer de toutes les vertus. Pauvre société ! [31] »
Dans la société contemporaine, la femme n’est pas seulement défendue d’accès à la vie publique. Elle reste surtout une victime. Exclue, condamnée par une morale hypocrite si elle exprime des vélléités d’indépendance, elle souffre dans son corps, dans sa chair. Le droit du seigneur n’a peut-être pas existé au Moyen Age, mais il existe bien au dix-neuvième siècle :
« Les chefs d’industrie, les hauts barons de la féodalité nouvelle n’attendent pas même le jour des noces, pas même le jour de la nubilité, pour prélever sur leurs vassales un infamant tribut. Je sais que l’emploi accordé dans l’atelier au père, à la mère ou au frère n’est, la moitié du temps, que le prix des complaisances de la fille ou de la sœur. Les mineurs de l’Angleterre se plaignent que leurs chefs d’atelier les volent sur leurs salaires et sur leur nourriture, et qu’en outre leurs femmes et leurs filles sont forcées de se prostituer à ces maîtres exigeants, pour qu’ils continuent leur bienveillance aux maris et aux pères [32]. »
La société industrielle est fondée sur l’exploitation du prolétaire et de la femme. Cependant, sur le plan historique, l’époque actuelle n’est pas dénuée de sens. L’histoire se dirige vers un monde meilleur. Selon Toussenel, le temps présent est « la période mystérieuse et sombre d’incubation de l’harmonie future » [33]. Dans l’ordre nouveau, la nature ne s’opposera pas à la culture, en ce sens que la femme, représentation d’une naturalité nécessaire mais absente, sera placée au centre de l’organisation sociale : « Le progrès de la raison ne se reconnaît qu’à un signe, qui est l’extension des droits et des liberté de la femme [34]. » La nature nous éclaire sur la transformation sociale qui s’annonce imminente. Les oiseaux sont les précurseurs et les révélateurs de l’Harmonie. L’ornithologie - comme d’ailleurs toute zoologie passionnelle - aboutit à une valorisation du principe féminin. Elle met en lumière le rôle directeur de la femelle, « l’être producteur et travailleur par excellence » [35]. De cette valorisation de la femelle, Toussenel tire une conclusion d’une portée générale : « La femelle est le lien de sociabilité dans toutes les espèces [36]. » L’action du principe féminin s’étend à l’univers tout entier. Rien d’étonnant donc si Toussenel cherche à établir un système de classification ornithologique en mesure de tenir compte de ce facteur essentiel qu’ est l’autorité féminine. Il s’élève contre tous les savants qui jugent la femelle inférieure au mâle. Geoffroy Saint-Hilaire lui-même se trompa sur ce point lorsqu’il envisagea la femelle comme « le résultat d’un temps d’arrêt dans le développement du mâle » [37]. (Selon Toussenel, le grand naturaliste avait été induit en erreur par la lecture de Lhomond.) De son observation des oiseaux, Toussenel dégage la loi fondamentale de l’univers social : « Le bonheur des individus est en raison directe de l’autorité féminine et inverse de l’autorité masculine [38]. » La femme semble plus humaine que l’homme. Les animaux la respectent, elle a pour tâche de renouer avec le monde animal et en même temps de refaire, de parfaire l’homme : « Nous croyons à la supériorité de l’essence féminine, parce que cette supériorité nous frappe comme elle frappe les bêtes ; parce que c’est la femme qui porte plus particulièrement le caractère du genre humain [39]. » Pas question, évidemment, d’accepter l’idée traditionnelle de la Chute et d’en accabler la femme. La chute de l’homme fut en réalité la conséquence d’un bouleversement des conditions climatologiques du globe : « La chute de l’homme n’a été que le contre-coup de celle de la couronne boréale. La femme n’a été pour rien dans le désastre [40]. » La détérioration du climat amena la misère, ce qui fut à l’origine de la propriété privée, de la guerre et de l’asservissement de la femme :
« Les hommes, qui ne voulaient pas s’astreindre aux dures conditions du travail et qui se voyaient plus forts que les femmes, commencèrent par asservir celles-ci, et l’esclavage commença sur la Terre. Et comme les tyrans ne manquent jamais de bonnes raisons pour justifier leurs méfaits, ils mirent le malheur de la Chute sur le compte de la femme et la firent maudire par leurs dieux. Des Dieux faits à l’image de l’homme sont toujours de compte à demi avec les bourreaux pour calomnier les victimes, et toujours prêts à couvrir du manteau de l’inviolabilité la sainte paresse des habiles. Ce qui n’empêche pas de déclarer que, puisque la chute de l’humanité a commencé par l’asservissement de la femme, l’humanité ne se relèvera que par la complète émancipation de celle-ci [41]. »
Une fonction rédemptrice reste donc malgré tout dévolue à la femme innocentée de la chute et du péché. Reste à savoir les modalités de son action. Doit-elle choisir la révolte afin d’en finir avec sa marginalité politique ? Doit-elle choisir la liberté sexuelle et l’invention d’une morale nouvelle ? Pour Toussenel, la femme reste avant tout épouse, mère, institutrice. Objet de désir, la femme incarne néanmoins l’ordre et l’harmonie à venir, le travail, la pudeur. La femelle de l’oiseau représente un amour librement consenti, mais un amour pur qui débouche sur le sentiment de solidarité. Cependant la lumière de la pureté et la chaleur de la vie sont parfois difficilement conciliables. La femme est double. L’amour sollicite le mouvement et le jeu de la séduction ; le libre essor des passions conteste l’ordre établi et remet en question les normes. Force est de constater que la chatte est, elle aussi, emblème d’amour : « Une bête qui fait de la nuit le jour, et qui scandalise les honnêtes gens du bruit de ses orgies amoureuses, n’a jamais pu avoir qu’une seule analogie au monde, et cette analogie-là est du genre féminin [42]. » Autrement dit, il existe « des natures féminines d’exception, des Messaline, des Cléopâtre, des bacchantes, qui foulent au pieds la pudeur et toutes les vertus de leur sexe » [43]. La chatte, c’est Manon Lescaut, c’est la sexualité féminine qui se révolte contre les lois de la civilisation de l’homme. La chatte est « la bête noire du moineau franc, emblème des ardentes et fidèles amours », elle est « en relation de sympathie avec l’asperge, emblème parlant de corruption et de vénalité » [44]. La femme-chatte durera autant que règnera la civilisation : « La société civilisée ne peut pas plus se passer de la chatte que de la prostitution, affreux vampire qu’elle nourrit du plus pur de son sang et de sa chair, et dont elle n’ose se débarrasser dans la crainte d’un mal pire [45]. » Cette vision de la femme, créature de la nuit, infatigable au plaisir, fascine Toussenel. Il rappelle que l’amour est une passion de luxe qui exige pour son libre essor insouciance et richesse. Il souligne le rôle des courtisanes dans la culture occidentale. Comment concilier les deux faces de la femme ? L’analogiste passionnel s’en tire avec une pirouette :
« Parce que je reconnais la puissance de fascination dévolue à ces êtres [les courtisanes], je conçois et j’excuse la sympathie des gens de goût pour la bête au menton rose, aux caresses perfides, au langage insinuant. Je conçois et j’excuse les amours furibondes des Antoine pour les Cléopâtre ; mais je ne saurais céder à l’entraînement général, car, il m’en coûte de le dire, la passion des chats est un vice, un vice de gens d’esprit, c’est vrai, mais de gens d’esprit dégoûtés [46]. »
Dans une certaine mesure, c’est la philosophie fouriériste de l’histoire qui tire Toussenel de son embarras. Ne confondons pas amour dans une société limbique avec les rapports entre les sexes tels qu’ils se développeront dans des phases ultérieures de l’histoire.Aucours d’une discussion des oiseaux granivores, Toussenel précise sa pensée :
« Le règne du mâle [...] est caractéristique des milieux subversifs, voués à l’oppression, au carnage et aux déchirements, où il est naturel que le droit reste à la force et que le Coq éperonné trône sur son fumier. Mais ne croupissons plus, grâces à Dieu, danscedomaineinfect.Nous venons d’émerger des sociétés limbiques, pour entrer en phase d’apogée. Ici tout vise à ladouceur, à l’urbanité, à la grâce, comme dans tout milieu où le sexe féminin domine. Le mâle y prend les allures de la femelle et aspire à la remplacer dans la plupart des fonctions maternelles [47]. »
L’analogie passionnelle suggère donc qu’avec le mouvement de l’histoire on s’acheminevers une société qui non seulement accordera une importance nouvelle à la femme, mais qui redéfinira en même temps le rôle de l’homme à l’intérieur de l’institution familiale. Mais la transformation de l’homme qui est envisagée va peut-être plus loin encore. Le principe féminin est le foyer de l’art, du chant, de la culture en général. La beauté grecque, tant admirée par Toussenel, est une beauté marquée par le féminin jusque dans les représentations du corps de l’homme : « Les types de beauté masculine les plus ambitieux de l’art grec n’osent pas porter la barbe [...] Cela est si vrai que ses Méléagre, ses Antinoüs, ses Apollon, ses Bacchus visent à l’hermaphrodite pour se rapprocher autant que possible du type féminin. Le plus beau de tous les Apollon antiques s’appelle l’Apolline [48]. » L’androgynie, entendue comme une féminisation du mâle, peut donc être valorisée positivement. Par contre, masculiniser la femme c’est agir contre la nature, c’est transgresser la loi en conférant au féminin une valeur fausse. Ici encore, Toussenel s’appuie sur l’ornithologie pour légitimer une déclaration d’une portée générale. Gare aux femmes qui veulent s’emparer des prérogatives des hommes dans les domaines de l’action physique et de la vie intellectuelle :
« Un monde où la femelle règne par la force du corps est un monde contre la nature qui ne peut durer, parce qu’il est assis sur l’oppression et le carnage. Du moment que vous ôtez à la femme sa grâce et sa toute puissante faiblesse et sa peur de voir souffrir, pour remplacer ces dons par la vigueur des muscles et l’insensibilité devant le meurtre ; du moment que vous lui retirez l’attrait pour la faire régner par la force, tout le charme de l’existence humaine est à l’instant perdu... Car l’amour d’où naît toute joie n’a été inventé que pour asservir le fort à la faible, et il n’a pas même de raison d’exister hors de là. [...] Pour que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes, il est de nécessité absolue que la femme seborne à régner dans la sphère du sentiment et de la poésie et laisse à l’homme le sceptre de la force, de la géométrie et de la raison pure [49]. »
L’homme est une créature de raison et de logique ; il court toujours le risque de tomber dans l’égoïsme, de s’affirmer par la force. La femme est une créature de sentiment, « et le sentiment associe au lieu que la logique divise » [50]. Elle est portée instinctivement vers la justice ; elle a horreur du sang versé. L’homme, raisonneur, tombe dans le scepticisme ; la femme, « en communion plus intime avec la nature, ne perd jamais l’idée de Dieu » [51]. Il existe entre la femme et tout ce qui vit une mystérieuse sympathie. En elle le beau physique s’allie au beau moral : « La forme de la femme a été créée pour l’expression la plus sublime de la beauté composée, beauté du corps et beauté de l’âme. Quand le beau moral manque à la femme, elle ne tarde pas à provoquer le dégoût. L’homme peut rester beau dans le vice à cause de la force, mais la femme devient hideuse par la flétrissure des traits [52]. »
Mais sous-tendant le discours de Toussenel se trouve une question plus grave : la remise en question non seulement de l’identité sexuelle de l’homme, mais de sa signification profonde. L’émancipation de la femme s’inscrit dans l’ordre des choses et semble être un signe avant-coureur de la fin de l’homme en tant que pouvoir et savoir. « Chaque création inférieure est un essai de la création supérieure, [...] l’oiseau annonce l’Homme, comme l’Homme annonce la Femme, comme la Femme annonce l’Ange [53]. » A quelle vérité donc nous éveille la femme ? Ce qui est sans doute primordial chez elle est le sentiment du lien social. Elle est chargée de réconcilier les extrêmes et d’annoncer l’avènement d’un ordre nouveau. Toute théorie politique qui ignore l’apport de la femme se solde par un échec. Toute institution qui ne tient pas compte des droits de la femme se condamne à long terme. Après tout, la politique est « la science du gouvernement des passions » et la science politique consiste à « ouvrir aux essors affectueux le champ le plus illimité » [54]. Plus prosaïquement, peut-être Toussenel constate-t-il que pour être fidèle à elle même, la démocratie doit accorder une place centrale à la femme : « La femme, qui n’est que sentiment, charité et justice, appartient par essence au parti de la jeunesse, du mouvement, du plaisir et de la liberté [55]. » Les révolutions échouent lorsqu’elles ne proclament pas l’égalité des femmes. Ce fut une erreur en 1789, et plus grave encore en 1848. Seul Victor Considerant « avait osé sommer ses collègues de restituer à la femme ses droits imprescriptibles de libre créature et d’inscrire l’égalité des deux sexes dans la Constitution » [56]. Mais cette proposition fut rejetée par une majorité d’hommes vieux. Le salut de la société repose sur la restauration du droit divin de la femme. Rappelons l’exemple des abeilles : « Elles ont adopté le Consulat maternel, ou la monarchie féminine et élective temporaire. Le souverain pouvoir, qui n’est pas une sinécure dans la ruche, s’y décerne à la plus belle, c’est-à-dire à la plus féconde [57]. » Déjà le principe féminin s’exerce à l’intérieur de la culture française. Toussenel s’élève contre Rome et la tradition latine qu’il accuse de mépriser la femme ; la littérature française puise son inspiration ailleurs, dans une tradition germanique de respect de la femme conçue comme un intermédiaire entre Dieu et l’homme. Dieu, nous confie Toussenel, « a livré le monde aux races de souche germanique qui honoraient la femme » [58]. La plus belle femme est certes de race blanche, et sans doute française.
Mais quel est au juste le rôle de la femme ? Toussenel la présente comme une figure inspiratrice, comme un valeur indispensable à la santé du collectif, nécessaire au redressement de la France. Elle aura certes les mêmes droits que l’homme, mais quelle est sa contribution, autre que symbolique, à la construction de la société idéale ? Le refus de la féodalité financière ne débouche pas vraiment sur un projet de société. Tout se passe comme si Toussenel reculait devant l’épreuve du réel. Son féminisme reste d’ordre théorique et général. Il écrit avec verve ; manipule avec une maîtrise évidente la terminologie et le jargon des disciples de Fourier, mais il nous laisse sur notre faim. Si la femme va jusqu’à empiéter sur le terrain du mâle, si elle s’en arroge les pouvoirs et les privilèges (la raison, la force), son acte équivaut plutôt à une usurpation, sinon à une chute. Son rôle est d’offrir la promesse d’une sorte de transcendance. Toussenel met en œuvre nombre de notions en vogue à l’époque romantique, dont le féminisme, mais ce qu’il souligne, malgré son adhésion à l’école sociétaire, c’est l’image de la femme-mère. C’est par ailleurs la femme qui « aura le monopole de l’éducation primaire » [59]. Cette autorité attribuée à la femme est plus proche de Michelet - ou de Comte, que Toussenel cite [60] - que de Fourier [61].
Insister sur les qualités nobles de la femme, c’est aussi insister sur sa différence. De même, les différences biologiques influent sur le moral : « L’idée d’amour ne correspond généralement chez le mâle qu’à un simple désir de bonheur individuel et passager, tandis que cette idée éveille inévitablement chez la femme celle de la maternité [62]. » Et si Toussenel place la femme au centre d’une aspiration à l’harmonie à retrouver, ou plutôt à refaire, n’oublions pas pour autant que cette unité se fait au prix d’une série d’exclusions, et surtout de celle du peuple juif. Dans l’ordre nouveau, le principe féminin est le fondement symbolique du lien religieux. Cette croyance - qui est aussi une revendication - repose sur un sentiment intime, mais tire sa légitimité de l’observation du monde naturel. Elle se veut conciliatrice : en rendant à la femme le rôle qui lui est dû, Toussenel nous invite à repenser les rapports entre les sexes. Mais pour arriver à cet heureux résultat, pour resacraliser l’espace social en le féminisant, il est nécessaire de s’émanciper de modes de pensée jugés désuets et dangereux. C’est, bien sûr, le monde masculin, porteur de laideur et de violence, qui est ici remis en question : la guerre, l’oppression, l’industrie moderne et la valeur centrale de l’argent.
Mais l’idée féminine qui structure le monde nouveau appelle sa négation. La nouvelle société sera construite sur les ruines du pouvoir patriarcal, de l’ordre mâle injuste et hypocrite qui fut à l’origine des religions qui asservissent les femmes. La première cible dans l’offensive de Toussenel est la religion juive [63]. Toussenel s’attaque aux capitalistes, aux industriels, aux commerçants, à tous les ennemis du prolétaire. Il s’en prend aux Anglais, aux Suisses, aux Hollandais, c’est-à-dire aux nations protestantes qui, selon lui contrôlent la finance internationale. Dans un sens, ce sont tous pour lui des Juifs. Toutefois, la haine de Toussenel vise bien le peuple juif lui-même ; pour s’en convaincre, il suffit de lire le chapitre intitulé « Le Vautour-Chaïlock » [64]. Promouvoir la femme, c’est s’attaquer directement au monothéisme de l’Ancien Testament, religion masculine : « Qu’est-ce que la religion de Moïse ? - Une religion qui pivote sur l’indignité de la femme, où notre première mère est représentée comme complice de Satan, où la Femme perd le Monde » [65]. La Bible dénature le rapport du fils à la mère : « La mère aime son enfant, l’homme n’aime que l’enfant d’une autre. C’est Abraham qui consentit à faire griller son fils, soi-disant pour être agréable au Dieu juif [...]. Jamais un Dieu humain n’aurait osé demander à une mère de brûler son enfant [66]. » Le Dieu de la Bible est un Dieu inhumain, ennemi du principe féminin. Les Dieux de la Grèce, par contre, étaient « plus femmes que celui de la Judée » [67]. Toussenel semble souhaiter un retour à la religion et à la culture de la Grèce [68]. Il évoque « le Panthéisme grec, cette religion adorable, qui compte parmi nous plus d’adeptes qu’on ne pense et notamment tous les esprits raffinés des deux sexes » [69]. Et cet esprit grec favorable à la femme - absent du polythéisme romain comme du monothéisme juif - est dit être présent en France grâce à la tradition héritée des Germains (les tenants du mythe aryen purent donc facilement intégrer l’antisémitisme de Toussenel). La religion juive est une imposture. L’Ancien Testament n’est qu’un assemblage d’erreurs et d’absurdités, un livre dangereux. Cependant le christianisme échappe à la condamnation du monothéisme juif dans la mesure où il contredit la religion juive et vise la réhabilitation de la femme : « Le vrai Dieu suscita [Jésus Christ] pour démolir la Bible [70] » ; Jésus a pour fonction de racheter la femme, l’esclave et le travailleur de leur dégradation [71]. Le Juif reste l’oisif, le vampire, le parasite. Pour Toussenel, c’est le Juif qui devient Satan. Il conclut que la France a besoin d’un état fort pour se défendre contre l’esprit juif, cosmopolite et subversif : une odeur infecte s’exhale « d’un corps social en puissance de juif, comme la France d’aujourd’hui [72] ». Zeev Sternhell a eu raison de souligner l’importance de Toussenel pour les mouvements antisémites de la fin du dix-neuvième siècle [73]. Il a déployé nombre de thèses et d’arguments qui, plus tard dans le siècle - et dans des conditions politiques, sociales et économiques différentes -, allaient devenir autrement mobilisateurs. Il était lu et approuvé, à droite comme à gauche, par les ennemis de la démocratie libérale. Cependant, l’antisémitisme ne reste qu’une composante d’une pensée qui vise à transformer le social, et dans laquelle tout se tient, cynégétique et considérations proto-écologiques, antisémitisme et féminisme.
