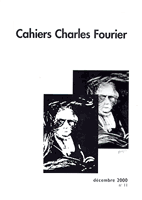
En quoi Fourier annonce-t-il Louis Blanc ? Quelle fut, par l’intermédiaire du second, la marque du premier en matière sociale sur les événements de 1848 ?
Je partirai d’un texte de chacun d’entre eux pour évaluer cette influence, la Théorie des Quatre Mouvements (1808) et l’Organisation du Travail (1840). En fait, une génération sépare les deux hommes, de même pour les écrits choisis : l’un parut alors que Louis Blanc n’était pas encore né (1811), l’autre quand Fourier était déjà mort (1837). Les idées de Fourier bougèrent-elles aussi vite dans ses livres que les circonstances et les mentalités au dehors ? Cette confrontation indirecte avec Louis Blanc entre 1840 et 1850 permet de poser la question, de remettre l’association industrielle au XIXe siècle en perspective.
1. L’association chez Fourier
« L’association qui est l’objet spécial de cet ouvrage »... « L’association qui est la base de toute économie », dit Fourier dans son premier livre [1]. Au départ, comment se présente chez lui ce concept ? Évolue-t-il de façon notable par la suite ?
En 1808, trois traits caractérisent l’association. Il s’agit d’abord d’un groupe humain plus que professionnel, à constituer suivant une formule d’allure scientifique. Le grand sujet de Fourier c’est la vie sociale qu’il nomme l’ordre sociétaire, c’est le bonheur collectif plutôt qu’individuel. En quoi il se démarque des Lumières et de 89 dans leurs principes comme de Napoléon dans sa pratique, cherchant plutôt à supprimer qu’à promouvoir les corps intermédiaires. À divers stades, Fourier s’élève contre « l’action individuelle qui est mensongère et discordante » et contre « la fausseté de tout individu hors de l’association progressive ». Dès le début, son livre traite de ce qu’il appelle les séries de groupes : « Je désigne par ces mots un assemblage de plusieurs groupes associés qui s’adonnent aux diverses branches d’une même industrie ou d’une même passion ». Dès cette époque pour lui l’association s’élève « au nombre d’environ mille personnes », plus tard davantage. « La nature distribue au hasard, sur 800 personnes, toutes les dispositions nécessaires pour exceller dans les fonctions sociales. En conséquence, un canton peuplé d’environ mille personnes trouve nécessairement sur ce nombre » [2]... J’arrête de citer, car la seule preuve que Fourier donnera jamais de son calcul et de son invention, c‘est ce nombre magique qui ne variera plus guère : rassembler deux représentants de chacun des 800 ou 810 caractères de base et l’association ainsi créée, comprenant toutes les variantes de la nature humaine, pourra idéalement fonctionner. Autre trait : il s’agit d’un groupe à vocation rurale. Fourier a beau parler sans cesse de mécanisme industriel, d’une part ce mot qu’il utilise au sens ancien inclut tous les secteurs d’activité et d’autre part le travail manufacturier ne représente jamais chez lui qu’un appoint. À preuve : rien que dans les quarante pages de son discours préliminaire, il utilise le mot association plus de vingt fois et, deux fois sur trois, couplé au mot agricole. Le terme répété de canton, tout comme la référence à la surface nécessaire pour mener à bien l’expérience confirment l’aspect champêtre de sa vision : « Hasardons sur une lieue carrée l’essai de l’association agricole » [3].
Dernier trait : le choix du mode de vie communautaire. L’association est une existence alternante et partagée non seulement dans le travail mais dans l’habitat, les fréquentations et les loisirs. S’agit-il pour autant d’une communauté intégrale ? Oui sans doute au niveau de ce qu’il nomme « l’économie domestique », qui nous retiendra peu ici, moins en ce qui concerne le problème des biens et des qualifications, qui nous intéresse davantage puisqu’il entraîne celui - au dire même de Fourier - le plus important de tous : « c’est celui de la rétribution proportionnelle aux trois facultés industrielles, c’est à dire la répartition du produit agricole et manufacturier d’une phalange, entre les sociétaires, selon la quotité de capitaux, lumières et travaux de chacun » [4]. Formule tripartite, résumant l’un des apports du fouriérisme en tant que théorie sociale.
Ces idées sur l’association évoluèrent-elles avec le temps ? Elles s’améliorèrent dans la forme plus qu’elles ne s’approfondirent sur le fond. Deux exemples dans chaque direction. Côté forme, la grande trouvaille ultérieure de Fourier fut le terme emblématique de phalanstère qui n’apparut que dans son second livre, l’Association domestique-agricole (1822). Dans le premier, il s’en tient au mot phalange qui apparaît plusieurs dizaines de fois. De même, l’issue de la rémunération du travail le préoccupe dès le départ, mais ce n’est que plus tard qu’il en fera une machine de guerre contre le salariat, mot qui ne figure pas, que je sache, dans les Quatre Mouvements. Dans ses ouvrages ultérieurs, la présentation se modifie un peu : « 1) Que chaque travailleur soit associé, rétribué par dividende et non pas salarié. 2) Que chacun soit rétribué en proportion des trois facultés : capital, travail et talent » (1822). « il faut fixer la répartition comme il suit : capital 4/12, travail 5/12, talent 3/12 (1829). Deux ans plus tard : « Passer du rang de salarié à celui de propriétaire ». Et en 1835, où il emploie davantage le mot ouvrier :« les peuples vingt fois régénérés et restaurés arrivent à un tel degré de misère qu’ils se soulèvent par insuffisance de salaire et inscrivent sur leur drapeau : vivre en travaillant ou mourir en combattant » [5]. Fourier se montre ainsi parfois ouvert sur l’actualité mais il a tendance à s’ancrer dans son vocabulaire et ses idées premières. En voici deux exemples. Il dérive sans cesse vers la gastronomie ou autres lubies dès qu’il veut analyser ce qu’il entend vraiment par industrie, mot resté vague pour lui alors que le phénomène se précise et évolue très vite au cours des trente années où il écrit. De même il regarde plus vers le passé que l’avenir quand il se livre au cours des quinze dernières années de sa vie à des querelles stériles et violentes envers tous ceux qui traitent de l’association, notamment les saint-simoniens et Owen. Voici quelques échantillons de cette polémique : « Les sectes de St-Simon et Owen, ignorant les méthodes de commerce véridique, ne peuvent avoir aucune notion exacte en progrès, car c’est dans l’industrie qu’il faut l’introduire. Il faut en associer les quatre fonctions, culture, ménage, manufacture et commerce, de manière à subordonner le commerce aux intérêts des trois autres... surtout dans l’agriculture qu’il dépouille de capitaux et qu’il entrave en tous sens ». Plus loin : « Quant aux deux sectes que je signale, on n’a rien à en espérer ; il se pourrait qu’une fraction des saint-simoniens reconnût la fausse voie de l’engagement de ses chefs, et se ralliât à l’idée de fonder la vraie association. Owen s’y refusera obstinément, c’est un orgueilleux incorrigible » [6]. Et autres passages du même style. À cause d’Owen, il veut abandonner son terme fétiche : « Il a donné à ce ramas de monstruosités le nom d’association, nom profané aujourd’hui... C’est maintenant un mot vide de sens ; je regrette de l’avoir employé dans mon traité et j’y substitue dès à présent celui de combinaison industrielle » [7]. Projet resté sans suite.
Ces querelles d’amour-propre affaiblissent la cause de l’association, au moment même où elle suscite un écho grandissant.
2. 1830-1840 : l’association s’infléchit
À partir de 1830, le thème de l’association prend un nouvel élan. De nouvelles orientations aussi. À l’intérieur et surtout à l’extérieur de l’école fouriériste. Plusieurs facteurs généraux entrent alors en jeu. Le changement de régime en France fut marqué, jusqu’aux lois de l’automne 1834 au moins, d’une grande liberté d’expression et d’un foisonnement de journaux, adresses et brochures. L’industrie se développe et les milieux ouvrier et petit- bourgeois, prenant davantage conscience de leur condition, explorent et essaient divers modes de regroupement de type mutualiste ou contestataire (révoltes lyonnaises de 1831 et 34, grèves de 1833 par exemple). Le terrain se prête donc à une mise en forme différente du thème de l’association, suivant des formules plus réservées par rapport aux vues « harmonistes » initiales, certains allant jusqu’à dénoncer l’ambiguïté de la notion.
Côté fouriériste d’abord, le maître n’innovant plus guère, ses disciples reprennent l’idée de salariat ou plutôt d’émancipation par le non-salariat, en une forme de participation directe au jeu et résultats de l’entreprise. Bénéficiant de l’essor de la presse et de l’écho trouvé par leurs thèses, ils s’expriment dans leurs propres périodiques, Le Phalanstère (1832 à 1834) auquel succédera La Phalange à partir de 1836. Un article d’Abel Transon résume assez bien leur position commune : « Dans une opération industrielle le mode de rétribution explique très clairement la condition des personnes auxquelles il s’applique. Ainsi, dans les entreprises ordinaires, la rétribution aux actionnaires est une répartition de dividendes, répartition soumise à des procédés réguliers de calcul, et qui se trouve conséquemment à l’abri de toute appréciation arbitraire. Il n’en est pas de même de la rétribution aux ouvriers. Celle-ci est une solde, un salaire qui ne se mesure point à la quotité de bénéfices généraux, mais que les entrepreneurs d’industrie déterminent à peu près à leur gré et d’après cet unique principe : avoir les meilleurs ouvriers au plus bas prix possible... La loi actuelle du salaire constitue pour l’humanité un véritable état de dégradation ; elle accuse dans les sociétés modernes un honteux oubli de toute dignité... Le problème de l’association humaine dans toute sa généralité consiste à procurer à chacun des associés le développement intégral et le libre exercice de toutes ses facultés » [8].
Ce dernier souci pouvait sembler futile en ces années où de nouveaux interlocuteurs prennent la parole au nom de la base et cherchent à exprimer ses besoins prioritaires et ses moyens d’action collective. Le problème est moins pour eux de rêver un ordre supérieur dans l’idéal que de définir des contraintes subies et un plan de lutte pour s’affranchir du désordre réel, ici et maintenant. L’association change de sens, s’ouvriérise (témoins les premières et éphémères publications du type L’Artisan, journal de la classe ouvrière en 1830 et L’Écho de la Fabrique en 1831) et se politise, comme on le voit dans deux écrits ouvriers parus en 1833 sur le sujet, « De l’association des ouvriers de tous les corps d’état » du cordonnier Efrahem et « Réflexions d’un ouvrier tailleur sur.. la nécessité des associations d’ouvriers comme moyen d’améliorer leur condition » de Grignon. oeuvre de militants de terrain, mais tous deux venant des sociétés secrètes à vocation républicaine.
Grignon : « En attendant qu’un gouvernement populaire soulage l’extrême pauvreté aux dépens de l’extrême opulence, par un meilleur système d’impôts et par une sage organisation du travail, unissons-nous pour resserrer les liens de la fraternité, pour fournir des secours aux plus nécessiteux d’entre nous, pour fixer enfin nous-mêmes le maximum de la durée du travail et le minimum du prix de la journée, c’est à dire pour prendre l’engagement de ne travailler que pour le temps et pour le prix déterminés par nous ; appelons nos frères des autres corps d’état à suivre notre exemple : alors il faudra bien que le maître accepte la loi de l’ouvrier... Il faut que notre association soit assez forte, assez unie pour résister aux prétentions de ceux qui nous exploitent, et pouvoir assurer à chacun de nous : 1) un salaire qui permette des économies pour la morte-saison et les dépenses accidentelles ; 2) le temps de repos nécessaire à la santé et à l’instruction ; 3) Des rapports d’indépendance et d’égalité avec nos maîtres » [9].
Efrahem : « Nous qui souffrons, ne comptons que sur nous-mêmes, nous sentons le mal, cherchons un remède immédiat et efficace ; appliquons-le. Je crois que nous le trouverons dans l’association... Appliquons le plus largement possible le puissant moyen de l’association et adoptons cette devise : union et force... Il serait bien d’abord de former des associations par corps d’état ; d’établir une correspondance entre ces associations, au moyen de députations déléguées par chacune d’elles ; d’instituer un comité central qui formerait un tout et qui fît de ces sociétés partielles une association générale, compacte et forte ; enfin une caisse centrale d’épargnes et de secours, où seraient mis en réserve les fonds nécessaires pour soutenir les ouvriers qui feraient grève... Un jour, citoyens, les bourgeois ne feront pas seuls la loi, il ne la feront pas contre nous. Un jour, nous aurons nous aussi des représentants dans le pouvoir législatif, des orateurs à la tribune » [10].
Le terme d’association ouvrière apparaît. L’association n’est plus à concéder d’en haut par les dominants ou assimilés, mais à conquérir d’en bas par les marginaux ou dominés. En ces années 30 et 40, suivant le mot de deux historiens [11], la parole change de camp.
L’association se radicalise mais reste à base volontaire. Un glissement s’opère en faveur du terme d’organisation du travail, au contenu polémique plus dense et impliquant une centralisation des efforts communs ; de la coordination à la pression et à la politisation, la distance est mince et rapidement franchie, même si en cette période de suffrage censitaire et de surveillance des coalitions (tout rassemblement de vingt personnes est ainsi qualifié), une stratégie associative reste difficile.
3. L’organisation du travail chez Louis Blanc
On reproche parfois à Louis Blanc un manque d’originalité dans les idées et d’avoir puisé dans celles des autres pour mettre au point son système. Mais il faudrait d’abord savoir quel était son but en publiant en 1839 dans son nouvel organe la Revue du Progrès une série d’articles, intitulés Organisation du Travail et rassemblés en volume l’année suivante. Passer à tout prix comme Fourier pour un inventeur ou établir clairement en journaliste attentif aux avis des autres un bilan des éléments majeurs contenus dans les diverses doctrines, si nombreuses à l’époque, en matière sociale ? De ce dernier point de vue son système fait oeuvre de synthèse utile : il emprunte certes aux premiers ouvriers à s’exprimer, à Efrahem et Grignon, autant qu’aux publicistes bourgeois, à Fourier et Considerant, mais il restitue ses emprunts dans une prose fluide. Proudhon, qui ne l’aimait pas, lui reconnaît le mérite de savoir « dire, de manière à être entendu de tout le monde » [12]. Comparons ses thèses et celles de Fourier.
« S’il est nécessaire de s’occuper d’une réforme sociale, il ne l’est pas moins de pousser à une réforme politique. Car si la première est le but, la seconde est le moyen. Il ne suffit pas de découvrir des procédés scientifiques, propres à inaugurer le principe d’association et à organiser le travail suivant les règles de la raison, de la justice, de l’humanité ; il faut se mettre en état de réaliser le principe qu’on adopte et de féconder les procédés fournis par l’étude. Or le pouvoir, c’est la force organisée... L’émancipation des travailleurs est une oeuvre trop compliquée ; elle se lie à trop de questions, elle dérange trop d’habitudes, elle contrarie trop d’intérêts, pour qu’il n’y ait pas folie à croire qu’elle se peut accomplir par une série d’efforts partiels et de tentatives isolées. Il faut y appliquer toute la force de l’État. Ce qui manque aux prolétaires pour s’affranchir, ce sont les instruments de travail : la fonction du gouvernement est de les leur fournir. Si nous avions à définir l’État, dans notre conception, nous répondrions : l’État est le banquier des pauvres... L’État fonderait l’atelier social, il lui donnerait des lois, il en surveillerait l’exécution, pour le compte, au nom et au profit de tous ; mais là se bornerait son rôle : un tel rôle est-il, peut-il être tyrannique ? » [13].
Il s’explique : « Dès qu’on admet qu’il faut à l’homme, pour être vraiment libre, le pouvoir d’exercer et de développer ses facultés, il en résulte que la société doit à chacun de ses membres, et l’instruction sans laquelle l’esprit humain ne peut se déployer, et les instruments de travail sans lesquels l’activité humaine ne peut se donner carrière. Or, par l’intervention de qui la société donnera-t-elle à chacun de ses membres l’instruction convenable et les instruments de travail nécessaires, si ce n’est par l’intervention de l’État ? C’est donc au nom, c’est pour le compte de la liberté que nous demandons la réhabilitation du principe d’autorité. Nous voulons un gouvernement fort, parce que, dans le régime d’inégalité où nous végétons encore, il y a des faibles qui ont besoin d’une force sociale qui les protège. Nous voulons un gouvernement qui intervienne dans l’industrie, parce que là où l’on ne prête qu’aux riches, il faut un banquier social qui prête aux pauvres... Le socialisme ne saurait être fécondé que par le souffle de la politique » [14].
Avec Louis Blanc l’association prend donc un tour résolument dirigiste (mot qui ne se répandra qu’au 20e siècle), alors que les fouriéristes répugnent longtemps à s’intéresser aux problèmes de gouvernement. Elle se socialise aussi doublement, en ce qu’elle prône l’intervention directe de l’État dans son fonctionnement et dans l’appropriation de l’outil de travail. « Nous voulons un État qui intervienne dans l’industrie » dit Blanc ci-dessus, tout comme il dit plus haut : « C’est pour le compte de la liberté que nous demandons la réhabilitation du principe d’autorité ». Comment concilier les deux, l’affranchissement d’un côté, la mise sous tutelle de l’autre ? En matière industrielle tout au moins, il croit possible un arbitrage : « Que l’État se mette résolument à la tête de l’industrie ; qu’il fasse converger tous les efforts ; qu’il rallie autour d’un même principe tous les intérêts aujourd’hui en lutte ». Mais avec un État banquier, donneur d’ordres (« le gouvernement serait considéré comme le régulateur suprême de la production »), dispensateur du crédit et des salaires, qui rende l’association obligatoire (« l’association ne constitue un progrès qu’à la condition d’être universelle ») et, qui plus est, supprime la lutte des salaires et des prix (« la concurrence, c’est l’embrasement nécessaire du monde.. la défaite de la concurrence : l’association) [15], la balance ne penche-t-elle pas vers un autoritarisme manifeste ? Il est pourtant un domaine où Blanc, contrairement à Fourier, n’intervient pas, ne communalise pas, c’est celui de la vie privée. Dans tous les autres, la part de la société civile s’amenuise. Pour lui, qu’est l’organisation du travail, sinon l’association étatisée ? Sous cette cuirasse protectrice, comment reconnaître encore l’association mobile et spontanée conçue par Fourier une génération plus tôt ?
Reste à faire passer dans les faits des propositions aussi radicales. Louis Blanc a certes le mérite d’annoncer clairement la portée de son programme : la contrepartie, c’est qu’il suscite des opposants irréductibles qui y voient une réincarnation du jacobinisme. Les dix années suivantes verront ses partisans et adversaires camper sur leurs positions. Entre les deux, l’idée d’association va se trouver prise en otage.
4. 1840-1850 : l’association piégée
Distinguons à ce stade deux périodes : avant et pendant 48.
À peine parues, les thèses de Blanc vont susciter en septembre 1840 deux articles de la Phalange, portant la marque de Considérant. Les phalanstériens se sentent poussés à redéfinir leurs propres thèses. « Voici le problème social dans ses plus simples termes. Que ceux qui balbutient aujourd’hui, sans en comprendre la portée, les mots d’Organisation du travail et de Réforme sociale commencent enfin à examiner ces termes et à se mettre en face du problème... Étant donné les trois Facultés industrielles, le Capital, le Travail et le Talent, qui sont en hostilité réciproque et permanente dans le Système de leurs relations actuelles, trouver un nouveau Système de relations dans lequel ces Facultés soient associées entre elles ; ou, autrement, organiser le Système de la Production et de la Répartition, de telle sorte que les intérêts du Capital, du Travail et du Talent se trouvent liés dans une étroite et parfaite solidarité. La question de l’Organisation de l’industrie est là ; elle est là tout entière : intéresser le Capital aux bénéfice du Travail et du Talent, intéresser le Travail et le Talent aux bénéfices du Capital, voilà tout le problème. Or ce problème, il appartient à l’Intelligence de le résoudre, à l’expérience de vérifier les solutions présentées par l’intelligence ; et toutes les Classes ont le plus grand intérêt à la solution d’un problème semblable. Quel rapport les réformes politiques, les changements de forme gouvernementale ont-ils avec la solution intellectuelle de ce problème et avec la vérification intellectuelle des solutions qui peuvent être offertes ? La Société changerait mille fois la constitution du Pouvoir politique qu’elle n’avancerait pas d’un iota, pour autant, dans la découverte du Système capable de résoudre la question industrielle et sociale dont nous venons de faire connaître les éléments et les conditions ».
Dans le même numéro : « La question de l’Organisation du travail, ou mieux et comme il faudrait dire, de l’Organisation de l’Industrie a décidément pris place dans le domaine des questions que la presse est résolue de discuter. Résolue, c’est peut-être un peu trop dire... dans toutes les circonstances où les événements sont venus soulever la question du travail, et cela est arrivé bien souvent depuis dix ans, la presse n’a jamais tenu plus de quelques jours devant cette question. Aussitôt ces événements passés, elle retombait dans ses divagations politiques... Ah ! si la presse, plus heureusement inspirée, eût abandonné ces discussions sans fin et sans issue de la politique proprement dite pour les questions de Réforme industrielle, quels ne seraient pas aujourd’hui les avantages de notre position ! » [16].
Les thèses se cristallisent. Le même mois la nouvelle revue ouvrière l’Atelier publie sous le titre Réforme industrielle un article où elle se démarque des phalanstériens : « La théorie fouriériste admet le capitaliste au partage des bénéfices ; elle dit : Chacun apporte sa part de puissance à l’association ; celui-là les écus, celui-ci ses bras, cet autre son savoir-faire. Il faut donc attribuer à chaque élément social une part des bénéfices proportionnée à sa valeur : tant aux écus, tant au travail, tant au talent. Ainsi, d’après la Phalange, et dans l’ordre de sa famille sociétaire, le travailleur, comme élément social, est inférieur aux écus. Du reste nous n’ignorons pas qu’avec ces trois éléments une association bien entendue, bien dirigée, pourrait apporter une plus grande somme de jouissance aux riches, et en même temps amoindrir quelque peu la misère des travailleurs. Mais, avec la meilleure volonté du monde, nous ne pouvons accorder plus au projet des phalanstériens : nous ne sommes pas assez dépourvus de sens commun pour croire avec ces messieurs, qui n’ont jamais rien produit, que, sous leur direction, la production sera multipliée au point de fournir surabondamment à tous les besoins des travailleurs aussi bien qu’à ceux des capitalistes. D’ailleurs, quel que soit le bien-être qui pourrait résulter pour nous d’une semblable association, nous ne devons pas moins la repousser, comme étant complètement contraire à notre principe général, puisqu’elle consacre l’inégalité entre celui qui possède l’argent et celui qui produit. Au capitaliste on promet le repos et la bonne chère ; au travailleur, quoi qu’on en dise, la fatigue du corps et la moindre part au festin du phalanstère. Que cette doctrine flatte certaines gens qui ne sont point de notre classe, nous le comprenons ; mais les ouvriers ne seront pas assez mal avisés pour donner les mains à une institution qui ne sera qu’un moyen nouveau de perpétuer leur infériorité » [17].
La charge contre l’association de type phalanstérien se fait plus mordante dans un second article de l’Atelier : « Nous autres ouvriers, nous sommes fatigués des exploitations de toutes sortes : de l’exploitation du capital, et même, il faut le dire de celle du talent. En un mot, pour représenter notre doctrine économique sous une autre face, nous pensons qu’il faut instituer un état de choses où chacun soit rétribué selon sa bonne volonté ; et, pour nous, faire preuve de bon vouloir, c’est s’appliquer volontairement aux travaux les plus durs et les moins recherchés. Nous n’excluons pas le talent, tant s’en faut, mais il doit céder le pas à la bonne volonté ; et, enfin, nous ajouterons que celui qui ne produit rien n’a droit à rien. Mais la position de messieurs du fouriérisme est tout autre que la nôtre : s’ils ne sont point capitalistes, ils ne sont pas non plus, comme nous, attachés au travail, ces messieurs représentent l’élément social auquel ils donnent le nom de talent ; en d’autres termes, ils sont les organisateurs.. On conçoit bien qu’une association d’ouvriers puisse jusqu’à un certain point se passer de capitalistes ; mais pour expérimenter en grand, comme dans le phalanstère, il faut beaucoup, beaucoup d’argent. Que faire alors ? La chose est bien simple : on fait appel aux capitalistes ; on leur promet des bénéfices énormes, des jouissances infinies, afin d’obtenir de leur égoïsme cet élément passif, à qui l’on fait une part si belle. Quant à l’élément actif, l’ouvrier, ils savent, ces messieurs, qu’il ne leur manquera pas quand ils auront des écus ; aussi, tout en lui promettant les joies du paradis terrestre, néanmoins ils ne lui donnent rang au partage qu’après l’homme qui n’a pas travaillé. Sans vouloir nous faire une arme de la triste expérience que le fouriérisme a déjà subie, nous leur répondrons que nous n’avons aucun intérêt à nous aveugler, et que nous sommes certains que toutes les charges du phalanstère retomberont sur les ouvriers, car les hommes d’écus et les hommes de talent n’éprouveraient que de la répulsion pour le travail et, ne leur en déplaise, le repos, la bonne chère et le bavardage auraient exclusivement le pouvoir d’exercer sur eux l’attraction passionnelle » [18].
Le fossé se creuse entre deux thèses : sommairement, le partage concédé perd pied face à l’exigence d’appropriation - je ne dis pas d’accaparement. L’association proprement fouriériste se dilue sous le feu conjugué des partisans de formes d’action plus directe et des circonstances qui évoluent plus vite qu’elle. 1848 va représenter une épreuve fatale à bien des théories généreuses mais approximatives. Je n’ai pas la place ici pour un récit détaillé de ce désarroi devant les faits. Tout juste quelques repères, au temps de l’éphémère comité du Luxembourg puis, pour Louis Blanc, de l’exil.
À peine proclamée la République, celui-ci avait inspiré le fameux décret du 25 février, dont on ne remarque pas assez qu’il lie application du droit au travail et mise en place d’associations populaires, puisque, si le gouvernement provisoire « s’engage à garantir du travail à tous les citoyens, Il reconnaît que les ouvriers doivent s’associer entre eux pour jouir du bénéfice de leur travail ». Un second décret arrête qu’une « commission du gouvernement pour les travailleurs va être nommée avec mission expresse et spéciale de s’occuper de leur sort ». La commission du Luxembourg, président Louis Blanc qui la qualifiera lui-même de « grande voix des faubourgs », est née. Les ateliers nationaux vont suivre qui, dira-t-il aussi, « furent organisés contre moi ». Il s’en explique : « Les ateliers sociaux, tels que je les avais proposés, constituaient des familles de travailleurs, unis entre eux par le lien de la plus étroite solidarité, familles intéressées à être laborieuses et, partant fécondes. Les ateliers nationaux, tels qu’ils furent gouvernés par M. Marie, ne furent qu’un rassemblement tumultueux de prolétaires qu’on se contenta de nourrir, faute de savoir les employer, et qui durent vivre sans autres liens entre eux que ceux d’une organisation militaire ». L’effort principal de Blanc au Luxembourg consista à dialoguer avec les professions rassemblées sinon par filières industrielles au sens moderne, du moins par corporations artisanales de type traditionnel : « Les ateliers sociaux, tels que je les avais proposés, devaient réunir, chacun, des ouvriers appartenant à la même profession » [19].
Exilé à Londres, il dressera l’année suivante un portrait nostalgique de la journée du 16 mars : « Tout à coup, à une des extrémités de la place de Grève, paraît une masse sombre et compacte. C’étaient les corporations. Séparées l’une de l’autre par des intervalles égaux et précédées de leurs bannières diverses, elles arrivaient gravement, en silence, dans l’ordre et avec la discipline d’une armée. Belle et vaillante armée, en effet ! Mais, au lieu de la mort, celle-ci portait dans ses flancs le travail, source de la vie ; et c’était les mains libres du poids des glaives, c’était le regard levé vers les cieux, qu’elle s’avançait, déroulant à la clarté du soleil républicain ses pacifiques bataillons » [20]. Il conclut sur ce qu’il tenta en 48 avant d’être évincé et proscrit : « Aux résultats produits au Luxembourg, sourdement combattu, environné de pièges et d’obstacles, réduit à un complet dénuement, calomnié, trahi ; au sillon qu’il a tracé ; à cet immense et désormais invincible mouvement d’association auquel il a servi de point de départ, il est aisé de juger combien son action eût été féconde, s’il n’eût pas été réduit aux seules ressources de la parole. Mais je le répète : puisque le système du Luxembourg n’a pas été essayé, il reste à l’ordre du jour de la République » [21]. Refrain connu des utopies délaissées.
Dans chaque numéro de la même revue de proscrits au titre à résonance fouriériste, le Nouveau Monde (rédacteur unique Louis Blanc à Londres, publié à Paris de juillet 1849 à mars 1851), il tient la liste fidèle de la cinquantaine d’associations dont, au titre du comité du Luxembourg, il avait encouragé la fondation. Tentatives éphémères pour la plupart, qui souffrirent, outre de faiblesses insignes au niveau de la gestion ouvrière, de la tare initiale de symboliser l’organisation du travail, donc une offense au modèle de l’entreprise bourgeoise. Ceux qui avaient décidé d’abolir l’influence de Louis Blanc, considéré, tout comme Proudhon et leurs semblables, d’ennemi public de la propriété, l’attaquèrent notamment à travers les associations ouvrières, prises par les Thiers et autres républicains du lendemain non pour un mode possible de partage de la propriété mais pour une offense directe aux propriétaires.
De cet ostracisme, de ce procès d’idées, l’association comme forme d’organisation du travail moderne -sociale, sinon socialiste- ne s’est à vrai dire jamais remise. Ni dans sa forme extrême à la Louis Blanc, ni dans sa forme initiale à la Fourier. Attaquée des deux bords, à la fois par les non-possédants et par les possédants, d’en bas par ceux qui lui reprochaient d’être trop bourgeoise et d’en haut par ceux qui lui reprochaient de ne pas l’être assez, 48 lui a en quelque sorte brisé les ailes.
Que conclure de ce rappel historique, étayé sur des textes du temps ?
Fourier et Louis Blanc furent des théoriciens, croyant chacun à la valeur unique et à l’efficacité de son système. L’un aspirait à l’équilibre du monde, l’autre à son équité. L’échelle de leurs préoccupations est différente. Fourier travaille à un double niveau, à très vaste et à petite échelle : il parle soit des globes soit des groupes ; nourri de théories cosmiques, il croit par analogie avoir découvert le secret de la vie des hommes au stade disons communal. Il reste assez indifférent à l’organisation politique au degré intermédiaire, celui des États ; ce qui ne signifie pas bien entendu qu’il soit insensible au sort des hommes : l’un des premiers, il emploie le terme droit au travail, deux fois par exemple dès 1808, soit quarante ans avant février 48 qui le rendit fameux [22].
C’est l’échelle médiane de l’État au contraire qui passionne Louis Blanc, hanté par le problème de la distribution et même de la compensation des revenus : « Comment arriver, par une meilleure organisation du travail, à une plus équitable répartition des fruits du travail ? » [23]. Il fut de ceux qui contribuèrent à instituer le rôle de l’État en matière non seulement de législation mais de régulation sociale. Quitte à lui attribuer un rôle trop exclusif, au détriment des sources ordinaires d’émulation exprimant dans le cadre de la société civile les choix ou préférences individuelles et collectives. Au fond, les grands absents chez Fourier, et plus encore chez Louis Blanc, ce sont les risques et exigences de l’initiative, des échanges, pour ne rien dire du marché et de la concurrence, dont ces auteurs cherchent à protéger les hommes plutôt qu’ils ne les invitent à y faire face, sans faux-semblants ni paradis artificiels. L’histoire plus récente a montré dans certains pays combien pouvaient devenir pesants, en termes d’inertie et d’arbitraire, les substituts mis en place, les systèmes de compensation administrative Autant et davantage que l’expérience accumulée, les improvisations sociales ne sont-elles pas source de bien des déboires et refuge de bien des médiocrités ?
Conçue et gérée de manière plus ferme, entre l’entreprise de type classique et le comptoir bureaucratique, l’association industrielle aurait pu constituer l’un des outils alternatifs capables non d’effacer, mais d’atténuer - par des actes et non comme souvent en France par des mots - le « malaise démocratique » [24] si bien reconnu entre autres observateurs par Tocqueville, au milieu du siècle dernier.
