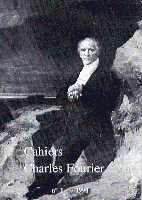
par Thbaut , Jacques
Rédigé en 1835 et resté inédit jusqu’à ce jour, le texte que nous publions ci-après pour la première fois peut donc être qualifié de première biographie de Charles Fourier, titre généralement réservé à l’ouvrage de Pellarin édité quelques années plus tard, après la mort du maître à penser de l’Ecole Sociétaire. Destinée à paraître dans la Revue encyclopédique, à laquelle collaborait régulièrement Pecqueur, cette biographie et présentation de la pensée de Fourier est restée oubliée dans les « papiers de famille » de l’un des fils de C. Pecqueur jusqu’en 1938, pour être revendue à cette date à l’Institut International d’Histoire Sociale d’Amsterdam (IISG) avec quantité d’autres manuscrits et documents divers. Dans ce fonds Pecqueur (qui occupe 70 cm linéaires de rayonnage) figurent d’ailleurs de nombreux manuscrits, à des stades divers d’élaboration, consacrés à Charles Fourier, et répertoriés ainsi :
– 26. Ch. Fourier, 25 pages (manquent les pages 6, 10, 12 et 13) : c’est le texte que nous présentons in-extenso ci-dessous.
– 28. Manuscrit sans titre sur Fourier, 8 pages.
– 29. Système philosophique et doctrine générale de Fourier, 85 pages.
– 31. De la répartition des bénéfices dans le système de Fourier, 10 pages.
– 32. Philosophie de l’histoire : Fourier, 18 pages.
– 33. Liste des écrits de Fourier et sur Fourier de la main de Pecqueur, avec en outre :
– Exposé succinct de la Théorie de Fourier
– Deux lettres de Just Muiron à C. Pecqueur, l’une du 25 septembre 1832, l’autre du 2 mars 1835 [1].
Apparemment, il ne semble pas que ces manuscrits aient jusqu’à présent attiré l’attention des spécialistes de Fourier, car les fonds Pecqueur, qu’il s’agisse de celui d’Amsterdam ou de celui de la bibliothèque du Palais-Bourbon à Paris, sont rarement visités et exploités. Qui, aujourd’hui, s’intéresse encore à Pecqueur ?
On ne fera pas au lecteur l’injure de penser qu’il ignore l’existence de ce précurseur du socialisme, car on rencontre son nom dans tous les ouvrages consacrés aux théories et aux théoriciens socialistes, mais très souvent ce qu’on en sait s’arrête là.
Sans doute parce qu’il est le seul à ne pas avoir créé son école, passant d’un groupe à l’autre, les côtoyant tous, ayant des amitiés chez tous, et élaborant seul et progressivement sa pensée, s’inspirant des uns et des autres, remettant en cause ses propres affirmations à l’occasion des confrontations et des expériences, celui à qui Benoît Malon consacrera en 1886 un numéro de la Revue socialiste intitulé « Constantin Pecqueur, doyen du collectivisme français » passe-t-il discrètement inaperçu parce que n’appartenant à personne.
Aussi est-il nécessaire, avant d’analyser le texte de la biographie de Fourier, de rappeler que Constantin Pecqueur, après un passage chez les Saint-Simoniens, collaborant au Globe et répondant aux correspondants de province, va rompre avec eux et rejoindre les militants fouriéristes en même temps et pour les mêmes raisons que Lechevalier, Abel Transon, le Dr Pellarin et quelques autres [2].
De 1832 à 1835, Pecqueur va devenir un membre agissant du groupe fouriériste, tissant en même temps des relations amicales avec Mme Vigoureux, avec Just Muiron (qui lui demandera de venir à Besançon assurer la direction du journal L’Impartial) [3], avec Victor Considerant (qui lui proposera également, par une lettre du 30 novembre 1834 [4], de prendre la direction de La Gironde à Bordeaux), et bien d’autres. Ces propositions, aussi bien que le ton des lettres échangées entre eux, ne laissent aucun doute sur la haute estime en laquelle ceux-ci tiennent Pecqueur. Incontestablement, ses talents de journaliste sont appréciés et il semble recherché [5].
Durant ces quatre années, il va collaborer au Phalanstère, à la Revue encyclopédique, où se retrouvent nombre de dissidents du saint-simonisme, et à la Revue du progrès social de Jules Lechevalier.
Cette activité de publiciste n’a pourtant rien à voir avec la propagande d’un groupe ou d’une école. Il expose et défend celles de ses idées qui sont en accord avec le fouriérisme, enrichissant plutôt sa propre pensée, comme il l’avait enrichie pendant les trois années passées chez les Saint-Simoniens. Ainsi cet article paru le 9 août 1832 dans le n° 11 du Phalanstère :
« Dans le sens le plus large, et à parler rigoureusement, les droits de l’homme ce sont tous les moyens qui peuvent le mieux favoriser, hâter et garantir à chacun l’essor de ses passions, le développement de ses facultés et puissances, la satisfaction de ses besoins, en un mot ce sont tous les moyens qui peuvent procurer à tous la plus grande somme de bonheur.» La jouissance de tous nos droits par la connaissance et l’application de tous ces moyens, voilà la liberté à son summum. Donc, plus l’homme dispose de tous ces moyens, plus il est libre. Cette définition de la liberté n’est que la traduction politique et économique de la définition métaphysique de Locke. La liberté est le pouvoir de faire ce que l’on veut, car ce que veut l’homme à l’état normal et dans son bien-être, c’est ce que lui dicte sa nature passionnelle...
» Socialement comme individuellement, le bonheur est la mesure de la liberté [6]. »
Cette idée de la nature passionnelle de l’homme qui revendique la liberté de faire ce qu’il veut, idée typiquement fouriériste, Pecqueur la défendra toujours, même longtemps après sa rupture avec l’Ecole Sociétaire.
En 1835, il prépare la rédaction d’une biographie du maître. L’ambition est en réalité fort modeste : il ne s’agit que de présenter l’homme et sa pensée aux lecteurs de la Revue encyclopédique, certainement plus nombreux que les lecteurs des œuvres complètes de Fourier. Malgré cela, et comme à l’accoutumée pour lui, Pecqueur tient à réaliser un travail méthodique et rigoureux. Il entend écrire une biographie que l’on qualifierait volontiers de scientifique, à la fois par ses sources et par sa volonté d’insérer Fourier dans son temps et son milieu.
Au plan des sources, il utilise les œuvres de Fourier, dont il fait d’ailleurs une présentation fort correcte, alors que chacun sait qu’il n’est pas simple de résumer cet ensemble théorique. Les autres disciples, qui sont aussi ses amis (Considerant, Madame Vigoureux, Pellarin) sont largement consultés, ainsi que Just Muiron à Besançon, comme l’atteste la lettre-réponse de ce dernier publiée dans LUVAH. Mieux encore, cette lettre nous révèle une autre source capitale, c’est Fourier lui-même. « Vous pouvez connaître par vous-même le caractère de M. Fourier » remarque Muiron, car il sait que Pecqueur rencontre Fourier. La confirmation de cette fréquentation se trouve aussi dans la biographie, quand Pecqueur écrit : « souvent, m’a-t-il dit, il... » Ce n’est pas le moindre intérêt de ce travail que d’avoir été réalisé alors que Fourier était encore vivant, et de savoir que l’auteur de ce texte a eu avec lui des relations personnelles.
Certes, le caractère irascible de Fourier dans ses dernières années, et la tension qui régnait dans ses rapports avec ses disciples, doivent nous garder de croire à une certaine collaboration qui mettrait le texte de Pecqueur à l’abri de toute critique. De toute façon, sur le plan personnel et anecdotique nous n’apprenons rien de bien nouveau à lire ce texte, qui pourrait tout juste alimenter le débat sur l’âge de Fourier au moment de la fameuse gifle paternelle (Pecqueur indique cinq ans, comme Pellarin, accusé par E. Lehouck d’avoir rajeuni l’enfant révolté, « lui donnant cinq ans au lieu de sept » [7]). Cependant, l’information concernant le projet « de fournir économiquement la nourriture à 3000 personnes par la cotisation des abonnés » est importante car elle vient conforter la thèse de Lehouck : « Jusqu’en 1799, le jeune Fourier était resté un réformiste qui acceptait les grands principes de la civilisation, mais dont l’esprit fertile imaginait une foule d’améliorations dans toutes sortes de domaines [8]. » Mais ce qui nous semble intéressant dans ce manuscrit est bien plutôt la volonté d’impartialité exprimée par son auteur, refusant tout enthousiasme comme toute critique systématique, et s’efforçant dès lors de réinsérer l’homme et sa pensée dans son époque et de souligner sa filiation. Pour Pecqueur, comme pour bien d’autres commentateurs qui l’affirmeront plus tard, Fourier est l’héritier des « Lumières », même s’il « ne s’aperçut pas ... qu’il en avait respiré l’écume corrosive comme les ondées fécondantes. » Ici, Pecqueur dépasse un peu le but de son écrit pour exposer une idée qui lui sera chère toute sa vie : la Révolution dans sa grandeur va de la Constituante à la Convention. Tout ce qui suit fait « l’homme mutilé de la France directoriale, consulaire et impériale », et est donc rejeté. On retrouve cette idée, typiquement pecqueurienne, exprimée plusieurs fois dans ce texte, et dans bien d’autres. En conclusion, « Fourier n’est pas, comme on l’a cru, en tous points étranger à son siècle. »
Par les formules « voyons d’où il vient » et « où il commença à vivre », Fourier, réintégré dans son siècle, se voit maintenant réintégré dans son milieu socio-culturel familial (le négoce et la fraude mercantile, l’hérédité, le droit de correction paternelle, la ville de Besançon, ses marchands et son Université de Droit [9]) et socio-économique (les villes commerçantes de Lyon, Rouen, Marseille, la crise de 1815). La disparition de la page 6 du manuscrit ne nous permet malheureusement pas de juger du retentissement donné par Pecqueur à ces diverses influences sur la formation et l’évolution de sa pensée, sinon par la phrase du début de la page 7 : « De là son parti-pris de rechercher un mode d’association quelconque. »
Ainsi, témoin direct, en relation avec Fourier pendant plusieurs années, Pecqueur nous apporte un certain nombre d’informations de première main. Peut-on mettre en doute une description aussi précise et détaillée du galetas où « le génie en décrépitude » attend la mort « au milieu de ces ruines » ? Pecqueur n’a-t-il pas monté ces trois étages ?
Peut-on alors qualifier cette biographie, même courte, de sérieuse et honnête ? D’exposé complet et satisfaisant de la pensée de Fourier ? Evidemment non ! D’abord par les limites fort étroites du cercle d’amis ayant fourni à Pecqueur les éléments de son travail. Mais aussi et surtout parce que déjà, Fourier encore vivant, il y a un divorce bien connu entre le maître et ses disciples, qui pratiquent systématiquement un « utile sarclage ». Rien dans ce texte sur le libertinage amoureux et autres « excès » de Fourier, qui ont amené ses disciples à occulter toute cette part de sa pensée trop en avance sans doute dans ce siècle si farouchement pudibond. Eût-il voulu aborder ces problèmes, que Pecqueur se serait trouvé face à la censure organisée que tous les commentateurs de l’Ecole Sociétaire ont soulignée. Une nouvelle preuve nous en est donnée par la lettre-réponse de Muiron à Pecqueur déjà évoquée : « ...Madame Vigoureux, Victor, vous diront le reste, ils le savent aussi bien que moi ET N’OMETTEZ PAS DE LEUR COMMUNIQUER VOTRE ARTICLE AVANT SA PUBLICATION, CAR IL NE FAUT RIEN DIRE QUI PUISSE NE PAS NOUS ALLER. » Le ton de cette mise en garde, si contraire à l’urbanité qui préside habituellement aux rapports des uns et des autres, indique clairement les limites que l’Ecole Sociétaire, et en particulier son mécène Just Muiron, ne permettent pas de franchir. La censure est telle, que certains manuscrits seront gardés sous le boisseau et ne seront édités que beaucoup plus tard.
La non-parution de cet article préparé par Pecqueur pose question. Faut-il y voir un effet de cette censure ? Aux yeux des disciples officiels, Pecqueur est-il allé trop loin dans l’exposé des analogies [10] et de la Trinité fouriériste ? Ou plutôt, Pecqueur s’est-il rebellé contre cette censure qui devait lui être particulièrement insupportable alors que sa rupture avec l’Ecole Sociétaire était déjà latente ?
Cette « épuration » (le mot est faible) de la pensée et de l’œuvre de Fourier, dont on ne garde rien « qui puisse ne pas nous aller », va permettre à l’Ecole Sociétaire, emmenée par Victor Considerant, de se rapprocher progressivement de l’Eglise catholique et d’intégrer certains catholiques sociaux, voire des prêtres. Elle nous rend d’autant plus désagréable l’insinuation de Considerant sur un éventuel retour de Pecqueur « à l’idée catholique » dans la lettre [11] qu’il lui adresse le 3 septembre 1836 après la publication en août dans La Presse d’articles que Considerant avait trouvés « maladroits » et dont il a appris « qu’ils sont à intention hostile ». En fait, cette fois, Pecqueur s’est voulu impartial et la plume libre.
Comme avec le saint-simonisme quelques années auparavant, Pecqueur rompt définitivement avec le fouriérisme, non sans en emporter bien des idées qu’on retrouvera dans ses écrits futurs. A de nombreuses reprises il égrènera ses désaccords avec le fouriérisme, qui « aboutit sans le vouloir à la licence et l’anarchie puisqu’il nie la légitimité d’un pouvoir coercitif, puisqu’il prétend se passer de toute contrainte » [12], et qui consacre « les vieilles bases de l’iniquité : l’usurpation du sol, le capital et sa rente, et le droit prétendu du talent » [13].
Après trois années chez les Saint-Simoniens, quatre chez les Fouriéristes, soit sept années de réflexion, de critique, de confrontation, mais aussi d’observation du développement économique, des progrès techniques, et surtout du monde ouvrier (quelques semaines après l’écrasement des Canuts, il écrira : « Le débat est désormais entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas » [14]), il va maintenant élaborer et exposer sa propre pensée. Dès 1837, son premier ouvrage Economie sociale des intérêts du commerce, de l’industrie et de l’agriculture sous l’influence des applications de la vapeur paraît et connaît un réel succès. Couronné par l’Académie des Sciences morales et politiques, il sera plusieurs fois réédité. On y trouve déjà, en germe, toute sa théorie collectiviste. Le divorce est consommé.
CHARLES FOURIER par Constantin PECQUEUR [15]
« Une inquiétude universelle atteste que le genre humain n’est point encore arrivé au but où la nature veut le conduire, et cette inquiétude semble présager quelque grand événement qui changera notre sort. »
Ces paroles d’avenir, écrites en 1808 par l’homme dont le nom commence ces pages, ont reçu successivement une bien puissante confirmation de la bouche illustre des Demaistre, des Chateaubriand, des Ballanche, des La Mennais. Grâce à la plume populaire ou imposante de ces grands esprits, ce pressentiment s’est pour ainsi dire multiplié dans toutes les âmes. Depuis 1830 surtout, il a pris une telle consistance qu’il fait la physionomie de l’époque et que les peuples attendent de la science des voies larges d’amélioration, à l’entrée desquelles ne soit pas la terrible et coutumière nécessité des conflagrations. En présence d’un tel besoin, nous devons nous attacher à faire passer sous les yeux de nos lecteurs les systèmes neufs ou hardis qui prétendent à l’assentiment universel. Nous choisissons aujourd’hui celui de Charles Fourier, parce qu’il a une certaine actualité et qu’il entre plus avant que tout autre, à nous connu, dans les questions vitales qu’a soulevées le 19ème siècle.
En abordant cette tâche, nous nous sommes efforcés de nous mettre dans les meilleures conditions d’intelligence et d’impartialité. Nous savons toute la distance qui sépare un novateur qui se présente appuyé d’une création encyclopédique, et le critique qui veut exposer ou juger l’œuvre de toute une vie. Mais nous savons aussi que la réalité est une excellente pierre de touche en ces matières, et que les convictions purement spéculatives sont presque toujours éphémères. Dans notre rôle de rapporteur, nous nous défendrons donc des préoccupations qui portent tantôt à l’enthousiasme et à l’entraînement, tantôt rendent exclusif jusqu’à ne permettre d’audace au novateur que ce qu’il en faut pour inventer ce qui est.
Quand on veut remonter à la source des faits de tout ordre qui composent la vie sociale de ces trente dernières années, toujours et partout on revient convaincu qu’ils procèdent de la révolution de 89. C’est là que se sont inspirées les grandes passions et les grandes pensées de notre époque, soit pour défendre ou accuser le passé, soit pour éclairer ou flétrir le présent, pour prévoir ou hâter l’avenir, et nous n’exceptons pas même de cette commune origine, les natures et les œuvres les plus excentriques en apparence : c’est que jamais, en effet, événement dans l’histoire n’exalta un pays comme notre Révolution, la France. On vit alors un peuple mesurer et combler avec la plus rapide audace, l’intervalle qui séparait l’humilité de la grandeur, la misère de l’opulence, le crime de la vertu, et émonder brusquement, d’un incisif et pur radicalisme, le vieux tronc de ses croyances, de ses préjugés, de ses institutions. L’esprit de régénération semblait souffler de toutes parts : les antiques traditions furent interrompues : on prohiba le passé et il fut vrai de chacun, même de ceux qui s’ignoraient, qu’ils avaient dépouillé le vieil homme. Mais dans cette aspiration soudaine à une vie plus haute, que d’espérances insensées ! Que de beaux rêves évanouis et de monstruosités réalisées ! Ne dut-il pas sembler que tant de lueurs suscitaient l’enthousiasme au sein de l’erreur que pour fatiguer l’âme de délire, et la rendre à la terre, plus contrite, plus dénuée qu’aux jours de servilité. Une génération venait de commander à sa nature d’homme un élan inouï : on eut dit qu’elle avait reçu du ciel l’archétype de ses passions et de ses puissances, tant elle s’était grandie et surpassée tout à coup. Mais la fièvre n’est point l’état normal de l’humanité : les tempéraments reprirent le calme vulgaire ; on fit halte et regardant ses œuvres derrière soi, on vit qu’on avait obtenu la liberté par l’anarchie, l’égalité par la terreur, la loi agraire par la famine, la fraternité par le sang. C’était là un vide réel : or les nations ont horreur du vide ; au lieu d’espérer et de poursuivre après l’orage, pour gagner la voie du salut, on se découragea et il se fit dans les âmes un grand refroidissement. Le dévouement fit place à l’égoïsme, l’effervescence au calcul, la foi nouvelle à l’ironie du scepticisme, la moralité au positif de la vie mondaine, l’appétit des sens et le plaisir en relief se mirent en pratique ; la révolution, en un mot, s’en prit plus sourdement aux mœurs, à la vie intime et y infiltra la même décomposition qui venait de renverser l’abri public. En ce moment, la vie fut plate et grossièrement sentie, les sciences morales et la philosophie spiritualiste, jusque là en honneur, furent tarées : on en fit jeu, on les traita d’hypocrites conseillères ; ne venait-on pas de les voir en action ? Les doctrines de Rousseau, de Voltaire et toute la puissance intellectuelle du 18ème siècle n’avaient-elles pas eu leur solennelle expérimentation dans la Constituante et dans la Convention ? Du moins, c’était la foi du temps.
Un homme, issu de cette génération même, était resté spectateur neutre, mais non impassible, de toutes les étranges ou belles choses qu’elle avait faites. Novateur radical, bizarre par cela même, doué du génie de l’analyse et d’une grande puissance de critique, il devait recevoir de cette conflagration, une initiation bien propre à développer l’originalité qui couvait dans sa pensée ; mais comme il ne lui fut pas donné de comprendre la condition douloureuse des grandes transformations et qu’il avait habitué sa sensibilité à ne plus se soulever que pour condamner et dénoncer le mal, il fit divorce complet avec la civilisation dont il était le produit ; il ne s’aperçut pas qu’en voyant passer devant ses jeunes ans le flot révolutionnaire, il en avait respiré l’écume corrosive comme les ondées fécondantes. Et aujourd’hui après avoir enfanté tout un monde, il ignore son origine, il n’a point conscience qu’il a été suscité par cette révolution et qu’il est peut-être le représentant, sinon le plus heureux, du moins le plus cru et le plus profond de ses écarts et de ses préoccupations, de ses besoins et de ses désirs. Nul, en effet, n’a vu de plus loin la puissance logique des faits contemporains et ne les a ramenés plus impitoyablement à leur simple expression. En s’appliquant sérieusement aux écrits de Ch. Fourier, on reconnaît partout l’audace, le radicalisme, l’allure populaire, et l’étrangeté morale de la pensée révolutionnaire. Il avait vu bâtir un nouveau-monde sur le sable mouvant, il voulut en fonder un en terre ferme, pour cela il se servit des mêmes matériaux et rejeta toutes les combinaisons, toutes les formes qu’on venait de démonétiser. Partout où il avait vu le nouvel édifice fléchir ou se fendre, il nota l’imperfection et se promit de la faire disparaître. Il n’est pas une prétention, pas un vœu, pas une promesse de ces temps qu’il n’ait pesé, voulu satisfaire ou réaliser ; pas un mal social qu’il n’ait voulu atteindre dans sa cause et déraciner. Ainsi, qu’il le sache ou non, en spéculant sur l’humanité, il prit son type dans l’homme et la société révolutionnaires ; il laissa obscur dans son système ce qui était dans l’ombre chez l’homme mutilé de la France directoriale, consulaire et impériale, et mit en relief ici, ce qui dominait là.
Tandis que d’un côté, l’histoire nous montre le peuple souverain manquant de pain, et la Convention décrétant que la patrie doit à ses enfants le nécessaire et le travail ; tandis qu’elle nous montre l’effrayant déplacement des fortunes et des conditions, et les populations en masse restant cependant condamnées, comme devant, à la glèbe du salaire, et qu’elle retentit encore du mémorable élan des âmes vers la liberté, l’égalité et la fraternité ; de l’essai prématuré du système d’Election populaire, de l’appel généreux aux nations pour se fondre en une république universelle, de l’impatience de toute contrainte législative, de l’aversion de toute autorité humaine, d’un autre côté, les écrits de Ch. Fourier ne sont qu’une continuelle et explicite tentative de combiner un état social qui comporte le règne absolu de la liberté et par conséquent l’inutilité d’une sanction législative et d’une autorité coercitive ; un minimum en vêtement, en logement, en nourriture pour le peuple ; la distribution naturelle de la richesse à chacun suivant son capital, son travail et son talent ; le droit au travail, l’accession à toutes les fonctions, chacun suivant son attrait naturel, son goût ; le quadruplement de la richesse, le règne de la justice et de la vérité et la garantie de fortune par la pratique de ces vertus ; l’industrie et le travail attrayant ; la fusion des classes moyennes, pauvres et riches ; l’éducation facultative pour tous indistinctement, l’élection par ses pairs pour toutes les branches d’activité sociale ; l’essor libre des passions légitimes et leur harmonie ; l’accession naturelle et libre des capacités au pouvoir d’opinion ; le concours de l’intérêt individuel et de l’intérêt général ; l’harmonie universelle ; l’unité de langue, de monnaie, de poids et mesures ; enfin l’Egalité, non pas le nivellement des fortunes, des facultés et des mérites, mais l’Egalité telle que les républicains avancés de notre époque la conçoivent, c’est-à-dire l’absence de tout monopole, et la possibilité de se développer, d’atteindre le bien-être et l’aisance et d’égaler ou de surpasser moralement ses semblables par le talent ou la vertu.
Ce rapprochement était nécessaire pour montrer que Fourier n’est pas, comme on l’a cru, en tous points étranger à son siècle ; toutefois, à cela se borne la contemporanéité de ses idées ; pour tout le reste, dans ses moyens, dans les sommités de sa conception comme dans ses prémisses et ses bases, il n’a d’analogue ni parmi nous, ni dans l’antiquité. C’est un esprit sui generis qu’il faut suivre à l’œuvre pour s’imaginer un symbole réflecteur de son originalité. J’oublie pourtant un dernier trait de filiation : par sa méthode, Fourier est bien encore de son temps. Il part de l’expérience et de l’analyse et ne laisse jamais échapper sa pensée sans lui donner pour cortège le calcul et la Géométrie ; on dirait un savant de l’expédition d’Egypte ; tel est son génie mathématique qu’il transporte dans l’étude des choses morales, la rigueur des sciences fixes et qu’il prétend y assujettir la nature progressive et l’indomptable libre arbitre de l’humanité ; en quoi il n’est encore que l’expression avancée de la tendance vague des Laplace et des Lagrange. Mais n’anticipons pas : pour le comprendre, voyons d’où il vient, quelles furent les nécessités prédominantes de sa nature et le milieu où il commença de vivre.
Charles Fourier est né à Besançon en 1772. Son père était marchand et s’en trouvait bien : c’est assez dire que la carrière du jeune Fourier fut toute tracée dès son entrée dans la vie ; du moins, ainsi le pensaient ses parents, heureux de se voir revivre non seulement dans l’Enfant, mais encore dans sa profession. Charles, malheureusement, parut dévier de bonne heure de la vocation héréditaire ; dès l’âge de cinq ans il faillit à bouleverser les prévisions paternelles.
On avait dit souvent à l’école du voisinage qu’il fallait ne jamais mentir, rien n’étant en soi si bas et si coupable, et l’enfant voyait chaque soir remplir d’étoffes flétries ou surannées des balles qu’on donnait aux pratiques comme sortant toutes fraîches du magasin et offrant un premier choix. Le petit fâcheux, à maintes reprises, avait divulgué ingénument la fraude de l’honnête marchand ; un jour, il en reçut une de ces corrections qui ont presque toujours pour résultat de reporter la haine ou la colère du patient sur l’objet qui en est l’occasion. Ainsi fit-il, et, comme il aime à le répéter aujourd’hui, il renouvela, contre le commerce, le formidable serment d’Annibal. C’en fut assez pour alarmer les bonnes gens qui prédirent dès lors que leur héritier ne vaudrait jamais rien pour les affaires ; en effet, après un long exercice d’une vocation forcée, il ne semble pas que Fourier ait porté dans le négoce, la ruse ou le bon vouloir qui font sourire la fortune malgré qu’elle en ait. C’est ainsi que celui, qui, vingt ans plus tard, devait faire peser une irrésistible critique sur la fraude mercantile, prit naissance dans une boutique et puisa ses premiers arguments dans le magasin paternel. Des parents attentifs aux inclinations de l’Enfant, ou plus aisés, l’eussent destiné aux sciences géographiques et aux voyages ; car dès six et sept ans, il montrait une ardeur non équivoque pour cette étude et le long cours. Son père toutefois n’y était pas indifférent ; il conspirait même avec l’enfant contre sa mère pour l’achat des cartes géographiques, dont celui-ci eût voulu à tout prix, et que la mère pourtant considérait comme à peine dignes d’une obole. On l’envoya bientôt au collège de sa ville natale : il y fit assez bien ses cinq classes et en sortit à dix-sept ans sachant son latin. On professait alors à l’Université de Besançon le Droit et la Jurisprudence, il voulut en suivre le cours, mais il se sentit aussitôt une répugnance prononcée, et aussi une incapacité notable pour ce genre d’étude. Il y renonça donc et alla à Rouen dans le but de se former au commerce ; puis à Lyon où il continua son apprentissage en qualité de commis libre ; il se fit ensuite commis-voyageur et finit plus tard par s’asseoir dans cette ville et y professer de longues années le courtage en coton. Pour ceux qui savent quels rudes coups ce critique a portés au commerce, Fourier, courtier, c’est Lafayette noble et marquis, c’est Luther moine et catholique. A Lyon, Fourier devenu par hasard le commensal de Dugas-Montbel, de Jars et de Ballanche [16] eut de passagères relations avec ces hommes d’avenir. Le célèbre philosophe-poète donnait alors quelques-uns de ses loisirs à la direction du journal de Lyon, Fourier lui rédigea plusieurs articles, mais leurs rapports n’allèrent guère au-delà : ces deux esprits devaient fournir des carrières trop diverses pour se pouvoir contempler.
Sans s’exclure mutuellement dans l’objet de leurs poursuites, leur destinée était pourtant de représenter chacun des idées qui jusqu’ici ont constitué un dualisme hostile et à grand peine conciliable. L’un portait sa vue vers les réalités de la vie ; l’autre, ardente nature de chrétien, vers l’idéal
............
[manque ici la page 6 du manuscrit]
...que l’isolement des intérêts et leur opposition ; l’incohérence des travaux, le morcellement des propriétés, la compétition anarchique des capacités, étaient la cause la plus radicale des maux multipliés qui affligeaient ses regards. De là son parti-pris de rechercher un mode d’association quelconque. Déjà, pendant un séjour à Marseille, il avait conçu un projet assez semblable à celui que Mr Botterel voudrait aujourd’hui réaliser pour Paris ; mais il se bornait aux moyens de fournir économiquement la nourriture à 3000 personnes par la cotisation des abonnés. Cette idée le jeta naturellement dans des combinaisons plus générales, et il s’aperçut en avançant que pour prétendre associer les hommes, il fallait le faire intégralement, c’est-à-dire étendre le principe à toutes leurs manières d’être. Il crut voir que la sympathie qui cimente les unions, en ambition, en amour, en amitié et porte les hommes à se grouper par rapport de caractère, de goût, etc... constituait l’élément primaire de l’association ; car si les hommes se groupent selon l’affection pour le plaisir, pourquoi pas également pour le travail et pour les buts divers qu’ils poursuivent en société ?
L’attrait donc, bien naturel du groupe veut être généralisé dans son application sociale ; et parmi les groupes, n’y a-t-il pas des nuances, des similitudes ? De là les séries, c’est-à-dire une agrégation de groupes similaires. Mais l’attrait dans chaque individu et dans chaque relation, ne serait-ce pas la grande loi de l’humanité ? L’attrait, ne serait-ce pas l’attraction de Newton gouvernant aussi toutes ces monades spirituelles et sociales ? Et les séries, ce mode général de l’association, ne sont-elles pas en dépendance et comme le prolongement même des séries mathématiques ; n’en ont-elles pas les propriétés rigoureuses et fixes, auxquelles devront se conformer les mouvements de l’industrie organisée ? Les nombres seraient donc l’expression nécessaire et invariable des lois qui régissent l’humanité comme de celles qui régissent les corps.
Les Séries et l’Attraction, voilà donc historiquement et logiquement les idées génératrices du système d’association de Fourier. Ce qui s’opéra ensuite de plus profond dans sa pensée et consomma l’élaboration complète de ce système, Fourier seul pourrait tout au plus le retracer au lecteur ; nous savons toutefois que cette analogie, réelle ou spécieuse, avec la loi de Newton, le mit dans une extase scientifique qui a eu un bien long retentissement dans son imagination et devint dans ses livres et ses conversations, sa comparaison favorite. Plus tard, il subordonna même cette loi à la sienne et prétendit qu’elle n’était qu’une branche dérivée du mouvement passionnel. Mais, pour l’instant, tous ses efforts eurent pour objet la vérification de son hypothèse et la déduction de ses conséquences psychologiques et sociales. Peut-être faut-il affirmer que c’est à ces deux idées : l’attraction et les séries, que Fourier doit sa supériorité et sa puissance comme ses erreurs et ses lacunes. L’année 1799 commença pour lui une vie d’étude, de méditation et d’élaboration qu’il n’avait guère connue jusque là. Il passa les huit premières années du siècle à préparer les matériaux de son premier ouvrage ; nous nous trompons : à cette époque, Fourier était courtier sur la place de Lyon et quotidiennement ses facultés inventives devaient obéir à la fatalité qui l’enchaînait aux affaires vulgaires ; jour par jour, sans rémission, douze de ses plus fraîches heures s’escomptaient à la bourse et aux magasins.
Souvent, M’A-T-IL DIT, il marchait, venait et revenait huit heures durant par les rues de Lyon. Peut-être convient-il de noter, pour ceux qui aiment partout la difficulté vaincue, qu’il échangeait tout cela contre son nécessaire ; et pourtant il épargna si bien ses loisirs qu’il trouva moyen d’agiter toutes les questions humaines, de sonder tous les mystères, de remuer enfin la terre et le ciel. On peut, il est vrai, ainsi faisant, ne rapporter de ses excursions que des utopies ou des erreurs ; encore faut-il être géant pour se posséder en réflexion, profondeur et énergie et ne point rester stérile lorsque notre sève doit prendre racine sur un sol de ronce. La théorie des quatre mouvements n’est pourtant rien moins que l’ébauche d’une doctrine générale fortement jointe dans ses parties et convergeant de tous points vers l’unité ; c’est l’essai d’une tête de trente ans qui ose aspirer à remonter jusqu’à l’Etre Suprême et s’identifier un instant avec Dieu, comme pour rattacher à son sein les causes secondes et rapporter sur la terre les plus hautes vérités, sans laisser aucune solution de continuité entre la science absolue de Dieu et la science bornée de l’homme. Témérité prodigieuse sans doute, mais du moins belle et rare lorsqu’elle n’est point le pur délire d’un fou ; ainsi Platon prétendit voir face à face les éternels archétypes et fut appelé pour cela divin. Il faut que cette audace des conquérants du monde intellectuel soit bien humaine et populaire, car leur ambition a été merveilleusement allégorisée, je crois, dans le Prométhée qui ose tenter de dérober au ciel la clarté des clartés.
Le livre original parut en 1808 et ne fit point sensation. L’étrangeté du fond et de la forme, il est vrai, se sentait d’avant-goût et n’était pas propre à lui concilier la frivolité, tout au plus, aurait-il pu solliciter quelques penseurs de profession, mais probablement l’ouvrage ne vint point à leur adresse. Le moment d’ailleurs n’était pas opportun : le grand homme fascinait alors le monde et intimidait les intelligences [17] ; la spontanéité philosophique sommeillait en France : cependant quelques échos d’admiration et de propos légèrement spirituels furent entendus. La Gazette de France du temps y consacra quatre articles et donna ce livre à ses lecteurs pour l’œuvre d’une tête bizarre, originale, unique. Le rédacteur se montrait prodigue de saillies, de ce bel esprit qu’on aime à vingt ans et qui avait un grand cours dans les salons de l’Empire, mais il n’examina point le côté sérieux de la conception ; le livre vieillit dans quelque magasin de librairie et l’auteur qui s’était voilé sous le nom semi-anonyme de Charles resta ignoré. La théorie des quatre mouvements contenait cependant en germe ces idées et cette critique qui depuis ont frappé de notables intelligences de tous les ordres. Il y aborde de front le problème des destinées générales et les définit : les résultats passés présents et futurs des lois mathématiques de Dieu sur le mouvement universel. Fourier prétend en posséder la théorie et expliquer par elle le mouvement social, c’est-à-dire les lois selon lesquelles Dieu régla l’ordonnance et la succession des divers mécanismes sociaux dans tous les globes habités ; le mouvement animal, ou les lois des passions et des instincts des êtres en général ; le mouvement organique, ou les lois des propriétés, des formes, des couleurs, de toutes les substances possibles passées et à venir ; enfin le mouvement matériel, ou les lois de la gravitation de la matière que Newton a su reconnaître et vérifier. Ces quatre mouvements sont coordonnés aux mathématiques, car sans cette dépendance, il n’y aurait point d’harmonie dans la nature et Dieu serait injuste. La nature, en effet, se compose de trois principes éternels, incréés et indestructibles : Dieu ou l’Esprit, principe actif et moteur ; la matière, principe passif et mû ; la Justice ou les Mathématiques, principe régulateur du mouvement. Dieu donc en mouvant et modifiant la matière a pour règle nécessaire les mathématiques ; déjà nous en avons la preuve en ce qui regarde les deux mouvements matériels et organiques qui sont en parfait accord avec la Géométrie. Or, Fourier aurait la gloire d’avoir découvert que les deux autres mouvements obéissent à la même loi des nombres et que les passions quelconques, dont ces deux mouvements ne sont que le jeu, ne produisent chez l’homme et chez l’animal que des effets géométriquement réglés par Dieu. Ainsi, les propriétés de l’amitié seraient calquées sur celles du cercle ; les propriétés de l’amour sur celles de l’Ellipse ; la Parabole serait le type géométrique de la paternité, l’hyperbole, de l’ambition ; la cycloïde des quatre passions réunies ; etc... et l’on a vu que l’activité industrielle des sociétés devait s’organiser et se combiner d’après les propriétés des séries géométriques. Ce n’est pas tout : le mouvement social est type des trois autres, et les propriétés d’un animal, d’un végétal, d’un minéral et même d’un tourbillon d’astres, représentent quelque effet des passions universelles. De là, l’analogie universelle ; de là, un poétique symbole des passions et des mouvements au cœur de l’homme répandu par toute la nature. Si l’homme veut voir l’image resplendissante du jeu de l’amour, de la paternité et de l’ambition, qu’il tourne ses regards vers les espaces célestes où sont suspendus les groupes de planètes sur soleils, de satellites sur planètes et sur ceux des soleils ou étoiles fixes. Nos passions sont donc, après Dieu, ce qu’il y a de plus noble, et de là encore tous les efforts de Fourier tournés vers la recherche des moyens propres à leur procurer en société essor et développement complet.
Les mathématiques ne pouvaient jouer un si grand rôle dans la création sans que certains nombres reçussent cette vertu mystérieuse pressentie par Pythagore : Fourier a donc des nombres sacramentels qui semblent porter en eux de lumineuses révélations. Ce sont de pareilles spéculations que Fourier jette en passant et relègue dans une note de ses Quatre mouvements. On ne s’étonnera donc point de le voir dans le corps de l’ouvrage, préfixer la durée, la succession et les rapports des globes et des tourbillons ; assigner à l’humanité la limite de son passage sur la terre, lui dérouler les phases de son avenir et la rendre plus attentive à ses destinées en ce monde, en rattachant les voluptés de l’immortalité qui l’attend, à l’ordre et à l’harmonie qu’elle aura su réaliser dans sa vie sociale. Et non seulement Fourier esquisse toute une philosophie de l’histoire, touche à la grande question de la chute et lui donne une ingénieuse et profonde interprétation, non seulement il commence une critique en règle de
............
[manque ici la page 10 du manuscrit]
...et la rendit possible. Le premier, Fourier entreprit dans cette vue la critique des éléments constitutifs des sociétés, et ce n’est point une vague sentimentalité qui le guide : il y apporte la méthode des naturalistes ; il classe, divise et subdivise ses griefs ; son œil parcourt le confus ensemble de la civilisation ; il la saisit corps à corps, lui arrache les faux brillants qui cachent aux regards ses oripeaux ; il la dépouille jusqu’à la nudité, la dissèque enfin ; la force, vaste cadavre, à montrer mille plaies saignantes par où s’exhalent toutes les corruptions, et ne l’abandonne qu’après avoir accusé partout la gangrène et la mort.
Aux yeux de Fourier, la cause profonde des maux qui affligent l’humanité c’est beaucoup moins, ce n’est aucunement l’imperfection de la nature de l’homme, mais l’imperfection du milieu social où il est plongé. Les hommes ne sont point misérables parce qu’ils sont immoraux, ils sont immoraux parce qu’ils sont misérables, et ils sont misérables parce qu’ils ne savent point combiner leurs efforts, parce qu’ils manquent d’un mécanisme qui leur offre tous les moyens de se développer et de jouir, sans se nuire réciproquement. Rechercher ce mécanisme, c’est s’attaquer à la difficulté réelle ; mais aussi le découvrir, c’est trouver la panacée sociale universelle. Voilà pourquoi Fourier y a consacré toute sa vie, et pourquoi il est intraitable lorsqu’on prétend transporter ailleurs le problème social et l’œuvre du siècle. Si l’on suppose alors un type d’homme naturellement sévère et inflexible on s’expliquera déjà surabondamment les déclamations de Fourier contre les philosophes, contre les économistes, contre tout ce qui fait la préoccupation ardente et exclusive des générations libérales de nos temps modernes.
En 1815, une de ces révolutions commerciales si fréquentes sous le régime de compétition anarchique, vint tarir l’industrie cotonnière de Lyon et fermer, par ricochet, la carrière du courtage au tenace penseur, qui se retira alors dans la petite ville de Belley en Bourgogne, emportant juste le pain quotidien pour quelques années au-delà. Il pouvait enfin se livrer à son penchant, sans entraves ni intermittences. Il se passa six ans dans le silence de l’élaboration et des études nourries ; après quoi deux volumes bien pleins furent achevés. Le solitaire de Belley se rendit à Paris en 1822 pour suivre l’impression ou la vente de son traité de l’association domestico-agricole [18], et tâcher de rendre les organes de la presse favorables à ce qu’il tenait pour très haute vérité et qui vraiment était curieux et neuf. Fourier joua de malheur et après beaucoup de démarches et de frais ne parvint pas même à se faire écouter et lire des journaux quotidiens : le Bulletin de Ferussac [19] fut la seule des revues périodiques qui s’identifia sérieusement avec ses idées et s’arrêta à une conclusion sincère et significative
............
[manquent ici les pages 12 et 13 du manuscrit]
...C’est dans ces volumes de 1822 qu’on trouve la description du Phalanstère, magnifique village, alvéole élémentaire de la société à venir, suivant lui : Fourier s’efforce d’y communiquer la vie à sa création favorite, en laquelle, à la vérité, se résout toute sa découverte. Sans cesse son imagination pose en relief devant lui un monde tout entier agissant et vivant, où il fait manœuvrer avec précision et harmonie les individus, les groupes et les séries ; heure par heure, il raconte les faits et gestes des 2000 habitants de son phalanstère sans vous faire grâce des plus infimes détails, comme on ferait de l’intérieur d’une famille où l’on a longtemps vécu. Ici il s’occupe de l’ordonnance de la cuisine et du potager, des moyens d’abriter les travailleurs dans les belles campagnes qu’ils cultivent par essaims joyeux et forts ; là, il prescrit les soins à prodiguer aux bambins, aux poupons, aux lutins et diablotins ; esquisse un nouvel Emile, s’attaque aux vices de l’Education, en fait d’autant mieux ressortir les incalculables suites qu’il leur oppose un idéal fort ingénieux auquel on serait tenté d’accorder une sanction anticipée, tant il semble naturel et simple, tant il promet d’être efficace et socialisant. Plus loin, son inventive pensée combine les relations multiples de la Bourse, les plaisirs plus variés encore de l’Opéra, les exercices hygiéniques, ou donne le plan du Phalanstère et ses devis, et vous fait apparaître une terre couverte de ces palais improvisés, d’armées industrielles voyageant en magnifique apparat, creusant des canaux, établissant des routes, abaissant les monts et comblant les vallées d’un hémisphère à l’autre ; enfin des troupes plus brillantes encore d’artistes allant rivaliser de talent et d’exécution avec les divers centres des beaux-arts répandus par tout le Globe...
Si ce n’était là qu’une création fantastique, à l’imitation des rêveries de Platon, de Thomas Morus, de l’auteur des Mille et Une Nuits, où l’on fait les hommes souvent à l’image de Dieu et toujours à l’image de ce qu’ils ne sont pas, il y aurait à peine de quoi écouter et souffrir ; mais l’imagination est ici servile et enchaînée ; elle doit obéir à la précision desséchante des mathématiques, à une psychologie toute vulgaire, à des relations préétablies.
Quoi qu’il en soit, le plus beau titre de Fourier est d’être parvenu à absorber ou à tourner dans sa création, les problèmes les plus difficiles de l’Economie Sociale. Sans pouvoir se former une croyance à cet égard, sans affirmer ce que l’expérience pourrait seule garantir, il faut dire en témoignage du génie que du moins il a su rendre dans sa théorie, les plus beaux résultats assez plausibles pour qu’on se fasse conscience de la livrer impitoyablement à l’oubli. Dans un Phalanstère (du moins en expectative) l’équilibre de la population, qui fait le désespoir des économistes et des philanthropes contemporains, s’opère sans contrainte ; la paresse n’a plus de motif ; le vol, par incroyable, devient un moyen d’ordre ; le mensonge, nuit instantanément au menteur dans sa fortune et sa considération ; le cumul, les emplois inutiles, le parasitisme commercial, administratif, scientifique, agricole, industriel ou domestique n’a plus de sens ; la misère est extirpée, la concentration comme le morcellement des propriétés sont tournés, au profit des propriétaires et des prolétaires ; la famille est maintenue, fortifiée dans ses liens ; la propriété est respectée et la loi agraire n’a plus de chances, car tous se trouvent propriétaires par l’action qu’ils ont sur le phalanstère, ou voient devant eux la continuelle faculté de le devenir ; la mobilisation du sol est réalisée au grand avantage de ceux qui possèdent et chacun peut se transporter, lui, les siens et ses richesses, où bon lui semble ; la production est mise en constante proportion avec la consommation et donc les crises commerciales ont cessé. Les riches restent riches et augmentent facilement leurs richesses ; les pauvres, appuyés sur un minimum décent, s’avancent rapidement vers le bien-être et la considération ; car ils ont, avec les plus riches, l’égal moyen de s’instruire et de se développer et grâce à l’intérêt personnel même qu’y trouvent tous les membres de l’association sans exception, nulle fonction n’est interdite à la capacité. Il y a inégalité de fortune mais il y a justice : c’est-à-dire équitable distribution des bénéfices suivant la mise en capital, en talent et en travail. Chacun pour les plaisirs et les travaux se groupe suivant ses affections et sa fantaisie ; chacun conserve son individualité et ses caprices de goûts et de penchants ; l’individu a son intérieur, son intimité, son sanctuaire ; il est servi chez lui ou en compagnie de choix libre. La femme se possède sans pour cela se métamorphoser en une monstrueuse virilité ; donne ses soins et sa tendresse à son enfant et jouit de ses caresses à telle heure qui lui plaît, comme le peuvent faire aujourd’hui les femmes privilégiées ; comme elles aussi, elle a son enfant sous sa protection et son active vigilance et cependant elle est délivrée, si c’est pour elle un mal, des embarras vulgaires de la maternité. La femme s’unit à l’homme par affection et liberté entière ; la considération de la fortune n’est plus ici que très secondaire ; car le travail est pour elle un attrait et une habitude, et par le travail, elle s’ouvre, comme l’homme, des voies d’indépendance et de sécurité matérielle. Si l’incompatibilité sépare les époux, les enfants sont garantis contre les suites ordinaires du divorce ; car l’enfant aussi, dans le Phalanstère a son minimum, un travail varié et à sa portée dès l’âge de 6 à 7 ans et un bénéfice dans le dividende sociétaire ; enfin, son chemin se peut faire, à la rigueur, indépendamment de la condition sociale et des ressources de ses parents.
Le principe de l’hérédité des propriétés est consacré et se trouve compatible, dans ce milieu, avec la justice, la liberté, l’harmonie. Nul goût, nulle affection, nulle passion naturelle n’y est violentée ou comprimée et quoique le mouvement perpétuel semble être l’état habituel d’un Phalanstère, on y a pourvu à ce que le repos soit facultatif [20] et ne trouble point le mécanisme, mais il ne saurait plus dégénérer en besoin permanent, devant les plaisirs variés et toujours nouveaux qui sollicitent l’activité de l’homme ; Fourier, en écartant toute possibilité de monotonie, a tué l’oisiveté et l’ennui.
Une économie prodigieuse dans toutes les branches de production, de transport et de consommation est la suite nécessaire du ménage sociétaire, du procédé industriel, de la distribution architecturale des ateliers, de l’aménagement des cultures et du mode de circulation des produits entre les Phalanstères. La Domesticité, cet autre nœud-gordien de l’Economie Sociale est supprimée et pourtant chacun se voit servi dans ses besoins : c’est l’affection jointe à l’intérêt qui porte librement les individus à se servir mutuellement, chacun dans les objets qui sont le plus dans sa vocation. Quant aux travaux répugnants, toutes choses sont prévues pour que certains caractères se trouvent naturellement portés à les accomplir.
La Division du travail, si funeste aujourd’hui au corps et à l’âme de l’ouvrier, dans ces grandes manufactures que Fourier appelle les bagnes de l’Industrie, cette disposition malheureuse est également évitée dans le Nouveau-Monde [21]. Les générations s’initient dès l’enfance à toutes les industries pour lesquelles l’individu se sent attrait ; car, outre l’utilité économique et sociale qui résulte de l’exercice intégral des facultés, l’hygiène réclame cette variété pour maintenir le corps en santé. La disposition des ateliers et la combinaison des efforts sont ensuite telles que chacun peut passer d’une fonction à une autre sans perte de temps et ne consacrer que 2 ou 4 heures suivant son plaisir à chaque spécialité qu’il connaît.
Voilà quelques-uns seulement des résultats sociaux de la création phalanstérienne et cependant ceux qui lisent Fourier sont rares et plus encore ses admirateurs. Qu’y a-t-il donc contre lui ? Il y a le doute sur bien des points ; il y a des lacunes inséparables de l’imperfection même des hommes-génies ; il y a la vie réelle du siècle qui l’absorba et le détourna ; il y a surtout pour nos imaginations, un vernis d’utopie et en même temps quelque chose de matérialisant qui rembrunit le ciel parfois si beau de ce nouveau-monde et semble dessécher dans l’âme l’élément moral, cette éternelle fleur de vie, de grandeur et de contentement intime.
La bonté intrinsèque d’une conception sociale dépend absolument de l’idée qu’on s’est faite de la nature de l’homme. Fourier est parti de cette hypothèse que les passions, les goûts, les penchants naturels sont incompressibles, incontrôlables, inéducables et qu’ils doivent être pour le législateur le fanal qui lui révèle la tendance des individus et des sociétés. Les passions, suivant lui, sont légitimes dans leur essence ; on doit obéir à leurs impulsions naturelles, instinctives et nulle autorité d’homme n’a le droit d’intervenir pour les contraindre, les diriger par la moralisation et enfin les assouplir aux circonstances extérieures par l’idée et l’habitude matinale du devoir. Il s’agit uniquement de trouver un ensemble de combinaisons qui réalise l’équilibre et l’harmonie des passions non seulement dans l’individu mais dans la société et le globe entier. Ce doit être par conséquent un vaste mécanisme social extérieur à l’homme, qui offre à son système passionnel, ici une force impulsive, là un contre-poids, plus loin une soupape de sûreté, autre part un engrenage, partout le mouvement, l’essor et la vie : c’est ce que Fourier appelle mécaniser les passions.
Dans un tel organisme tout mouvement de l’âme doit être prévu ; toute impulsion instinctive satisfaite directement ou indirectement car on n’a plus la contrainte morale à son service, ni les idées de sacrifice. Il faut que l’intérêt individuel trouve sa satisfaction en même temps qu’il opère le bien collectif ; sinon l’ordre social est troublé, l’ingénieux et vaste mécanisme fonctionne mal ou s’arrête, et nulle puissance n’y peut porter remède. Ce mécanisme ne comporte donc point l’imperfection et doit correspondre aux combinaisons possibles des mouvements de l’âme dans le temps et dans l’espace, ou avoir recours à la loi coercitive et progressive d’un pouvoir humain.
A voir ces hardiesses de Fourier on ne s’étonnera point qu’il ait poussé sa doctrine sur la passion jusque dans ses plus hautes conséquences. De même qu’il légitime et veut satisfaire les passions naturelles, il légitime et veut satisfaire les différences naturelles des caractères. Fourier compte dans l’espèce 810 caractères bien distincts et donne à la classification la plus grande importance. Suivant lui, ce qui distingue les hommes entre eux et déroute si souvent la science, ce sont les passions différentes qui dominent en chacun d’eux, non la nature et le nombre de leurs passions qui sont les mêmes pour tous. Les caractères ordinaires n’ont guère qu’une ou deux passions dominantes : les grands hommes, en général, ces esprits subtils, actifs, étendus comme Voltaire, Leibnitz, Fox, Bonaparte, Frédéric, César, manifestent jusqu’à 5 à 6 passions qui veulent une activité simultanée. Or, les grands caractères, la Civilisation n’est point assez large pour les comprendre. Voilà pourquoi presque tous les grands hommes s’irritent contre les institutions, trouvent partout des préjugés, condamnent la morale qui les perpétue et s’agitent convulsivement toute leur vie, dans ce milieu qui les étouffe. Voilà pourquoi pareillement les natures énergiques, ou grandement désireuses, braventl’opinionetles lois, s’élancent au crime etdeviennentcescélèbresbrigandsdont le type est dans le héros de la Calabre. Si Byron devint excentrique, c’est que la circonférence du mouvement social où il s’agitait avait à peine le pourtour d’un cirque pour son œil cosmopolite ; s’il se jette dans le doute et les écarts et dépense une grande puissance de poésie en imprécations et en délire, s’il fuit le ménage à deux et forfait à la morale par ses inconstantes amours, c’est que l’édifice social n’a pas été mesuré à sa taille, c’est que les irrésistibles passions mises en son âme par Dieu, ne pouvant se développer qu’une à une et s’équilibrer par la variété, se sont abreuvées solitairement jusqu’à la satiété et l’ennui. Si les grands conquérants, Napoléon, César, Tamerlan, Gengis-Khan, ravagent et désolent la terre, c’est qu’ils étouffent aussi entre les frontières de leur Empire et n’ont point à leur activité un rôle pacifique digne d’eux. De même si Néron se délecte dans le sang de ses semblables, c’est qu’il est comprimé dans des instincts profonds qui ne sont nullement l’homicide, et les infernales débauches. Toutes ces fortes natures qui, à divers titres, deviennent les fléaux de l’humanité, déposent donc perpétuellement, par la fatalité où la Civilisation les pousse, contre nos idées sur la morale, en marquant la fin véritable de l’Etat social : c’est-à-dire l’association universelle, et le développement entier des passions et des facultés.
Tel est précisément le but de Fourier. Les grands caractères peuvent naître, pour leur bonheur et pour celui de l’humanité. Ils ont le globe pour théâtre, et partout un aliment sans fin à leur ambition. Hommes et femmes-génies, savants et artistes, votre poitrine peut enfin se dilater. Plus d’obstacles à votre élan ; vous êtes livrés à vos propres ailes. La Couronne impériale a relevé sa tête et si de belles larmes humectent encore son calice, le triste symbole s’est transformé, ce sont les larmes du bonheur. Parlez-vous la langue des Dieux, vos chants sont entendus, répétés et récompensés par toute la terre. Les Rossini, les Boëldieu, les Beethoven ont à volonté pour auditoire l’Europe ou l’Asie et si un grand secret de la nature vous est révélé, l’humanité entière entrera aussitôt en partage de ses bienfaits. Cependant vous êtes comblé de richesses : chacune de vos œuvres vient en rivalité avec celles de vos pairs sur tout le globe ; vos titres sont débattus et vos mérites appréciés dans chaque phalanstère par des juges compétents. Un suffrage universel décide de vos victoires et chacun contribue, selon que vous lui avez donné de plaisir, pour une somme qui, fut-elle d’une obole, vous vaudrait encore une brillante fortune.
Les femmes aussi dans la création de Fourier, reçoivent une universelle émancipation ; c’est un axiome pour l’intrépide novateur que les femmes ne peuvent être nées pour soigner à jamais le pot-au-feu. Il persiste à croire que plus d’une passion cosmopolite domine en leur âme ; qu’il faut à leur intelligence et surtout à leurs sentiments un théâtre quelque peu plus large qu’un boudoir ou même qu’un salon. Dans l’harmonie phalanstérienne il élargit en conséquence leur existence, et leur permet de briguer, à l’égal de l’homme, la gloire sous toutes ses faces. Là une Mme de Staël ne sera plus réduite à se repaître de fiction ; à monter sous le voile de Corinne sur un Capitole désert pour entendre ces acclamations si douces à son oreille. Elle pourra s’inspirer en toute réalité devant une foule immense et chanter comme on chantait aux Jeux Olympiques. Là aussi, on ne verra plus les Maintenon s’anéantir dansles angoisses et l’ennui au sein des palais des rois ; et les Ninon de Lenclos s’y concevront un rôle digne de leur beauté, goûtant enliberté, sans scandaliser, ni corrompre, toutes les joies que recherche leur coquet instinct. Dans son Instruction pour les dames [22], Fourier se montre tout pénétré de la nécessité de substituer les amours, les roses et les œillets à ses dissertations transcendantes, s’il veut amener les femmes à lire au moins un de ses chapitres. Il se promet en conséquence de ne parler au beau sexe, dont il se fait en toute occasion le sérieux défenseur que du parfum des fleurs, et du roucoulement des tourterelles, et prend pour texte les allégories végétales et animales. Pour Fourier, comme on l’a vu, partout la nature, murmure ou retrace emblématiquement nos passions. Déjà le langage de certaines fleurs est compris de tout le monde : telle la rose. L’analogie de l’épine qui blesse légèrement le ravisseur ; la demi-éclosion, symbole de la pudeur, l’insipidité d’une rose bien épanouie ; et l’odeur de celle qui est encore à demi-fermée, n’ont plus guère besoin d’interprétation scientifique. L’incarnat des pétales est bien, pour tous, l’emblème des couleurs du bel âge ; l’affection de la plante pour les lieux frais, reporte naturellement l’imagination vers la fraîcheur de la jeunesse ; et son parfum qu’on appelle mal à propos doux parfum des roses, est un arôme qui enivre comme fait l’amour d’une jeune fille vraiment pudique. « Rien n’est simple dans ses accessoires : calice très orné, feuille parfumée et dentelée avec délicatesse, tout est charmant et soigné dans ce petit arbuste, parce qu’il représente non pas la bergère grossière, simple et champêtre, mais la jouvencelle élevée dans le luxe, habituée aux bienséances et rehaussant les dons de la nature par les secours de l’art. »
Mais ce ne sont là que des pressentiments ; ce n’est pas la science de l’analogie. Fourier prétend pénétrer plus avant. Suivant lui toute portion d’une plante aurait un sens symbolique des passions. Ainsi « la racine serait l’emblème des principes qui règnent dans l’essor de la passion représentée ; la tige, l’emblème de la marche que suit la passion ; la feuille, l’emblème du travail de la classe ou de la personne représentée ; le calice, l’image des formes dont s’enveloppe une passion », et ainsi de suite. L’œillet, qui, pour les écrivains amateurs, n’a été jusqu’ici qu’une énigme impénétrable, représente pour la science un être gorgé d’amour ; car le feuillage, la tige, le calice, tout le corps de la plante est plus près de l’azur que du vert ; or l’azur est la couleur symbole de l’amour ; d’où il est clair, dit Fourier, que l’œillet dépeint un être qui ne respire qu’amour, que l’amour obsède et affaiblit. Aussi voyez comme l’œillet, son emblème tombe, et traîne à terre sa tige élégante. Il faut qu’une main amie vienne le soutenir et l’appuyer à un tuteur. Telle, la jeune fille trop longtemps négligée : elle succombe comme l’œillet. Le besoin d’être aimée surmonte en elle tous les obstacles du préjugé, et par analogie l’œillet dans un calice gorgé de pétales, crève son enveloppe laissant tomber ses pétales, symboles de plaisir. S’il en est ainsi l’œillet est mal nommé, il devrait porter un nom féminin. Mais ce n’est pas tout : pourquoi la découpure est-elle placée, dans les roses, sur les feuilles, et, au contraire, dans l’œillet, sur les pétales ? Pourquoi l’épine se trouve-t-elle sur les tiges du rosier, tandis qu’elle est placée, dans l’œillet, à la pointe des feuilles terminées en piquants : Fourier ne l’explique point, quoiqu’il le sache. Seulement il nous apprend que ces dispositions sont autant d’emblèmes de l’amour et de l’éducation chez les jeunes filles opulentes : car pour ce qui est de la pauvreté, quand la nature veut en offrir l’image, elle en place les tristes symboles, comme le buis et le genêt, dans les terrains les plus ingrats et les plus dédaignés ; mais si une fleur ou un fruit figure au corset des petites maîtresses ou à la table des sybarites, croyez que ces végétaux sont les emblèmes exclusifs de la classe riche. Et voulez-vous savoir pourquoi la fleur de lys barbouille de son pollen les nez imprudents qui veulent en respirer l’odeur, c’est que le lys est symbole de la vérité et que la nature semble dire par là à l’homme attiré par cette fleur : Défie-toi de la vérité, ne t’y frotte pas. Et de même que pensez-vous que le célèbre voyageur Levaillant a importé parmi nous, quel don croyez-vous que le Dey d’Alger fit autrefois à Charles X, l’un en rapportant une girafe empaillée, l’autre en envoyant au jardin du roi une girafe vivante, ils ont naturalisé en France l’hiéroglyphe animal de la vérité. Cet animal, tout le monde le sait, élève son front au dessus de tous les autres. C’est que le propre de la vérité est de surmonter les erreurs.
« La girafe, dit un vieil auteur, est moult belle, douce et agréable à voir. La vérité aussi est moult belle, mais comme elle ne saurait s’accorder avec nos usages, il faut que la girafe ne soit d’aucun emploi dans nos travaux. Dieu l’a donc réduite à la nullité par une démarche irrégulière qui agite et froisse le fardeau qu’on lui impose. Dès lors on préfère la laisser dans l’inaction, comme parmi nous, on écarte des emplois l’homme véridique dont le caractère heurterait tous les usages reçus et toutes les volontés. La vérité chez nous n’est belle que dans l’inaction, et la girafe par analogie n’est admirée que lorsqu’elle est en repos ; mais dans sa démarche elle excite les huées, comme la vérité excite les huées quand elle est agissante. »
Et si vous voulez consulter l’auteur, il vous démontrera en poursuivant que Dieu n’a rien créé d’inutile, même dans la girafe. L’Iris et ses variétés sont affectés aux mariages des diverses classes de la civilisation. L’iris papillon représente le mariage des jeunes amants ; l’iris de muraille celui des pauvres paysans ; l’iris bleu un mariage bourgeois ; l’iris jaune et d’azur celui d’amants opulents ; enfin l’iris gris colossal, celui des princes. Ne vous récriez donc plus sur le lugubre aspect du grand iris piqueté de noir, sur ses pompeuses couleurs de deuil sans parfum, ni coloris. Ne voyez-vous pas que ce contraste de luxe et de tristesse était nécessaire pour allégoriser les unions royales d’où les convenances sont exclues jusqu’à marier les princes et les princesses sans s’être jamais vus. Remarquez ensuite, que l’Iris en général, porte trois chenilles sur ses trois pétales ; or pouvez-vous voir dans une chenille autre chose qu’un symbole de vice. L’Iris fournit successivement deux corolles ou fleurs qui semblent s’éviter et s’isoler l’une de l’autre. La seconde longtemps cachée, apparaît inopinément dès que la 1ère est passée : voilà bien l’image pure et simple du lien conjugal où un homme presque suranné se marie à une jeune femme. La corolle d’Iris paraît formée de trois fleurs distinctes et réunies forcément par leurs extrémités. Vous avez là le pénible amalgame des trois affections distinctes qui cimentent le mariage : le bleu terne, c’est l’amour matériel simple ; le violet faux, c’est la ligue domestique ; le jaune, la paternité...
Fourier vous démontrera avec autant de fidélité et de sérieux que la Balsamine est le portrait de l’égoïste industrieux ; que l’Hortensia symbolise la coquette prodigue, et la Couronne impériale les savants et les artistes dans nos sociétés civilisées. Cette dernière fleur excite un vif intérêt par l’accessoire de six larmes qui se trouvent au fond du calice. 0n s’en étonne : il semble que la fleur soit dans la tristesse ; elle baisse la tête et répand de grosses larmes qu’elle tient cachées sous les étamines. Cette fleur porte en bannière, au haut de la tige, une touffe de feuilles, signe de l’industrie. Voilà bien encore l’image des savants utiles qui gémissent, en secret, obligés qu’ils sont de fléchir devant le vice heureux, voilà le symbole de la haute et noble industrie des sciences et des arts ; « du sort des artistes qui font l’ornement de la société et n’en sont payés que par des dégoûts, tandis que les agioteurs amoncèlent des trésors en quelques instants ».
Si l’hortensia étale force parure, plus de feuilles que de fleurs, c’est que pour être fidèle elle doit donner dans le même excès que la coquette qui voudrait consommer en colifichets toute la fortune du ménage. L’hortensia n’exprime encore que les sentiments de la coquette, lorsqu’elle cache ses feuilles sous un fatras de fleurs inodores et à demi-nuancées de teintes ambiguës. Tandis que celle-ci ne connaît qu’un amour superficiel, une demi-amitié, une fausse pudeur, l’hortensia n’étale que l’argentin, le lilas et le rosat. Cette fleur devait aussi simuler la coquette dans le grand monde ; c’est pourquoi, mise en pots, elle figure à merveille dans les salons et les jardins, et ne peut s’employer, ni coupée, ni en bouquets. Si l’hortensia n’a pas de parfum, c’est que la coquette éblouit les yeux et fascine l’esprit sans trop gagner les cœurs. La coquette se ruine par le luxe, et l’hortensia par analogie craint l’astre du luxe : « elle périt d’un coup de soleil... » Si nous nous bornons à ces exemples, ce n’est pas que l’auteur des analogies soit aussi limité. C’est que sa fécondité nous désespère. Il a par devers lui, sur les seules analogies végétales, la clef de 40 000 emblèmes !... Ainsi tout dans la nature est symbole et poésie pour l’imagination en apparence si sévère de Fourier, tout, la poire, la pomme, la pêche, la fraise, les cerises, etc... Ce dernier fruit suggère à l’auteur un tableau de joies enfantines qui contraste singulièrement avec ses spéculations ordinaires. « La cerise, dit-il, image des goûts de l’enfance est le premier fruit de la belle saison. Elle est dans l’ordre des récoltes ce que l’enfant est dans l’ordre des âges. C’est ensuite le portrait des enfants libres, heureux et badins ; et elle excite en eux les effets qu’elle représente. Aussi l’apparition d’un panier de cerises, met-elle en joie tout le peuple enfantin à qui ce fruit est très salutaire. La cerise est un joujou que la nature présente à l’enfant, il s’en forme des guirlandes ; des pendants d’oreilles ; il s’en couronne comme Silène se couronne de pampres. L’arbre est analogue au génie et aux travaux de l’enfance ; il est peu fourni de feuilles ; ses branches vaguement distribuées donnent peu d’ombrages, ne garantissent ni de la pluie ni du soleil ; image des faibles moyens de l’enfance il est incomplet, insuffisant à protéger et à abriter l’homme. »
Le style de Fourier est âpre, inégal, souvent vulgaire et la sécheresse mathématique y domine. Sa phrase a tantôt la concision de la logique et l’aplomb de la vérité absolue ; tantôt l’allure traînante et gonflée de la déclamation, tantôt la rudesse de l’invective, mais presque toujours elle est pleine d’idées et porte en elle ce je ne sais quoi qui en fait naître mille autres qu’il ne dit pas. Peu étudiée, elle laisse couler ses émotions sans voile aucun Quant à la pensée, c’en est la contre-épreuve nette et franche. Ses mouvements éloquents sont rares, mais c’est l’écrivain le plus condensé, le plus fécond en pensées radicales, en points de vue originaux ou bizarres et le plus hardi des temps modernes. Sa tête est si forte et si pleine qu’on dirait un vivant panorama de l’univers, sa vue si étendue, qu’il aperçoit l’ordre où d’autres ne démêlent encore que confusion, une lumière vive où vos yeux voyaient à peine quelque clarté poindre. Nous ne rappellerons pas ses fréquentes redondances, sa distribution désespérante et ses digressions sans fin qui en font en somme un écrivain épineux, accessible seulement à qui cherche la vérité pour la vérité.
Mr Fourier nous a fait part d’une observation sur les femmes, que chacun, en cherchant dans ses souvenirs croira avoir fait soi-même. Jamais dans ses entretiens avec les hommes, il ne lui est arrivé d’en recevoir une inspiration neuve ou profonde sur le cœur humain, tandis que les femmes souvent lui ont suggéré de précieuses lueurs. Il se plaît à l’expliquer ainsi : les hommes ne se livrent plus guère à leur spontanéité que sous l’invocation du divin Platon, du divin Rousseau, et en général du grand homme leur favori ; si une difficulté se présente ils recourent au grimoire de la Science. Les femmes, au contraire, leur ignorance les sauve, ainsi que leur affectif instinct. A coup sûr leurs confidences révèleraient aujourd’hui plus de vérités psychologiques importantes que celles des hommes, qui peuvent tout dire, mais qui ne savent plus dire. Fourier cherchait depuis longtemps à compléter l’énumération des 810 caractères que sa théorie assigne a priori à l’humanité, quelques aveux naïfs surpris à une femme les lui révélèrent. Voici un autre hasard où la femme est encore l’occasion, mais qui ne tient plus à sa vertu prophéto-magnétique, et que nous donnons seulement pour achever de caractériser la rigueur et la portée que Fourier accorde à sa théorie. Il venait de déterminer, toujours a priori, le nombre des os qui doivent constituer le squelette humain, ou du moins que la vie physiologique de l’homme doit produire dans son état normal ; malheureusement la vérification lui donnait un déficit de 28 os. Grande était sa surprise : il recourut aux anatomistes qui lui conseillèrent, afin de conformer l’homme à sa théorie, d’en créer une nouvelle espèce avec 28 os de plus, l’homme actuel étant sans doute défectueux. Fourier, cependant, demeurait sur le qui-vive. Un jour, en compagnie, il entendit à ses côtés de bonnes mères de famille s’entretenant de la dentition douloureuse de leurs enfants, et l’une d’elle [sic !] affirmant que le nombre de nos dents, y compris celles que l’on perdait dans l’enfance montait en général à 60 ; or Fourier n’avait compté que 32 dents : le surplus jusqu’à 60 lui donnait ses 28 os manquants.
En 1830, lorsque les St-Simoniens se faisant entendre, arrachaient à de jeunes cœurs une réclamation et un enthousiasme passagers, l’auteur du Phalanstère s’adressa aux Pères Suprêmes, mais soit aveuglement, soit préoccupation jalouse de l’ambition heureuse, il fut éconduit par l’esprit nouveau comme il l’avait été 30 ans par le routinier, Fourier aurait bien dû croire aussi à une mauvaise étoile, mais Fourier n’est point enclin aux superstitions, ou s’il en a, elles sont à lui et n’ont rien de vulgaire. Il ne s’est point démenti dans son courage, mais l’aigreur devait s’infiltrer sensiblement en lui et devenir l’état habituel de son caractère. Fourier a vécu solitaire inconnu. A peine a-t-il fréquenté quelques savants. En aucun temps il n’a été d’aucune académie, d’aucune secte, d’aucun parti. Sa croyance est de lui à Dieu et de lui à lui ; et il est de son propre parti. Toujours voisin de la pauvreté sans jamais la subir, il a dû détourner la moitié de sa vie pour trouver un salaire à l’autre. La Révolution de Juillet le trouva, je crois, correcteur dans une des imprimeries de la capitale. On conçoit combien un si grand contraste entre ses capacités et sa situation a dû flétrir certaines de ses facultés. Dans la solitude et l’oubli, on ne contemple point impunément toute sa vie, ses idées, ses griefs et ses titres à la gloire. La lutte, à soi tout seul, c’est le néant ; et le néant rouille l’entendement, altère ou dessèche la sensibilité. Fourier vous paraîtra avec ses 63 ans possédant la même suite de jugement, le même sentiment des maux de la société et surtout des classes pauvres, mais ce simple bon sens qui fait l’aptitude et en quelque sorte le génie de la foule, Fourier semble l’avoir perdu. En vous parlant, il ne sait plus à qui il a affaire, distinguant peu entre un homme et un homme. Son tact s’est usé au vif et lumineux reflet qu’il a eu autrefois du monde réel et son génie n’est plus que dans les livres ; je me trompe, il est encore en lui, car ses livres sont tout entiers dans son imaginative mémoire : Ils y sont jusqu’au point d’empêcher tout ce qui n’est pas eux d’y pénétrer.
On trouverait difficilement une originalité contemporaine plus digne de l’observation de ceux qui cherchent la vérité ou qui aimeraient à voir, pensant et parlant, un habitant d’un autre monde, un voyageur revenant d’explorer un troisième continent. Cette tête, tout à l’heure blanche et courbée, vit presque à la lettre dans l’avenir. Nul doute qu’il n’y ait aujourd’hui pour l’imagination de Fourier deux mondes antipodes où il voit s’agiter également les hommes, les uns dans le chaos, les autres dans une radieuse harmonie ; les uns soumis aux sept plaies de l’Egypte, les autres se répandant heureux et beaux, brillants et sains, dans un autre Eden ; puis revenant s’abriter, après l’action productive, sous de magnifiques palais, au sein des bals, des fêtes et des féeries de l’Opéra, cultiver bruyamment les beaux-arts ou spéculer en silence sur les éternelles vérités. L’illusion serait complète à deux pas de Fourier, si cette puissante apparition ne se faisait dans un galetas de Paris. Dans l’une des plus laides maisons [23] de notre belle capitale, au troisième, par un escalier obscur et misérable, aux murs grisâtres et dégradés on arrive à une chambre sombre, saturée de fumée dans ses boiseries et au plafond ; vous ouvrez : la porte est trouée, la serrure mal affermie, les carreaux rouges sales et défoncés, le plancher inégal, et Fourier pose au milieu de ces ruines entouré d’autres ruines vénérables. Là, il songe, il espère, il attend, il demande à sa verve d’autrefois encore un jet ; à son génie encore une flamme ; à son âpreté contre la civilisation encore des invectives et des anathèmes. Semblable aux saints du désert, que la contemplation solitaire exultait et rendait plus fervents en Jésus, Fourier a nourri sa foi dans la retraite et l’oubli, sans jamais la sentir décroître. Fourier était né trop grave pour s’abandonner aux tristesses désordonnées de la faiblesse qui doute ; il porte trop de positif dans l’esprit pour se livrer aux joies délirantes du génie qui se sent : Cependant sa foi en son œuvre lui donne de touchantes illusions. Il croit à la transformation si subite du monde, une fois l’essai du phalanstère consommé, qu’il n’assigne que cinq ans pour l’introduire parmi les peuples les plus divers et que, dans son impatience, il harmonise, d’un trait de plume, les Européens et les Chinois, les Hottentots, les Hurons et les Kamstchadales.
En 1831, la décadence rapide de la religion Saint-Simonienne reporta l’ardeur des esprits novateurs vers Fourier ; et alors commença pour la première fois, la véritable publicité de ses idées, dans un organe spécial périodique intitulé : « La réforme Industrielle » : il vit des disciples assez nombreux l’entourer, dont plusieurs ont vulgarisé ou développé ses écrits, dont d’autres se sont fait entendre dans des cours publics, à Paris et en province. Quelques-uns même l’ont fait connaître en Angleterre, à Alger ; il a vu s’approcher quelques capitalistes-philanthropes qui ont essayé d’appliquer séparément quelques-uns des moyens économiques du phalanstère, dans la grande ferme de Condé-sur-Vesgres : les journaux de province l’ont annoncé et suffisamment propagé pour que ses idées fructifient si elles en ont la vertu. Il a convaincu des esprits avancés et en a même fanatisé quelques-uns ; à l’instant, en Allemagne, ses partisans proposent l’application de son procédé industriel comme le seul remède aux crises commerciales et politiques. Enfin on lui adresse de la Suisse un cachet d’or en témoignage d’admiration, et l’on fait exprès le voyage de Paris pour le voir en personne.
Est-ce là l’aurore tardive d’une célébrité cosmopolite pour le génie en décrépitude ; ou bien n’est-ce que le court crépuscule d’un soleil couchant ? N’aura-t-il été rien pendant 60 ans, pour être plein de gloire quelques heures avant sa mort et expirer sous les roses et les lauriers ? Nous ne savons ; mais Fourier reste confiant dans son idée fixe : il lui paraît infaillible que l’harmonie se réalise tôt ou tard et, en attendant que l’écho de l’admiration publique murmure suavement à son oreille, comme tous les hommes forts qui se croient méconnus, il se contente d’écouter en lui-même.
