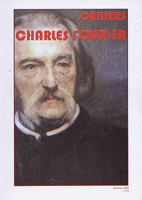
Charles Fourier : action sociale, lien social et création d’espace (colloque de Besançon, 18 et 19 mars 2004)
Dans le cadre d’un PPF « Ville, cité, territoire » et à la suite d’un colloque consacré en 2003 à Proudhon, nous nous sommes proposés cette année de réfléchir sur la pensée de Fourier. Penseur mis au rang des utopistes, Fourier n’a jamais cessé de revendiquer contre les utopies la dimension pratique et réalisable de son système. Sa pensée, quand elle est une critique de la philosophie, lui reproche de n’avoir jamais envisagé la mise en action de ce qu’elle pouvait développer de théorie. C’est vers une pensée de l’action que Fourier dirige son système qui se veut une politique envisageant les conditions de l’action sur le monde en vue de sa subversion. Fourier fonde tout d’abord sur une pensée de l’action sociale ce qui devient Le Nouveau Monde industriel et sociétaire. Ce traité envisage les conditions d’accès à un mode de relation social défini comme sociétaire. Articulé sur une critique de la Civilisation, sur une mise en avant des passions et sur une redéfinition des institutions comme la famille et l’école, la pensée de Fourier dégage une étrange ambiguïté où la critique du monde réel se déploie en offrant les antidotes sociétaires. Mais en même temps qu’il dessine les contours théoriques de ce nouveau monde, Fourier en envisage les fondements pratiques dans ce qui devient une redéfinition de l’espace social, que celui-ci soit vu comme un lieu théorique ou dans sa réalité. C’est dans cette discussion qu‘apparaît le Phalanstère, à voir certes comme une cité idéale, mais aussi comme un laboratoire d’expérience. Les Dispositions de la phalange d’essai sont bien à comprendre comme les bases de la théorie devenant action. Elles montrent l’importance de la gestion du lieu en vue de la gestion des gens. Et si on a pu reléguer Fourier dans une poétique exclusion en en faisant un doux rêveur, il n’empêche que c’est sans doute un des rares philosophes à avoir pu susciter un mouvement politique articulé autour de la tentative de réalisation du monde sociétaire. Considerant est élu représentant du peuple comme fouriériste et tente la réalisation de la phalange d’essai ; Godin, industriel, décide la construction d’un familistère en se référant de même à Fourier ; l’école sociétaire accompagne et prolonge le travail de Fourier ; de nombreux aventuriers politiques s’essaient, à travers le monde, à matérialiser les théories phalanstériennes. En même temps ce qui se donne comme une politique trouve des débouchés dans le domaine esthétique. Sans doute la manifeste adhésion de Breton y est-elle pour beaucoup, et ce qui est certain c’est que les redéfinitions de soi que s’est imposé l’art du XXe siècle font du discours sociétaire un de ses axes.
Le colloque, organisé par le Laboratoire de recherches philosophiques sur les logiques de l’agir [EA2274] en relation avec l’UMR CNRS 5605 [Université de Bourgogne] et le Laboratoire des Sciences historiques UA 2273 [Université de Franche-Comté], avec le soutien de la MSH de Franche-Comté, a essayé de parcourir les trois axes dessinés de la philosophie, de l’histoire et de l’esthétique. Sur ce dernier les contributions de Bruno Péquignot [Fourier, une représentation significative des artistes et des savants], de Roger Bruyeron [Espace utopique, espace cinématographique : Fourier précurseur du cinéma ?], de Michel Giroud [Fourier et les avant-gardes] et de René Schérer [Fourier dans les villes], montrent la singularité et l’originalité de la pensée de Fourier dans le domaine de l’art, ce que renforce l’exposé de Robert Damien [Zola, lecteur de Fourier]. Le cinéma, l’urbanisme, les arts plastiques, le statut de l’artiste et la littérature sont autant de champs dans lesquels l’apport de Fourier est remarquable. Dans le champ historique les exposés de Thomas Bouchet [L’Ecole et l’Assemblée, France 1848-1849], d’Ivone Gallo [le Phalanstère de Sai : une esthétique ouvrière au Nouveau Monde], de Jean Fornasiero [Arthur Young ou le globe-trotter du phalanstère], de Bernard Desmars [Espaces et lieux du militantisme fouriériste dans la seconde moitié du XIXe siècle] de Pierre Mercklé [La science sociale, une sience expérimentale ? Le phalanstère comme laboratoire], ou encore de Martin Stohler [Victor Considerant, Karl Bürkli et la création d’un espace politique] viennent montrer l’influence réelle et marquante de Fourier sur les faits et dans le monde. Quant aux philosophes, c’est sur le mode comparatif qu’ils l’ont abordé avec Sébastien Pasteur [Proudhon-Fourier] ou Hervé Touboul [Fourier-Marx : passions], sur celui de la machine à penser avec Alain Pessin [espace et utopie], Michèle Madonna-Desbazeille [La neutralité 1/8 : règle de l’exception pour maintenir le mouvement] sur celui de l’influence avec Philippe Riviale [Godin, les socialistes et Fourier] ou Laurence Bouchet [Quels territoires pour les femmes ?].
En réunissant autour des problématiques ouvertes par Fourier des chercheurs français, australiens, brésiliens ou suisses le colloque a su montrer l’étonnante actualité de Fourier par-delà les frontières.
Louis UCCIANI
Soutenances de thèses
François GAUDIN, « Maurice Lachâtre (1814-1900). Portrait d’un éditeur et lexicographe socialiste », thèse de doctorat d’histoire, dir. Jean-Yves Mollier, université de Saint-Quentin-en-Yvelines, 5 octobre 2004.
L’homme est surtout connu pour avoir été l’éditeur français du Capital de Karl Marx, et comme l’auteur d’un Dictionnaire universel à fortes connotations anticléricales. Dans son travail, François Gaudin met aussi en lumière ses multiples liens avec les milieux fouriéristes de son temps : éditeur de Zoé Gatti de Gamond, il fut par ailleurs l’ami de Félix Pyat et surtout d’Eugène Sue, et il confia la rédaction de son journal bordelais au phalanstérien Eugène Tandonnet ; il fut de plus impliqué dans deux projets de réalisation concrète d’inspiration largement fouriériste, la constitution d’une commune modèle à Arbanats (Gironde) et la construction des Immeubles industriels (dans la rue du même nom à Paris). Il est à souhaiter que François Gaudin puisse rapidement tirer de cette thèse novatrice un ouvrage qui permette à un public élargi de redécouvrir enfin ce proscrit de la mémoire collective, qui fut durant près de trois-quarts de siècle un inlassable « fantassin des régiments de l’espoir ».
Michel CORDILLOT
Loïc RIGNOL, « Les hiéroglyphes de la Nature. Science de l’homme et Science sociale dans la pensée socialiste en France, 1830-1851 », thèse de doctorat d’histoire, dir. Michèle Riot-Sarcey, université Paris-VIII Saint-Denis, 18 décembre 2003.
« Voilà quarante ans que notre Maître, ce grand homme qui, sans doute, a commis des erreurs comme tous les hommes, mais qui n’en est pas moins le plus grand génie des temps modernes et le Père du Socialisme scientifique, voilà quarante ans que CHARLES FOURIER a annoncé au monde la découverte de la loi d’Harmonie. » [1] Ces propos formulés par Considerant en 1848 marquent bien l’ambition scientifique de nombreux socialistes du premier XIXe siècle. Ils se rangent notamment, comme le chef de file de l’École sociétaire, sous la bannière de la science sociale de Fourier. Explorer les fondements de ce socialisme scientifique imposait donc deux exigences corrélatives.
1) Il fallait saisir les principes organiques de cette science sociale mise en forme par Fourier et ses disciples qui l’emporte chez eux sur toute autre considération. C’est pourquoi le mouvement s’organise en École scientifique et non en Parti ou en Église : la science sociale ne se veut pas d’abord une religion et une politique. Seule la science pourra opérer la régénération de la société et de l’humanité. Les successeurs de Fourier refusent pour la même raison de se baptiser « fouriéristes » : ils ne sont pas les disciples d’un homme - approuvant toutes ses paroles, imitant tous ses gestes - mais d’une œuvre et d’une pensée. D’emblée, les continuateurs de Fourier se démarquent des mouvements socialistes chrétiens contemporains : l’Église saint-simonienne et l’Église catholique française de l’abbé Châtel notamment. Contre les illusions rétrospectives justement dénoncées par Michel Foucault, ce socialisme scientifique devait se penser en lui-même, sans être référé à l’œuvre postérieure de Marx qui ferait office de lanterne magique pour en éclairer les erreurs et les illusions, autant de chimères qui caractériseraient les maladies infantiles du socialisme.
2) Mais si on ne pouvait évaluer la scientificité de la science sociale à la lumière d’une norme ultérieure, à quelle aune la juger ? À la science de son temps. En d’autres termes, il s’est agi dans ce travail de s’affranchir de toute référence à l’utopie, dont Fourier lui-même a entrepris la critique, pour prendre ces théories au sérieux, en mesurant leur rationalité à la lumière des sciences de leur époque. Une telle ambition suppose donc d’emblée une normalité épistémologique du socialisme, un refus de toute analyse en termes de « savoir hérétique », pour reprendre une expression de Jacques Rancière. Il doit être non seulement de son temps par ses préoccupations et ses enjeux politiques et sociaux, mais par son appareillage conceptuel. Il se révèle de plain pied dans le dispositif de savoir du premier XIXe siècle. Il lui emprunte, pour le meilleur et pour le pire, ses règles de pensée et ses principes d’analyse, ses lois et ses joies, ses décrets et ses méfaits. Mais réciproquement, les socialistes épuisent les conditions de possibilité offertes par cette norme de savoir de leur temps. S’ils vont parfois au-delà des énoncés fondamentaux des sciences qu’ils étudient, ils n’en trahissent pas la portée et la signification. Ils les achèvent au contraire. Ils ne les déplacent pas, ne les font pas dévier de leur axe. Ils les dépassent plutôt pour en accomplir les virtualités. En d’autres termes, le socialisme scientifiquement compris dit autre chose que la pensée politique dominante de son temps, mais pas autrement. Il se révèle sans doute minoritaire, dans l’ordre du pouvoir, mais pas marginal dans l’ordre du savoir.
Le contexte historique définit également la nature des sciences investies par ce socialisme. En ce premier XIXe siècle en effet, on soutient abondamment que la société est morte spirituellement, que tous les liens qui en assuraient l’unité sont défaits. Plus encore, l’existence même de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre est menacée. Les classes laborieuses ne sont pas des classes dangereuses, disent nombre de socialistes, mais des classes en danger, exposées au suicide, à la faim et même à la dégénérescence, transformées en chair à charbon par le règne dévastateur de l’industrie. Malthus a même énoncé la loi de cette dépopulation nécessaire. La progression géométrique de la population et la progression arithmétique des subsistances impose un réajustement : une partie doit disparaître en mourant, par les guerres et les épidémies, ou ne pas naître, par la contrainte morale. Elle est de trop au banquet de la Nature ! Perçu par les socialistes comme le meilleur résumé du système en place, Malthus a énoncé, écrit Proudhon, la « théorie de l’assassinat politique du peuple » : le capitalisme est gouverné par la peine capitale. Il porte en lui la mort des populations qui le font vivre. L’épidémie de choléra de 1832 symbolise cette société qui assiste à ses propres funérailles : elle s’effondre sous ses propres injustices. Les miasmes du choléra sont alors perçus, par les réformateurs sociaux, comme les messagers du socialisme. Ils montrent l’urgence d’un nouveau monde. En somme, la question sociale est d’abord une question vitale : elle doit se comprendre en termes biologiques. Elle se mesure à son impact sur la vie des hommes. La nature de la question commande immédiatement la nature de la réponse à y apporter.
Si en effet la vie même de la société et de sa partie la plus nombreuse et la plus pauvre se trouve exposée à une mort prochaine, il faut trouver dans les lois universelles de la Vie les principes directeurs d’une nouvelle organisation sociale. La société dénaturée doit se ressourcer en faisant retour vers l’ordre de la Nature. Le socialisme scientifique se veut ainsi naturaliste et vitaliste, il doit former un bio-socialisme en explorant les deux schémas fournis par le corps de l’univers, étudié par la cosmologie, et le corps de l’homme, étudié par la physiologie et l’anthropologie. C’est bien à ce titre que le socialisme entendu comme science sociale se met à l’étude de la science de l’homme dont il entend tirer les lois d’une société naturelle, juste, normale, véridique, pour reprendre les termes de l’École sociétaire.
L’épistémologie du socialisme ainsi articulée revenait donc à réinscrire le socialisme dans les sciences naturelles de son temps, anthropologie en tête. J’en étais là au seuil de la rédaction quand une dernière réflexion va réorienter ma pensée pour en réorganiser l’architecture et en éclairer le sens. Car penser la vie, c’est, pour reprendre un mot de Pierre Leroux, penser Dieu dont elle émane. Faire retour à la Création, c’est faire retour à son Créateur. La science mène à la religion pour former une théologie scientifique : elle doit déchiffrer dans l’ordre du monde les lois manifestant sa volonté. Même chez les plus positivistes et les plus matérialistes - comme chez certains communistes des années 1840 : Dezamy, Meyer écrivant sous le pseudonyme de Fresnoy ou Jules Gay - la science est la religion par excellence au sens où elle seule peut re-lier les esprits, rallier les consciences. La portée de ma recherche s’en trouvait ainsi modifiée au dernier moment, sur le fil. Le socialisme, cherchant une nouvelle arche d’alliance pour unifier les hommes entre eux en les ramenant à Dieu, devait se penser comme science pour accomplir sa mission religieuse. C’est bien parce qu’ils recherchent une nouvelle religion que les socialistes veulent fonder une science sociale, se voulant aussi bien naturaliste que déiste. Le projet initial se trouvait alors redéfini, ou plutôt enfin défini dans sa véritable portée et dans sa juste ampleur : il fallait proposer une sorte d’épistémologie religieuse du socialisme, je ne vois pas comment dire les choses autrement !
Du même coup, nombre d’étonnements jalonnant cette recherche s’expliquaient, maintes difficultés se dissipaient. Cette nouvelle lecture permettait de resituer avec bien plus d’à propos le socialisme dans son temps, en le replaçant dans les enjeux religieux du début du XIXe siècle. Elle permettait ensuite de comprendre la présence, la prégnance même de Dieu dans les œuvres scientifiques. Si les physiologistes et les anthropologues ne se veulent pas forcément adeptes d’une religion, ils se montrent profondément croyants, flirtant régulièrement avec la religion scientifique. On connaît le mot célèbre de Gall résumant ses travaux : « Dieu et le cerveau, rien que Dieu et le cerveau ! » Enfin et surtout, la question religieuse apportait une réponse épistémologique à l’articulation du socialisme et de la science. Comme la religion en effet, le socialisme entend se propager d’abord par la parole. Le pouvoir de la science lui-même ne tient pas à autre chose. Il ne tient pas tant à sa capacité de transformer le réel qu’à son aptitude à changer les consciences : la science transforme le monde parce qu’elle transforme la vision du monde. C’est pourquoi, dans ces spéculations, les principes comptent plus que leurs applications, la théorie pure l’emporte de loin sur la technologie. Les contemporains croient à la force des idées : la parole incarne les choses, les mots font exister les êtres dont ils parlent. Pour Ballanche, les socialistes, les philosophes éclectiques, dire, c’est faire ! Au point même que certains auteurs, Victor Meunier par exemple, décrivent précisément les systèmes de pensée comme de véritables organismes : la pensée organise le monde parce qu’elle est déjà organique. Et toute la science sociale édifiée par l’École sociétaire se pense dans un va-et-vient entre le corpus de la science, et la science sociale comme science des corps. Elle ne peut enfanter un corps social nouveau que parce qu’elle est déjà un corps de doctrine porté par une École faite corps.
Et c’est bien du côté du langage de la science et au-delà du XIXe siècle comme langue que se résout la délicate question de l’articulation de la pensée socialiste et de ses sciences de la Vie. Elles parlent la même langue fondamentale du savoir, elles sont habitées par la même volonté de déchiffrer le langage hiéroglyphique de la Nature par lequel Dieu énonce, dans la structure visible du monde, ses desseins et ses décrets. Fourier lisant le grimoire de la Nature, les savants interrogeant les symboles du corps : phrénologues, physionomistes, ethnologues mesurant les boîtes crâniennes, les artistes romantiques recueillant la voix des êtres, parlent entre eux dans la mesure même où ils cherchent à découvrir la même parole divine incarnée dans le réel. Aussi l’énigme apparente devient-elle solution. La volonté de comprendre les hiéroglyphes de la nature s’impose comme leur lieu commun, leur langue mère. C’est ce qu’ils ne comprennent pas : le hiéroglyphe, qui paradoxalement nous aide à les comprendre, c’est bien cela qui fait qu’ils communiquent entre eux, même à leur insu. Le XIXe siècle est bien celui de Champollion, des Champollion qui, chacun dans leur domaine, s’attachent à la même œuvre d’interprétation.
Ce cadre méthodologique rapidement esquissé, il reste à articuler les éléments fondamentaux de cette science sociale devant servir de matrice à la régénération. Elle procède chez Fourier d’un paradoxe fondamental. Elle ne saurait en aucune manière se présenter comme une science de la société telle qu’elle existe. La Civilisation s’offre en effet comme le monde à rebours, le désordre et le mensonge y sévissent partout : elle constitue l’envers exact de la Nature. C’est pourquoi les sciences morales et politiques qui en entreprennent l’étude ne peuvent qu’entretenir ses illusions : la Civilisation et ses sciences fausses et rebelles, comme il les baptise, se trouvent aimantées par l’erreur et le mal. Elles entretiennent sans fin les souffrances qu’elles prétendent guérir. Ainsi les enquêtes sociales, menées par la philanthropie, comme la physique sociale de Quételet ne se révèlent-elles d’aucune utilité. Elles se limitent à recenser les malheurs sociaux, à dresser l’inventaire des désordres sans jamais proposer les principes d’un autre monde possible. Il faut donc, par un même geste, récuser la Société en place et ses sciences illusoires : tel est le sens du doute et de l’écart absolus. Comme Franck Malécot l’a bien montré, cet acte fondateur obéit à une « logique de soustraction » pour reprendre son expression. Il faut lever la cataracte, se libérer des entraves, changer de route, comme l’a fait Christophe Colomb, et rentrer ainsi dans l’harmonie universelle pour y découvrir la Charte divine de la Nature. Puisque le désordre ne peut fonder la science, où trouver l’ordre nécessaire à la science sociale sinon dans le Cosmos. Elle doit transposer l’ordre du monde dans le désordre de l’humanité. Il faut introduire le partout de la Nature dans le nulle part de la société. Ce qui doit exister, pour les hommes, existe déjà pour tous les êtres du monde. Il faut simplement en trouver le sens, en calquer les rapports pour fonder une association véritable conforme aux lois objectives de la Création, c’est-à-dire aux volontés du Créateur. La science sociale est bien en cela une théologie positive. Et si l’École sociétaire ne s’est jamais organisée en Église, elle n’a pas manqué de célébrer l’union de la foi et de la raison : sa science devant réaliser sur terre la promesse chrétienne.
La science sociale peut, comme je l’ai dit, se fonder sur la cosmologie ou l’anthropologie : l’infiniment grand et l’infiniment petit étant régis par la même loi d’attraction. Henri Lecouturier, avec son système de cosmosophie universelle, est sans doute aller le plus loin dans cette quête d’une cosmologie sociale. À l’autre extrémité, explorant non plus le système du grand monde mais celui du petit monde, la plupart des partisans du socialisme scientifique ont entrepris de fonder la science sociale sur la science de l’homme. Il ne s’agit plus dès lors de fonder une science des prolétaires, une zoologie ouvrière, comme le proposent les enquêtes sociales : une paupérologie, assignant par là même une classe à l’observation d’une autre, mais une science de l’homme en soi, dans son universalité : un tableau de ses éléments fondamentaux, une classification de ses facultés primitives. Opérant une véritable révolution copernicienne, la science sociale renverse le rapport entre ce qu’on croyait fixe et ce qu’on pensait mobile. La société n’est plus une donnée primitive et immuable à laquelle la nature humaine, infiniment malléable, devrait s’accorder. Il ne convient pas de moraliser ou de socialiser l’individu en lui inculquant les valeurs d’une collectivité. Ce n’est pas l’homme qui doit changer, mais la société, car l’humanité est intangible et l’ordre social infiniment modifiable. La société gravite autour du soleil de la nature humaine, et non l’inverse. Déchiffrer les hiéroglyphes des facultés données par Dieu aux hommes, c’est découvrir dans les profondeurs de leur être les lois naturelles et divines qui doivent les diriger. La sémiologie découvrant ce qui est, selon les principes nécessaires de la nature humaine, prescrit immédiatement ce que doit être une organisation sociale qui lui soit en tout point conforme, c’est-à-dire qui autorise la satisfaction de tous ses besoins et l’exercice de toutes ses potentialités. Telles sont les prémisses de cet organicisme socialiste.
C’est ce canevas qui explique les deux grandes branches de l’anthropologie socialiste dans la première partie du XIXe siècle : une phrénologie et une ethnologie se déployant dans l’espace de la science sociale.
1) Une phrénologie socialiste s’esquisse autour de Julien Le Rousseau, Fleury Imbert et l’École sociétaire notamment. Trois principes fondamentaux rendent possible cette articulation de la physiologie cérébrale et de la théorie de la science sociale. 1) Gall et Fourier entendent déchiffrer les hiéroglyphes de la nature humaine : hiéroglyphes des passions et « hiéroglyphes psychologiques », dit Gall, ce langage naturel des facultés localisées à la surface du cerveau et du crâne. 2) Ces facultés et ces passions constituent des forces nécessaires, innées et immuables dont on peut dresser la nomenclature. Il y a 12 passions fondamentales chez Fourier, se résumant dans une 13e l’unitéisme, et 27 facultés primitives chez Gall. C’est la loi d’airain de la nature humaine à partir de laquelle doit s’édifier une nouvelle société la prenant pour modèle. 3) Ces facultés et passions naturelles sont inégalement développées d’un individu à l’autre. Cette matrice commune explique comment Julien Le Rousseau a pu fusionner les deux théories en proposant un tableau de correspondance des facultés chez Gall et des passions chez Fourier. Mais ce faisant, cette phrénologie socialiste ne se contente pas d’emprunter à la phrénologie sa positivité, elle la prolonge et en accomplit même le dessein. La phrénologie peut en effet se ramener à une grande trinité épistémologique. Prétendant découvrir dans les formes physiques de l’encéphale les signes des facultés morales, elle s’oriente vers une triple direction. Elle établit : 1) un principe de compréhension : connaître le moral par le physique, 2) un principe d’amélioration : développer l’esprit par l’exercice de ses instruments organiques, 3) un principe de réconciliation : si la pensée possède des conditions physiologiques de possibilité, si elle trouve sa racine dans le corps, c’est-à-dire dans le cerveau, on ne peut martyriser le corps pour purifier l’esprit, car on les mortifie tous les deux. La phrénologie autorise, explicitement, un dépassement du christianisme et de sa réprobation de la chair pour proposer l’émergence d’un homme total, indistinctement corps et esprit : un individu, c’est-à-dire un être indivisible. Et c’est bien dans le cadre d’une revalorisation de la nature, prônée par l’Église saint-simonienne et l’Église catholique française de l’abbé Châtel, que la phrénologie socialiste s’inscrit. Julien Le Rousseau est longtemps Vice-primat de l’Église catholique française de l’abbé Châtel. Théophile Thoré, de formation saint-simonienne, voit pour sa part dans la phrénologie l’émergence d’une « anthropologie panthéistique », abolissant le dualisme de la chair et de l’âme. Aussi la phrénologie socialiste mène-t-elle à ses ultimes conséquences épistémologiques la phrénologie : elle achève sa trinité constitutive. Elle offre pour cela la théorie du milieu social réalisant cet homme total qui accomplit l’universalité de son être. C’est la conception du phalanstère, pensé sur le modèle d’un organisme irrigué par une artère centrale : la rue-galerie. Celle-ci assure la circulation des êtres humains qui y exercent successivement toutes leurs facultés en passant d’une série de travail à une autre.
2) Parallèlement, une ethnologie socialiste s’élabore à l’initiative notamment des saint-simoniens et d’Alphonse Esquiros. Elle s’inspire également de ce nouveau christianisme du XIXe siècle en cherchant à constituer sur sorte de société des races, une alliance physiologique des populations. Il s’agit de déduire de la nature des peuples la nature des relations à instituer entre eux : une association scellée dans la chair. La doctrine historique et politique des races, mise en forme sous la Restauration par Guizot et les frères Thierry, subit en 1829, avec Edwards, une réorientation naturaliste : la fixité des races jette les bases d’une science de l’histoire et de la politique. Ce nouveau schéma est renversé par un saint-simonien : Victor Courtet de l’Isle. Il place dans la dialectique des croisements ethniques le moteur des évolutions sociales et politiques : c’est par le croisement que s’opère l’émancipation des peuples et la marche vers la démocratie. La science des races est la science sociale révélée pour lui. Ce nouveau dispositif fait école. Des saint-simoniens comme d’Eichthal et Ismaÿl Urbain divisent l’humanité en races mâle - occidentale - et femelle - orientales - c’est-à-dire en fait en races blanche et noire. La famille humaine sera réconciliée lorsque s’opérera le mariage des races dans un métissage universel. Esquiros reprend cette dynamique de l’affamiliation des races : il interprète toute l’histoire humaine comme une vaste eucharistie, une lente fusion des races initiées par la race gauloise, race Christ, à la fois mâle et femelle, unifiant peu à peu le globe en s’unissant à tous les peuples. Cette dialectique forme alors, de proche en proche, une humanité réconciliée, un seul et même corps, le Corps du Christ selon Saint Paul, manifestation biologique et biblique, naturelle et mystique du royaume de Dieu. L’ethnologie commande ainsi une politique religieuse des races : c’est par la nature que s’accomplissent les desseins du Créateur. La chair n’est plus l’instance du péché mais le support d’une révélation. Devenir corps pour revenir à Dieu.
Ainsi résumé à gros traits, ce socialisme scientifique, fondant sur la science de l’homme une science sociale, cherche dans les secrets de la nature des hommes la loi de leur réconciliation. Celle-ci part de soi : c’est quand chacun aura accompli l’universalité de son être qu’il pourra se réconcilier avec l’universalité des êtres. Alors rendu à l’ordre objectif de la Nature, l’humanité aura réalisé ici-bas la volonté du Très-Haut. Elle aura accompli par la science sa destinée religieuse en rendant vivante la célèbre prière : « Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ».
Loïc RIGNOL
Habiter l’utopie ?
Au château de Kerjean, Saint-Vougay (Finistère), de mars 2004 à février 2005
La réflexion menée au château de Kerjean porte dans un premier temps sur les espaces bâtis, les lieux issus de la critique d’une société historiquement établie, sur le pouvoir correctif qui leur est prêté (transformer une « mauvaise société » en « bonne société »). Erigé au siècle même où le mot « utopie » apparaît (Thomas More, 1516), Kerjean propose d’en retracer l’évolution, en mettant en lumière le rôle de l’architecture et de l’urbanisme dans ce courant de pensée (exposition : avril à octobre 2004).
Puis, en collaboration avec le VIA (Valorisation de l’innovation dans l’ameublement), les étudiants de cinq écoles d’art et d’architecture sont invités à réfléchir dans un cadre défini avec le philosophe Jean-Michel Longneaux, sur la notion d’habitat. Ils sont guidés par l’idée qu’il ne s’agit pas de savoir s’il nous faut habiter autrement (ou ailleurs, ni dans un autre temps, forcément meilleur), mais plutôt comment faire pour que chacun se sente chez lui afin de mieux habiter le monde. Les réalisations des étudiants sont exposées dans un « espace utopique » créé dans l’enceinte du château.
Contact : 02-98-69-93-69 ; château@chateau-de-kerjean.com
Les Journées Charles Fourier à Buenos Aires
Organisées par Centre culturel Rojas de l’Université de Buenos Aires et par le Centre d’études et de documentation sur la culture de gauche en Argentine, les 15, 16 et 17 avril 2004 à Buenos Aires.
Au mois de décembre 2003, nous avons eu l’heureuse surprise de recevoir de Buenos Aires une invitation à participer aux Journées Fourier que le Centre culturel Rojas de l’Université de Buenos Aires et le Centre d’études et de documentation sur la culture de gauche en Argentine, le CeDinCi, étaient en train d’organiser. Ces journées, les premières - à notre connaissance - en Amérique latine, se sont tenues dans la capitale de la République argentine les 15, 16 et 17 avril 2004. Nous avons accepté avec plaisir cette invitation et nous ne l’avons certes pas regretté, car ce que nous avons découvert va bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Ce que nous avons pu écrire sur la Colonie Cecilia, les phalanstères du Santa Catarina, le fouriérisme au Mexique et autres utopies sociales en Amérique latine au XIXe siècle ne nous avait pas préparé à accepter l’évidence de l’actualité de la pensée de Fourier au Río de la Plata en ce début du XXIe siècle. Nous connaissions, bien sûr, la rencontre avec Fourier et Saint-Simon des intellectuels argentins en lutte contre la tyrannie de Juan Manuel de Rosas dans les années 1830-1850, mais nous ignorions tout du Premier manifeste nutrinationaliste argentin. Nous avions eu quelques échos par la presse des systèmes de troc que les Argentins avaient organisés pour faire face à la crise, mais nous ne savions pas que cette économie solidaire s’était développée à l’échelle de provinces entières et qu’une monnaie de substitution, ironiquement baptisée patacón (grosse monnaie d’argent), avait circulé. Certes, les études de Charles Gide et Jean Gaumont nous ont permis depuis longtemps de comprendre ce que devaient les formes d’organisations coopératives au socialisme dit « utopique » français. Cependant savoir qu’il y eut - et qu’il y a sans doute encore - en Argentine des restaurants que Fourier aurait qualifié de « véridiques », conçus comme des lieux qui lient l’acte biologique de la nutrition à l’acte économique d’une production désaliénée et autogestionnaire, mais aussi comme des lieux de rencontres culturelles, politiques et éducatives, nous surpris et nous a ému. L’énergie, l’inventivité du peuple argentin pour faire face à une crise provoquée par la rapacité d’une clique de délinquants ultralibéraux et pour affronter la famine pour la première fois de son histoire est admirable. Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que les intellectuels se soient tournés vers la pensée de Charles Fourier et ces journées tenues devant un public portègne attentif et réactif en sont le témoignage.
Des communications savantes et claires ont été prononcées sur les aspects les plus divers de sa doctrine : sur son actualité en Argentine, bien sûr, mais aussi sur ce qui l’oppose au saint-simonisme ou sur les sociétés expérimentales qui ont tenté d’incarner cette pensée dans l’histoire de l’Amérique latine, sur la Colonie Cecilia en particulier. Nous rendrons compte en son temps de la publication des actes. Le colloque s’est clos par une fête fouriériste durant laquelle la mémoire de Fourier fut joyeusement célébrée : et cela pour la première fois au Río de la Plata depuis près de cent soixante-deux ans, exactement depuis la publication à Montevideo par Jean-Baptiste Eugène Tandonnet, le 10 octobre 1842, d’un numéro spécial du Messager français, entièrement consacré à la mémoire du Bisontin, à l’occasion du cinquième anniversaire de sa disparition. Impossible d’achever ce bref compte rendu sans renouveler l’expression de notre gratitude d’homme et de chercheur à nos amis "néo-fouriéristes" argentins.
Pierre-Luc ABRAMSON
A la recherche d’un fouriérisme austral
A la différence du fouriérisme nord-américain, dont le souvenir reste gravé dans la mémoire collective grâce surtout aux expériences communautaires du North American Phalanx ou de Brook Farm, l’histoire du fouriérisme aux Antipodes est difficile à cerner, et, en conséquence, les chercheurs qui se consacrent à cette tâche sont encore peu nombreux. Pour un Arthur Young et quelques phalanstériens inconnus ayant émigré en Australie du Sud, [2] ou un William Lane qui s’inspira de l’Icarie de Cabet en créant une colonie australienne au Paraguay, [3] les utopistes qui en Australie s’inspiraient directement de Fourier et des penseurs utopistes français s’individualisent rarement dans les nombreux courants du socialisme australien. De ce fait, la tâche de déterminer l’influence du fouriérisme sur les mouvements travailliste et communautaire aux Antipodes s’annonce longue et difficile, d’autant plus que l’une des sources potentielles de renseignements sur des militants éventuels, le fouriérisme britannique, n’a pas encore livré tous ses secrets. A vrai dire, les chercheurs australiens qui s’intéressent au fouriérisme portent traditionnellement leur attention sur Fourier ou sur l’influence politique ou culturelle de l’Ecole sociétaire. Cette tradition ayant déjà porté ses fruits, [4] elle continue de plus belle, comme l’indiquent quelques travaux et quelques manifestations récents.
Les universités australiennes et néo-zélandaises accueillent tous les deux ans depuis 1980 un colloque dédié à la mémoire de George Rudé, l’historien de la Révolution française qui a fait une grande partie de sa carrière en Australie. Dans ces colloques, qui attirent bon nombre de collègues étrangers, et où l’on s’exprime soit en français soit en anglais, on fait une large place aux révolutions du dix-neuvième siècle. Dans le colloque qui eut lieu à l’Université de Melbourne en juillet de cette année, cette tendance s’est confirmée, avec des réflexions sur Flora Tristan, puis deux interventions qui ont traité du fouriérisme en particulier. Dans « Rothschildian Greed : This Variety of Despotism », Julie Kalman a poursuivi son travail sur les écrits antisémites en France par le biais de la campagne menée dans des journaux et des pamphlets contre James de Rothschild en 1846. Dans une étude nuancée et bien documentée, elle a situé le cas de Toussenel, entre autres, non seulement dans le contexte particulier de l’accident de chemin de fer qui a occasionné un vrai déferlement de haine contre le baron, mais aussi dans celui de l’anti-capitalisme de l’époque. Dans « Fourier and the Fourierists : A Case of Mistaken Identity ? », Pam Pilbeam a tenté de distinguer entre les idées de Fourier et celles de ses disciples sur les trois plans du féminisme, de l’organisation sociale et de la morale. Si l’argument était bien structuré, la démonstration était loin d’être convaincante, car elle ne tenait pas suffisamment compte de la complexité du mouvement fouriériste. Néanmoins, consciente de cette difficulté et cherchant à élargir le champ de ses réflexions, P. Pilbeam a annoncé son intention de développer ses recherches en cours sur le fouriérisme britannique, sujet peu exploré depuis la parution de l’étude de Richard Pankhurst en 1956, [5] et qui ouvre la voie à une meilleure connaissance du fouriérisme anglo-saxon en général, sans parler de la possibilité de suivre de près l’action de quelques personnalités clefs de l’Ecole sociétaire, dont Hugh Doherty. Pour ceux qui désireraient mieux connaître ces travaux et d’autres, plus nombreux, sur la Révolution, la publication des actes du colloque est prévue pour 2005 en formats électronique et papier.
Pour le prochain colloque Rudé, qui aura lieu à Adélaïde en juillet 2006, nous espérons que les contributions sur le fouriérisme seront plus nombreuses encore, car ce colloque d’histoire aura lieu en même temps que le colloque annuel de l’ASFS (Australian Society for French Studies), dont le thème principal sera « L’Utopie ». Les appels à communications pour les deux colloques seront lancés au cours de 2005, mais ceux qui désireraient déjà des renseignements, pourront me contacter à tout moment (jean.fornasiero@adelaide.edu.au). Plusieurs membres de l’Association des études fouriéristes ont fait une contribution très remarquée à nos colloques en 1992, 1996 et en 2000 ; d’ailleurs les actes du colloque de 2000 viennent de paraître aux presses de l’université de Delaware, dans la dernière livraison dans la série « Monash Romance Studies » (juillet 2004, 172 p., ISBN : 0-87413-811-6). Intitulée Consuming Culture : The Arts of the French Table, cette collection d’essais, éditée par John West-Sooby, est consacrée à la place qu’occupent les plaisirs de la table dans la société et la culture françaises, et il va sans dire que l’on y fait une place d’honneur à l’auteur du Nouveau monde industriel et sociétaire. Dans son article, « Tables d’Harmonie : Gourmandise, gastronomie et gastrosophie chez Charles Fourier », notre ami Thomas Bouchet offre une fine analyse du rôle que Fourier attribuait à la nourriture dans son système. Tout en faisant ressortir les critiques que Fourier adresse à ses contemporains, qu’il traite d’« avortons » et de « pygmées » en gastronomie, T. Bouchet met en lumière la complexité et la cohérence de la pensée de Fourier, qui couvre tous les aspects de la table, depuis la préparation et l’ordonnance des repas, jusqu’à la digestion, en passant par la jouissance et la bonne chère. Et T. Bouchet de conclure en suggérant que « Fourier est de ceux-rares, en définitive-qui donnent à la question du goût une place éminente. » (p. 49). Dans ma propre contribution, j’examine les attitudes de Gérard de Nerval envers les questions culinaires, à un moment relativement peu connu mais pivotal de son existence : les années 1850-1851. Intitulé « Nerval se met à table : les aveux d’un buveur démocratique entre la République et le Second Empire », cet article souligne, à travers une analyse de la production littéraire du poète pendant cette période, la façon dont Nerval met en cause, « par des métaphores à répétition, un régime qui condamne au dénuement ou à la mort les artistes ne sachant ‘digérer’ ni ‘breuvages de courtisan’ ni ‘bassesses’. » (p. 115) L’ensemble constitue un puissant signe de plus des sympathies de Nerval pour la gauche républicaine et pour les idées socialistes de l’époque. Outre ces deux études traitant de Fourier et du fouriérisme, il faut signaler celle que Jean-Claude Bonnet consacre à la naissance de la gastronomie et à l’écriture gourmande au XVIIIe siècle, et la contribution de Gabrielle Cadier-Rey, bien connue des lecteurs des Cahiers Charles Fourier, qui examine la question de la consommation ouvrière au XIXe siècle, d’après les budgets établis par Frédéric Le Play. Ce volume sur les Arts de la Table offre des études sur bien d’autres sujets, allant des Frontispices de l’Almanach des Gourmands de Grimod de la Reynière à la poétique de l’ivresse chez Francis Ponge ou à l’anxiété qui s’associe à la question culinaire chez Flaubert et Jules Verne. Bref, bien des choses à se mettre sous la dent !
En attendant la découverte d’un éventuel fouriérisme austral, nous espérons que les publications australiennes sur le fouriérisme hexagonal apporteront quelques lumières nouvelles sur le monde des phalanstériens et que nos colloques continueront d’attirer de fructueuses et harmonieuses collaborations avec nos amis de l’Association.
Jean Fornasiero
Association d’études fouriéristes, assemblée générale du 19 mars 2004 (Besançon)
Rapport moral (Th. Bouchet)
Depuis la dernière assemblée générale, l’association s’est orientée dans trois directions complémentaires, ici présentées :
Poursuite d’activités déjà engagées. C’est avant tout le Cahier Charles Fourier 14, élément de plus dans une déjà longue série. Laurence Bouchet et Louis Ucciani (coordination du numéro), Marie-Claude Charles et Edith Holzammer (maquette, mise en pages, graphisme), les membres du comité de rédaction et les membres de l’association qui y ont contribué sont chaleureusement remerciés. Par ailleurs, la plupart de nos adhérents nous restent fidèles, ce qui est pour nous très encourageant.
Renforcement de l’association. Le conseil d’administration élu il y a un peu plus d’un an et le bureau se sont réunis régulièrement. Informations et idées ont également circulé par une correspondance suivie avec de nombreux membres de l’association, ou avec des personnes intéressées (ou susceptibles de l’être). Le nombre de procurations reçues témoigne de l’intérêt que portent pour notre activité une bonne partie des adhérents, dispersés en France et à l’étranger. Un effort soutenu a été mené pour que des adhésions nouvelles se fassent : le résultat est positif (en 2003, une quinzaine de personnes, de tous âges et de tous horizons). La diffusion des Cahiers reste en revanche insuffisante : nous en plaçons davantage en librairie qu’auparavant, sans grand succès ; quelques dépôts complémentaires (notamment par Michel Cordillot) permettent quand même que les Cahiers soient présents à Paris.
Nouveaux chantiers. Pour animer la vie de l’association un réseau de correspondants est en cours de constitution ; des contacts réguliers sont établis, ce qui permet de nourrir la dimension internationale de notre activité. Il serait bon qu’à l’avenir chaque assemblée générale aille de pair avec une rencontre qui pourrait prendre la forme d’une journée d’étude (la coordination, cette année, avec le colloque organisé à Besançon par Louis Ucciani a donné de bons résultats), avec un repas ; reste à trouver des fonds pour financer. Le Cahier numéro 15 est déjà en route (parution décembre 2004). Tout projet d’article, de compte rendu, d’information sera le bienvenu : les Cahiers doivent être et rester très hospitaliers. En relation avec un éditeur bordelais, le projet d’un volume rassemblant des articles des Cahiers parus (et éventuellement certains textes du colloque de 1993...) pourrait voir le jour. Le comité de rédaction fera des propositions à l’éditeur. Nous avons envoyé des exemplaires du Cahier 14 pour compte rendu et pour information, pour nous faire davantage connaître. L’idée d’un site, enfin, a fait son chemin. Plusieurs membres de l’association, et notamment Pierre Mercklé, ont réfléchi à la forme qu’il pourrait prendre, à son contenu, à ses objectifs. Le projet semble suffisamment avancé pour qu’on puisse en envisager l’expérimentation en 2004.
Rapport financier (Jean-Claude Dubos)
Au 12 mars, l’association a en caisse 1296, 86 euros L’an dernier à la même date, elle avait 1450 euros. Le coût de fabrication et d’impression du Cahier 14 contribue à expliquer la baisse (1315 euros, contre 884 pour le Cahier 13) Aux 1315 euros, on joutera la rémunération de Marie-Claude Charles (maquette, mise en page). La hausse du coût s’explique en particulier par la taille du Cahier (160 pages, contre 120 au maximum d’habitude). Les envois ont en conséquence coûté plus cher aussi. Les cotisations entrent progressivement, notamment après l’envoi du Cahier ; l’association devrait recevoir d’ici peu le reliquat du colloque d’Arc-et-Senans, 800 euros environ ; les ventes dans les librairies sont négligeables.
L’AG vote à l’unanimité le rapport moral et le rapport financier. Sur proposition de Thomas Bouchet, elle vote également à l’unanimité le maintien dans sa composition actuelle du conseil d’administration. En 2005, il conviendra d’en renouveler un tiers.
Le site de l’association et des Cahiers
René Schérer signale que le projet en vaut la peine mais qu’il faut s’assurer de nos capacités à le réaliser. Pierre Mercklé présente rapidement le résultat de ses premières investigations. Il considère qu’une petite équipe peut faire l’affaire. Il se propose pour construire d’ici quelques mois un cadre général (système SPIP) ; ensuite, les informations, les matériaux et les idées peuvent être insérées très facilement, moyennant une familiarisation.
L’hébergement : trois possibilités s’offrent. Hébergement institutionnel (université, ENS, MSH...) ; hébergement non institutionnel et gratuit, techniquement valable sans plus (free.fr) ; hébergement non institutionnel et payant, techniquement plus performant. Il est décidé à l’unanimité que, pour préserver notre indépendance et nos finances, la 2e solution est pour l’instant la meilleure. Pierre Mercklé a déjà réservé quelques noms pour l’adresse (charles.fourier, par exemple). Il enverra bientôt ses propositions.
Le contenu : le problème de la censure sur les textes est débattu. Michel Giroud explique que le support électronique donne au texte une visibilité beaucoup plus grande que le support papier. Pierre Mercklé propose que le site donne accès dans un premier temps aux Cahiers, à des informations sur l’association ou sur l’actualité du fouriérisme, à des sources (textes, images) à des liens. On songera aussi à intégrer une base de données. Mais de quelle manière intégrer les Cahiers ? Il est décidé que tous pourraient être mis en ligne, sauf les trois derniers (on en donnerait un aperçu : sommaire, résumés). Il faudra demander aux auteurs des articles s’ils acceptent cette mise en ligne (compliqué, mais nécessaire).
Le calendrier : mise en place du cadre général avant le début de l’été ; pendant l’été, réactions et adaptations ; à l’automne, l’équipe se met au travail
Cahier 15
Il ne sera pas thématique. Un certain nombre de propositions d’articles ont été faites. Il faut maintenant établir un pré-sommaire. Louis Ucciani demande deux ou trois réunions par an pour le comité de rédaction. Adopté. Michel Giroud considère que le comité de rédaction est un handicap inutile. Il n’est pas suivi. Des numéros thématiques peuvent être envisagés, avec une ou plusieurs personnes pour les coordonner. Les Cahiers peuvent aussi passer commande d’articles à des auteurs. Pour l’instant, enfin, le rythme habituel de publication est conservé (parution en décembre)
Questions diverses
Samuel Feller pose la question de l’accessibilité de Fourier pour les jeunes. Il souligne qu’un certain nombre de jeunes seraient très susceptibles d’y trouver beaucoup d’intérêt. Il regrette qu’aucune présentation générale synthétique n’existe vraiment. Il trouve les Cahiers décidément très érudits. Une longue discussion s’engage alors. Il est répondu par exemple qu’on ne peut connaître Fourier qu’en plongeant dans son œuvre, que les Cahiers ne sont pas le lieu d’une vulgarisation. Chacun peut en revanche prendre des initiatives : le site peut en accueillir certaines ; la collection BT (Bibliothèque du Travail) s’est adressée à Louis Ucciani pour un « Fourier » accessible aux très jeunes ; Samuel Feller, Guillaume Clerc (tous deux élèves de terminale), Laurence Bouchet et d’autres pourraient répondre à cette proposition.
Laurence BOUCHET
Parutions à signaler
Pierre MUSSO (dir.), Le Saint-simonisme aujourd’hui. Colloque de Cerisy, Paris, PUF, 2004.
Thierry PAQUOT, Marc BEDARIDA, Habiter l’utopie. Le familistère Godin à Guise, Paris, éd. de La Villette, 2004.
A propos du Cahier 14
Dans la Revue d’histoire du XIXe siècle (28-2004/1, p. 215-217), Nicole Edelman fait un long compte rendu du Cahier Charles Fourier 14, « Mondes amoureux ».
A propos du site
Pierre Mercklé est en train de construire une première version du site qui fera connaître notre association et nos Cahiers. Bernard Desmars et Thomas Bouchet y travaillent avec lui. Dès que le projet se trouvera dans un état d’avancement suffisant, il sera très utile que les membres de l’association nous fassent connaître leurs réactions (pour toute remarque : pierre.merckle@free.fr)
En bref
La Délégation aux droits des femmes du département de la Sarthe a organisé pendant l’année 2003-2004 une série de cours publics à l’abbaye Saint-Vincent du Mans, consacrés aux « femmes en marche au XIXe siècle ». Nous avons noté, parmi les intervenants, trois membres de notre association. Le 24 novembre, Colette Cosnier (« Marie Pape-Carpantier, une Sarthoise invente l’école du peuple ») ; le 1er décembre, Simone Debout (« Charles Fourier ou la liberté passionnée et le plein épanouissement des femmes ») ; le 5 janvier, Michèle Riot-Sarcey (« Les femmes dans les révolutions parisiennes de 1830, 1848 et 1871 ». Ces conférences paraîtront aux éditions Autrement, dans la collection « Mémoires ». Trois volumes des conférences organisées par l’association « droit des femmes » ont déjà été publiés, ou sont sur le point de l’être : 1939-1945, combats de femmes françaises et allemandes ; 1789-1799, la Révolution exclut les citoyennes ; 1914-1918, les femmes piliers de l’effort de guerre.
Le 4 décembre 2004, la Société P.-J. Proudhon a organisé son colloque annuel sur le thème de « Proudhon et la République ». Interventions de Pierre Ansart, Olivier Chaïbi, Samuel Hayat, Fawzia Tobgui, Gaetano Manfredonia, Vincent Bourdeau, Maurice Braud. Pour en savoir plus : Société Proudhon, EHESS, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris.
Un de nos lecteurs nous a signalé la présence au musée des Beaux-Arts d’Agen d’un portrait de Charles Fourier attribué à Gustave Courbet. Nous tenons à la disposition des lecteurs intéressés une reproduction du tableau. Ils se convaincront qu’il ne s’agit absolument pas de Fourier, et très probablement pas de Courbet non plus.
Deuils
La même journée d’été 2004, le 30 août, notre ancien président Gaston Bordet a perdu sa mère, Madame Marie-Marcelle Bordet, décédée à 98 ans en Haute-Savoie, et notre trésorier Jean-Claude Dubos sa compagne Luba Jeannin, décédée à Besançon. A l’un et à l’autre, nos plus sincères condoléances.
Cette rubrique est la vôtre.
N’hésitez pas à nous faire parvenir
tous renseignements ou informations
susceptibles d’y figurer.
