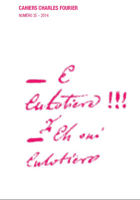
Des différentes initiatives pour diffuser la pensée de Charles Fourier en Amérique latine et, spécialement au Brésil, la publication au Pernambouc, entre 1846 et 1848, de la revue O Progresso, pourtant annoncée et commentée dans La Démocratie pacifique, est sans doute la moins connue. Elle est l’aboutissement (et le legs) du séjour au Brésil de l’ingénieur Vauthier qui, parallèlement à ses tâches de directeur provincial des Travaux publics, se consacra à propager les idées sociétaires : en des temps troublés, O Progresso voulut enseigner, au peuple comme aux gouvernants, adaptés aux circonstances du temps et du moment, les voies et les moyens de transformer non pas les apparences de la société mais l’état social lui-même...
Le samedi 19 septembre 1846, La Démocratie pacifique titre en première page sur la « Fondation d’un organe socialiste au Brésil », se félicitant de ce qu’« en dépit des obstacles de tout genre qu’on lui oppose, l’idée sociale marche et s’avance à la conquête du monde. Nous avons raconté à diverses reprises la propagande faite au nom de Fourier dans les États-Unis ; aujourd’hui, c’est du Brésil qu’une voix amie répond à la nôtre. Nous recevons le premier numéro d’une revue sociale, politique et littéraire, le Progresso, qui se publie à Pernambouc [1] depuis le mois de juillet dernier, avec cette épigraphe laconique : “En avant !” » L’article se poursuit, en page deux, par un large extrait d’une « Déclaration des principes », suivi de l’analyse du sommaire : « La revue brésilienne publie : 1° un article critique et dogmatique sur le problème de la certitude qui a tant occupé les philosophes, depuis Aristote jusqu’à M. Cousin, en passant par Descartes, Spinosa [sic], Berklay [sic], Kant et ses successeurs ; 2° le commencement d’un travail sur l’état du monde en 1845 ; ce premier article contient le tableau de la société au quinzième siècle ; 3° une revue scientifique ; 4° une revue politique du mouvement social ; 5° un morceau de poésie, intitulé Le Tamarinier de Mipibú et des variétés. Nous traduirons des extraits de l’article sur l’état du monde, quand ce travail nous sera parvenu dans son entier. » Mais, de cette revue « dont le programme est en parfaite conformité avec le nôtre », rien d’autre n’est dit : quand, comment, pourquoi et par qui a-t-elle été fondée ? Dans quel contexte ? Dans quel environnement social et politique ? Avec quel effet et quelles répercussions ? [2]
Pour traverser l’océan, aborder le Brésil, prendre racine au Pernambouc et y prospérer, quoi que l’on puisse penser de la force des idées de Fourier, il leur faut un passeur, un propagandiste convaincu et convaincant : c’est Louis-Léger Vauthier qui, dans son Journal [3], note, le 19 juillet 1846, l’envoi, par le voilier Zelia, du premier numéro d’O Progresso à son père et à François Cantagrel.
Vauthier est né à Bergerac (Dordogne) le 7 avril 1815, dans une famille de tradition républicaine ; son père, Pierre Vauthier, fils du maire élu de Boulogne et petit-fils d’un laboureur aubois, est un ingénieur saint-simonien des Ponts et Chaussées ; Louis-Léger, brillant étudiant provincial, suit la même voie : il est reçu à 19 ans au concours de l’École polytechnique puis à l’École royale des Ponts et Chaussées ; c’est pendant son séjour parisien qu’il s’initie au fouriérisme et se lie d’amitié avec Cantagrel, alors partagé entre les Beaux-Arts et les Travaux publics. Affecté à Vannes à sa sortie comme aspirant ingénieur, il y trace les plans de sa première « grande » œuvre, le phare de Port-Navalo (aujourd’hui inscrit à l’inventaire des monuments historiques), et dirige les travaux d’aménagement du port de Vannes. C’est là qu’il accepte avec l’accord de l’administration le contrat d’ingénieur offert, sur la recommandation de Gaspard Coriolis, directeur des études à Polytechnique, par un représentant du président de la province brésilienne du Pernambouc : Francisco Rego Barros [4] a ramené de son séjour parisien un modèle de ville ordonnée, aérée, de rues pavées et de théâtres illuminés et, pour ainsi transformer Recife, la capitale provinciale, il préfère aux techniciens nationaux ancrés dans leurs habitudes cet ingénieur étranger, polytechnicien versé dans les méthodes les plus modernes et convaincu que progrès matériel et progrès social ne doivent pas être dissociés. Ainsi Vauthier s’applique-t-il à construire, unissant technique et esthétique, routes, ponts, bâtiments, quais... et un théâtre, le Santa-Isabel, symbole d’une société enfin policée ; à organiser une administration hiérarchisée des Travaux publics, responsable et contrôlée ; à parcourir le pays pour en dresser la carte et en comprendre la complexité ; à proposer des politiques de protection de la nature, de police des fleuves et des côtes... Parallèlement, il est un propagateur persévérant des idées de Fourier : son Journal [5] témoigne de ses efforts pour convaincre ses interlocuteurs, qu’ils soient compagnons de voyage (comme Auguste Milet, son futur subordonné et ami), issus des grandes familles de l’agro-industrie du sucre (comme Maciel Monteiro, ancien ministre des Relations extérieures du Brésil) ou intellectuels engagés (comme Antônio Pedro de Figueiredo, métis et philosophe autodidacte). Avec eux, il crée O Progresso.
C’est après le départ de Louis-Léger Vauthier, dans le numéro 5 de février 1847, que nous est contée sous forme d’apologue la naissance de la revue : se promènent par les rues nouvellement pavées de Recife quatre amis, « jeunes par l’âge mais mûris par la réflexion » ; trois d’entre eux, nourris « aux saines et généreuses doctrines de l’école sociétaire » ; le quatrième, « un parfait civilisé ». Croisant un fonctionnaire récemment révoqué dont le sort les émeut, nos promeneurs solidaires, cherchant la cause des difficultés politiques du moment, en viennent à invoquer le silence de l’opinion publique ou, plutôt son absence de porte-voix. Engagés par leur ironique ami civilisé à y pourvoir, les trois fouriéristes s’y décident : ils créeront un journal qui défende la cause du peuple, humanité souffrante ; qui lui enseigne ses droits et ses devoirs et où sont ses véritables amis, ceux qui s’attachent à l’amélioration de leur malheureuse condition : « Nous montrerons à tous ces prétendus hommes d’État qui nous gouvernent qu’ils ignorent les notions de base de l’économie sociale… »
Ainsi paraît, le 12 juillet 1846, le premier numéro d’O Progresso, revista social, litteraria e scientifica, dont Figueiredo [6] par un long communiqué dans le Diário de Pernambuco du 23 mai 1846 [7], a précisé le programme : une publication réellement nouvelle qui ne sera inféodée à aucun parti car ses rédacteurs sont « convaincus de l’inanité de la politique étriquée et haineuse des partis et de ce que seule l’étude des questions sociales [leur] fournira les conditions de notre développement » ; ils ne commettront pas la grave erreur « de copier servilement l’Europe, au lieu de rechercher les moyens d’appliquer à notre pays les données des sciences sociales ; nous voulons lancer, au milieu de l’incohérence actuelle, […] quelques principes exacts, les germes d’un avenir généreux ».
« L’incohérence actuelle » : définition lapidaire d’une situation politique complexe dans l’Empire en général et, plus encore, au Pernambouc. Quand, le 7 avril 1831, Pierre Ier décide d’abdiquer et de retourner en Europe, son fils et successeur n’a que cinq ans ; le Brésil n’est alors qu’un assemblage instable de provinces rivales et enclines à se dissocier ; le pouvoir exécutif de la régence n’est que le plus petit facteur commun de trois partis plus sociologiques qu’idéologiques [8]. De crise en crise, de triple régent en régent unique, de rébellion en révolte et de révolte en soulèvement, d’acte additionnel adoptant des mesures fédéralistes en loi interprétative de l’acte additionnel les restreignant, la première décennie du second règne met à mal l’unité du pays. La seconde commence sous ces mauvais auspices ; le régent Pedro de Araújo Lima, élu en avril 1838, fait difficilement face, malgré une répression violente, aux rébellions anciennes ou nouvelles ; la situation économique ne s’améliore pas, les manifestations sociales se multiplient ; les dirigeants provinciaux s’indignent du retour de la centralisation ; les grands propriétaires veulent plus de stabilité ; le peuple, plus de tranquillité. Bref, de la régence, de cette « république de fait, cette république provisoire », comme l’appelle Joaquim Nabuco [9], la leçon tirée par les politiques est qu’il faut en sortir au plus tôt.
C’est, à l’instigation des libéraux et avec l’appui intéressé de la cour, « o golpe de maioridade » qui rabaisse l’âge de la majorité : le 23 juillet 1840, dans sa quatorzième année, Pierre II commence son long règne sous une première ambiguïté car, comme l’observe Francisco Teixeira, « le mouvement qui provoqua l’accession au trône du jeune Alcântara [Pierre II] et les mesures légales qui l’accompagnèrent, étaient d’essence clairement conservatrice. Mais ce fut le parti libéral qui les mena. […] » [10].
Le ministère libéral doit cohabiter avec une chambre conservatrice qui limite ou retarde son action ; aussi organise-t-il de nouvelles élections qui lui donnent la majorité attendue, mais obtenue par la fraude et la violence au point que l’Empereur prononce la dissolution de l’Assemblée ; revenus au pouvoir, les conservateurs se hâtent de prendre un complément de mesures « regressistas », rétablissant le conseil d’État, le pouvoir modérateur du monarque – ce pouvoir personnel censé équilibrer les pouvoirs exécutif et législatif et donnant, en particulier, à l’Empereur le droit de nommer et de démettre les ministres d’État –, et annulant la réforme du code pénal. Mais les libéraux gagnent les élections de 1844 ; le pouvoir change donc de mains ; de nouveaux présidents sont nommés dans les provinces ; ils nomment à leur tour de nouveaux fonctionnaires. Quatre années de ministère libéral s’ensuivent, marquées par la consolidation du pouvoir impérial, la fin des rébellions, plus de calme, plus de développement, les progrès de la culture du café, l’exploitation de mines, l’industrie naissante, de meilleures routes, de meilleurs ports : une lente évolution qui ne touche pas, ou peu, aux formes et aux méthodes du pouvoir ; d’ailleurs, les élections de 1848 sont favorables, cette fois, aux conservateurs.
C’est que ces antagonismes, si violents en apparence (et qui, parfois, le sont « sur le terrain »), sont davantage des oppositions d’hommes, de réseaux, de clients plutôt que d’idées et de programmes. Libéraux et conservateurs gouvernent avec les lois qui leur conviennent même s’ils ont combattu leur adoption ; dans les grandes familles, frères et cousins, souvent membres des mêmes loges maçonniques, peuvent bien être de partis différents, ils n’en sont pas moins du même sang.
Dans ce schéma général, le Pernambouc, province riche et avancée, paraît faire exception ; son poids politique est particulier ; ainsi l’élection du dernier des régents met-elle aux prises deux Pernamboucains, l’un libéral, l’autre, conservateur (et élu) [11]. De fait, conservatrices ou libérales, les grandes familles pernamboucaines (se) partagent le pouvoir, ce qui ne va pas sans contradictions, choc d’ambitions, froissement de vanités, sans récriminations de parentèles insatisfaites ; toute l’habileté de Rego Barros qui préside la province presque continûment de la fin de 1837 à février 1844 est de toujours ménager ses opposants qui, jusqu’en 1842, le lui rendent bien. Pourtant, cette espèce de consensus flou ne peut indéfiniment satisfaire l’ensemble des appétits ou des ambitions ; à partir de 1842, les conflits d’intérêt s’accentuent ; la crise aidant, de plus en plus de politiques dénoncent le pouvoir de Rego Barros sur les institutions et sur les emplois : les réformes entreprises, notamment à la direction des Travaux publics, se traduisent par la perte de contrats ; les cotonniers se plaignent des faveurs accordées aux sucriers ; l’accaparement des postes, même subalternes, l’inégale distribution des crédits, tout devient prétexte à critique et à polémique. Comme, à Rio, l’entente entre les puissants des deux bords fait des Cavalcanti, branches conservatrice ou libérale, les maîtres permanents de Recife, il faut, pour briser ce monopole familial, sortir du duopole partisan : sous la conduite de députés anciennement conservateurs, une double dissidence des partis traditionnels (et institutionnels) donne naissance au Parti National du Pernambouc, plus souvent désigné sous son appellation de parti Praieiro [12].
Ce parti nouveau s’oppose aux notables installés avec pour objectif de les remplacer ; mais nouveau, il l’est aussi par les adhésions qu’il suscite. Outre les représentants de la grande propriété et du négoce, s’y retrouvent la bourgeoisie d’affaires, des membres des professions libérales, aspirant à plus de liberté et des éléments plus radicaux comme le républicain Borges da Fonseca qui, aux élections de 1844, se rallie. De même, les artisans, les travailleurs citadins, libres mais pauvres et qui font le gros des manifestants, chassant dans les rues de Recife les Portugais, boucs émissaires de leurs misères : ce sont eux qui réclament la nationalisation du commerce de détail, revendication reprise par le parti, principal thème des réunions de campagne et prétexte aux « mata – marinheiros » qui troublent, à intervalles réguliers, Recife et le Pernambouc. [13] Une somme de mécontentements qui surpasse, aux élections de 1844, les « baronistes » partisans de Rego Barros, et qui, malgré les réticences du pouvoir central, obtient, après plusieurs intérimaires, un président acquis à la cause praieira, le bahianais Chichorro de Gama.
Ce seront quatre années de tensions, de désordres, d’incidents violents, d’affrontements armés entre miliciens dans l’intérieur et dans la capitale, d’intimidations, d’agressions, d’attentats – climat délétère auquel la presse partisane contribue. Car si le peuple n’a pas de porte-voix, les factions en ont de nombreux. Autour d’un quotidien, sorte de navire amiral de chaque parti, foisonnent les feuilles, bulletins, libelles périodiques, dont le point commun est de préférer la polémique à tout autre mode d’expression [14]. Dans cette « masse de journaux que les rapides variations de l’atmosphère politique font pleuvoir sur nos têtes, il n’en est pas un qui, étranger aux passions personnelles et aux émotions du jour, puisse abriter la pensée libre et les considérations sereines sur la philosophie et la science ! » C’est cette lacune que veut combler O Progresso [15].
De fait, la revue, mensuelle en principe, détonne : ses soixante pages à la typographie serrée, son apparence austère – ni illustration ni titre accrocheur ni quatrain humoristique –, ses textes pesants mais non empesés, l’éclectisme de ses sujets contrastent avec les périodiques sur quatre pages criardes, dévolues à l’encensement et, plus souvent, à l’éreintement de tel ou tel personnage public. Elle a un objectif clair : enseigner au peuple comme à ceux qui entendent le gouverner, que le progrès, à n’en pas douter, est à portée d’espoir ; la cité parfaite, prédite par Bacon [16], dessinée par Fourier, n’est pas, pour les esprits éclairés par les philosophes, une chimère mais un objectif auquel la science, la technique mènent ; l’homme, dé(sen)chaîné, est capable de connaître le secret des choses, partant de les dominer, de les modifier, de transformer son environnement, de le perfectionner : le progrès est la voie d’un avenir heureux, radieux ; c’est toute l’humanité qui avance et qui s’améliore ; double certitude que les découvertes, alors s’accélérant, renforcent ; à l’homme sage comme à l’ingénieur, à Figueiredo comme à Vauthier, plus rien ne semble impossible et surtout pas l’évolution de la société vers plus de justice, de liberté, d’ordre et de progrès. Il n’est que de le démontrer et de l’enseigner [17].
S’il ne peut être question, dans le cadre restreint de cet article, d’analyser l’ensemble des douze numéros parus entre juillet 1846 et septembre 1848 et qui représentent une somme d’essais touchant à la philosophie, aux sciences sociales et politiques, à l’organisation administrative, à l’histoire, à la littérature comme au système pénitentiaire, à la colonisation, aux sciences physiques ou à la poésie..., l’étude de l’Exposé des principes qui ouvre son premier numéro permet d’en tracer les lignes de force [18].
D’abord, la revue « bénéficie [d’un] privilège bien rare, pour ne pas dire inconnu chez nous » : sa rédaction est « unie d’intentions et de desseins », ce qui lui donne « l’avantage de présenter constamment dans le développement de notre pensée propre ou dans l’exposé des idées d’autrui, les mêmes doctrines et les mêmes principes généraux, appliqués aux faits de divers ordres. » La diversité des connaissances et des compétences enrichit l’équipe de rédaction sans nuire à l’unité de la pensée : O Progresso est une revue à nom collectif.
Puis, pour chacune des rubriques prévues, le manifeste présente ces « mêmes doctrines et mêmes principes généraux » qui cimentent sa rédaction. En philosophie, la pensée libre ; O Progresso refuse les convictions a priori, ne veut pas se laisser guider par des dogmes sans que la raison les ait examinés et validés. Tenant pour acquise l’existence de lois morales, analogues aux lois physiques et, comme elles, non encore toutes découvertes, persuadé que la recherche en ce domaine est une « tâche sublime » à laquelle le génie de l’homme doit s’appliquer en utilisant les procédés de l’analyse logique, les méthodes de recherche et d’examen, théorisées par Bacon, O Progresso assure ses lecteurs que « sans donner trop d’ampleur aux considérations métaphysiques, nous informerons nos lecteurs des plus importants travaux qui paraîtront sur ces sujets ». (p. 4)
Pour les sciences, O Progresso ne peut qu’admirer leurs progrès incessants et s’extasier, avec lyrisme, sur les milliers de savants qui, dans les lieux les plus obscurs, participent inlassablement à la quête du savoir. Pourtant, il faut craindre que ces découvertes ne s’accumulent sans ordre ni lien, comme un amas de pierres : une science est un ensemble régulièrement agencé « selon les règles de la géométrie divine, selon les plans de l’architecte sublime ». Or, constate la revue, si certaines sciences, les mathématiques ou la physique, sont assises sur des bases solides, trop d’autres, comme la médecine ou l’économie sociale, « usurpent véritablement le nom de science ». Et, pire, les académies qui devraient organiser la recherche, en dessiner l’architecture, les lois, les proportions, restent en dehors du mouvement, quand elles ne le répriment pas. Aussi, O Progresso fera-t-il connaître tout ce qui liera « à une loi d’ordre supérieur, les lois partielles que nous connaissons » : « Aussi, bien que la science, envisagée sous un tel point de vue si élevé, ait peu d’adeptes dans ce canton du monde où nous vivons, nous ne manquerons pas, quand l’occasion s’en présentera, d’exprimer notre sentiment sur ces matières […] » (p. 5)
Appliquant ces mêmes règles à la politique, O Progresso se déclare partisan de l’ordre et de la liberté, en rien contradictoires mais bien plutôt mutuellement indispensables : une société ordonnée, c’est-à-dire organisée et harmonieuse, ne peut être oppressive et liberticide ; de même qu’une société de liberté ne peut se concevoir sans un ordre qui organise les passions et les intérêts ; le despotisme et l’anarchie résultent de l’absence soit de liberté soit d’ordre ; les deux systèmes sont également condamnables ; ordre et liberté sont corrélatifs mais, ajoute O Progresso, l’ordre est la condition sine qua non de l’existence des nations ; pour autant, « […] dans tous les cas, nous chercherons une solution supérieure qui satisfasse en même temps ces deux principes, légitimes au même degré. [19] » (p. 6)
Sur ces bases, la politique, « en prenant ce terme dans son acception la plus élevée, est la recherche des conditions du bonheur des peuples » (p. 7). O Progresso concède qu’une de ces conditions puisse être la forme du gouvernement ; mais elle est loin d’être la seule : les formes de l’état social, la nature des relations entre les individus, l’acquisition plus ou moins facile du bien-être, le développement des sciences, des lettres, des arts, etc., sont « aussi des faits politiques d’une haute importance ». Dès lors, il est désolant de consacrer son temps à débattre de « droits frivoles et de libertés vaines quand elles n’émanent pas de l’atmosphère métaphysique des constitutions et qu’elles ne s’appuient pas sur une organisation sociale leur permettant de s’incarner dans les faits […] ». Laissant aux ambitieux, qui se disputent les postes et les places, à leurs débats factices, O Progresso rappelle que « […] la politique n’est pas l’art de parler pour ne rien dire ; c’est une science, la plus intéressante pour les hommes puisqu’elle influe directement sur leur bonheur […] c’est la science de l’organisation sociale avec pour unique but de réaliser le bonheur des individus. […] » (p. 7)
Pour y parvenir, O Progresso n’en doute pas : l’action politique doit être avant tout économique et industrielle car les progrès matériels sont la clef du bonheur de l’homme ; avec un optimisme militant, le manifeste montre la charrue remplaçant l’épée, la vapeur supplantant la poudre, les vieilles barrières nationales s’écroulant et le chemin de fer rapprochant les peuples. Un monde pacifique, un avenir radieux, c’est la devise du Progrès et d’O Progresso qui en fait connaître les lois et les conditions générales, les mesures à prendre pour en fixer la voie [20]. Mais l’optimisme ne doit pas occulter la réalité : cette politique, bonne pour une nation prise comme un ensemble, est frappée d’un vice destructeur si : « […] en même temps que s’accroît la somme des richesses, cela ne semble conduire, comme en Europe, qu’à augmenter indéfiniment la misère des masses. » (p. 8) Cependant, si cette paupérisation est une conséquence de l’industrialisme moderne, elle n’est pas « le résultat nécessaire des progrès matériels » mais celui de la fausseté des relations entre producteurs et consommateurs : O Progresso se fait fort d’exposer la manière d’éviter un tel écueil.
Cette politique, fondée sur les aspirations légitimes à l’ordre et à la liberté et tendant à l’organisation pacifique du progrès social, la revue compte en exprimer les conséquences sur tous les sujets d’intérêt public, sans même esquiver les moins pertinents, comme celui de savoir si la revue est républicaine ou impériale. Bien que répugnant à se placer à ce niveau du débat, O Progresso admet qu’un monarque, soucieux de la grandeur de son pays, vaut mieux qu’un régime partisan, soucieux de ses intérêts particuliers. Mais, quoi qu’il en soit, O Progresso veut garder ses distances :
Avant et par-dessus tout, nous sommes les amis du peuple ; ce que nous voulons, c’est le bonheur de la nation en son tout et en ses parties ; comme un gouvernement est absolument nécessaire, nous sommes subsidiairement amis du gouvernement ; ce qui ne nous oblige évidemment pas à admirer ou à approuver tout ce que font les gouvernements et pas davantage tout ce que fait le peuple ; en définitive, à l’un ou à l’autre, en tant que de besoin, nous les censurerons. (p. 9)
Quant aux lettres et aux arts, O Progresso entend bien leur consacrer l’attention qu’ils méritent car ils reflètent l’état de la société : le bien-être matériel est « l’antécédent logique des progrès rationnels de toute sortes » ; en somme, plus de bien-être : plus de poètes, plus de musiciens, plus de peintres. Car si l’homme est naturellement porté aux arts, encore faut-il qu’il puisse s’y consacrer et il le pourra d’autant mieux qu’il vit dans une société plus riche, plus puissante : « Nous l’avons déjà dit : tout est lié dans le domaine de la nature ; les progrès en un sens entraînent des progrès dans tous les autres : nous continuerons donc et, de toutes nos forces, nous ouvrirons la voie du progrès. » (p. 11)
Ainsi chemina cette revue, éclectique par les sujets traités mais non, quoi qu’aient pu en dire certains commentateurs modernes [21], par l’inspiration : nourris « aux saines et généreuses doctrines de l’école sociétaire », les rédacteurs utilisent les principes de Fourier pour étayer leurs raisonnements et prennent leurs informations dans les organes de l’École. L’exemple de la Revista Cientifica est particulièrement éclairant : Maciel Monteiro [22] qui signe « M. de M. » tire la substance de ses articles du feuilleton hebdomadaire que Victor Meunier tient dans La Démocratie pacifique (mais aussi dans La Phalange). Il en partage les inquiétudes comme les enthousiasmes pour « cette science où tout s’enchaîne, où tout s’explique, où tout se prouve » [23].
De même, pour informer les lecteurs de l’avancée des idées de progrès dans le monde – en particulier celles que l’école sociétaire défend et propage –, pour leur faire connaître les divers mouvements qui agitent les esprits et les institutions en apparence les plus immuables, O Progresso utilise largement les informations de la presse sociétaire ; ainsi Figueiredo, « O. », traitant des réformateurs modernes, utilise-t-il les articles que La Démocratie pacifique consacre à Johann Ronge, ce prêtre allemand qui, excommunié, créa en 1845 une église catholique allemande dont les premiers succès semblaient préluder à a victoire de « l’esprit d’examen sur le principe de la foi aveugle et de l’autorité infaillible » [24].
Dans le même esprit, O Progresso publie un extrait de l’ouvrage de Franz Stromeyer, publiciste badois, exposé sommaire des idées de Saint-Simon qui, aboutissant à la mainmise sur la société par une « féodalité de la richesse », tout aussi pernicieuse que la féodalité de la naissance, ne peuvent être « la solution du problème social » [25]. Le communisme ne l’est pas davantage qui, par son sectarisme, son anti-christianisme, son radicalisme, pousse les pouvoirs publics à une réaction tout aussi radicale, retardant ainsi le progrès : c’est ce que Clovis Guyornaud, collaborateur régulier (et méconnu), des organes sociétaires, explique dans « Os comunistas alemães nos dous mundos » [26]. Il faudrait aussi citer la collaboration du futur concepteur des ateliers nationaux, François Vidal qui, dans son étude sur la loi agraire aux États-Unis, pronostique une « proche tempête » [27]. Cette tempête que le Pernambouc connaît bientôt, Constantin Pecqueur en décrit les causes dans sa Théorie nouvelle d’Économie sociale et politique dont O Progresso publie, dans son dernier numéro, paru en septembre 1848, un chapitre significatif : « Critique de la Distribution actuelle des instruments de travail et de la Répartition des richesses » [28], sans doute l’article le plus dérangeant publié par O Progresso et qui montre, si besoin en est, que loin d’être une tribune affidée aux conservateurs, la revue exprime une vision fort crue de la société libérale et est proche de ceux qui réclament une meilleure répartition des terres ou une régulation de la concurrence comme mesures nécessaires à la paix sociale et au progrès.
Revue insolite dans le paysage journalistique pernamboucain, par sa forme comme par son fond, revue paradoxale qui doit sa réédition à la célébration du centenaire d’un mouvement insurrectionnel qu’elle a combattu, revue engagée qui expose et propose, à ses lecteurs conservateurs, des solutions radicales pour transformer l’état social, O Progresso, dont tous les rédacteurs se réclament de Fourier et militent pour l’avènement de cette « ère nouvelle, prédite voici quarante ans sous le nom de garantisme par le plus grand génie du siècle : Charles Fourier » [29], est bien une revue sociétaire. Elle est le fruit de cette « transculturation » dont Gilberto Freyre a montré qu’elle était souvent liée à la présence et à l’action des « agents techniques dont l’histoire ne retient pas toujours le nom » et qui, mêlant leur culture à celle des nationaux, la transforment en se transformant.
Transculturation et non acculturation car, tant dans sa pratique quotidienne que dans ses activités professionnelles, Louis-Léger Vauthier, principal vecteur au Brésil des idées sociétaires, s’adapte à son environnement ; certes, il est arrivé au Pernambouc, imbu de sa science et sûr de sa foi, pour y apporter des méthodes modernes d’organisation comme de travail ; sans doute, son Journal, intime et qui le serait resté sans l’action de Freyre, n’épargne pas toujours ses hôtes (ni certains de ses compatriotes) mais il témoigne aussi de son affection pour le pays ; ses aventures galantes, ses dimanches à la campagne, ses discussions avec le président Rego Barros, avec Maciel Monteiro, avec Figueiredo, avec Milet, ses réponses aussi vives que les attaques de ses contradicteurs, partisans de l’immobilisme, et même sa domesticité qu’il met en vente au moment du départ tout comme il met en vente ses meubles, témoignent de son adaptation au Pernambouc, de son intégration ; il ne s’agit pas pour lui d’appliquer des solutions prêtes à l’emploi mais de les adapter aux réalités locales.
O Progresso en est un exemple ; c’est un aboutissement pour Vauthier que la parution de cette revue, en juillet 1846, à quelques mois de son départ ; tout le temps de son séjour, en quelque sorte, il travaille et prépare les esprits, propage les idées, s’appuyant sur Cantagrel et sur Duballen, le secrétaire de l’administration de La Démocratie pacifique avec qui il gère les abonnements et les envois de livres : treize abonnements à La Phalange (dont le sien), les ventes d’ouvrages doctrinaux ne sont pas des résultats négligeables, ni pour le mouvement phalanstérien en général ni pour l’action du propagateur Vauthier [30].
D’ailleurs, à son départ, la revue tient : dix numéros paraissent avant qu’elle ne succombe aux mauvais airs du temps et, probablement, au manque de ressources financières. Vauthier, sans doute, correspond avec ses amis, les conseille peut-être [31] et leur ouvre une nouvelle fois les colonnes de La Démocratie pacifique qui, le 6 novembre 1847, signe une recension louangeuse des trois premiers numéros de l’année parvenus en France :
Ce qui la distingue [la revue] et la place bien au dessus des autres écrits périodiques qui nous viennent des mêmes contrées, c’est une supériorité de vues, une clarté d’exposition et une vigueur de logique dont les journaux fournissent peu d’exemples. Outre les sujets philosophiques et économiques que traite hardiment la revue de Fernambouc [sic], et dont elle fournit le plus souvent des solutions heureuses, elle a présenté quelques travaux historiques, faits d’un point de vue élevé, et chacun de ses numéros contient deux revues politiques, l’une pour l’extérieur et l’autre pour le Brésil, qui sous une forme claire et rapide résument brillamment les événements principaux de l’Europe et du continent américain. Animés à la fois d’un vif amour de la liberté et d’un sentiment profond d’ordre et d’organisation, éclairés d’ailleurs par le flambeau de la science sociale, les dignes rédacteurs du Progresso jettent sur les affaires politiques du monde un coup d’œil perspicace, et montrent avec précision les lignes du mouvement social […]
Ces idées [sur l’impôt sur les successions] présentent bien quelques légères divergences avec celles qui ont été produites par l’École sociétaire sur le même sujet, mais nous pensons que ces dissidences sont plus à la surface qu’au fond, et, quoi qu’il en soit, nous ne pouvons nous empêcher de trouver dans ces lignes beaucoup de clarté et d’élévation. Aussi, encourageons-nous vivement le Progresso à persévérer dans la route où il est entré. Qu’il continue à semer des paroles de progrès pacifique, de liberté et d’organisation chez nos frères de par delà l’Océan, et il aura rendu d’importants services à la sainte cause de l’humanité.
Sans doute, Vauthier est-il conscient de n’avoir pas, pour sa part, démérité [32].
