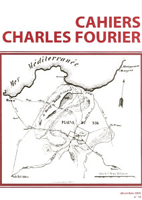
Le rôle joué par le fouriériste français Auguste Savardan (1793-1867) dans la tentative de création de Réunion (Texas) est bien connu. Cet article présente un autre aspect de sa vie : médecin et maire d’une commune rurale de la Sarthe, il voulut, en 1842, y établir un phalanstère. Ce projet sans cesse revu et perfectionné lui inspira livres et articles et lui attira beaucoup d’ennemis, en particulier l’évêque du Mans avec lequel il soutint une mémorable polémique.
De tout temps homme de progrès, aux idées avancées, il embrassa chaleureusement le socialisme, dont il se fit le zélé propagateur, car il avait le courage de ses opinions et ne mit jamais son drapeau dans sa poche. Aussi les honnêtes gens du pays qu’il habitait se liguèrent-ils contre lui avec le clergé qui lui portait une haine bien méritée. Malgré ses qualités bienfaisantes, son entier dévouement au pauvre peuple et les grands services qu’il avait rendus à sa commune (car il n’était pas un administrateur fainéant) ses ennemis parvinrent à indisposer contre lui les esprits de ses administrés... [1]
Ce témoignage dû à un ami d’Auguste Savardan [2] est naïf, mais précieux pour le situer dans une phase de sa vie moins connue que la malheureuse aventure de Réunion et le conflit qui l’a opposé à Victor Considerant [3]. Tout se passe en effet le plus souvent comme s’il n’avait existé que le temps d’un Naufrage au Texas. Or, on s’en doute, Savardan n’a pas toujours été ce vieillard dont la barbe inspirait tant de respect à un Indien Choctaw [4] : il a été un homme jeune, à l’humeur joyeuse, un militant pugnace qui a mené dans sa province natale, la Sarthe, l’existence d’un médecin de campagne et d’un maire de village, et surtout il a tenté d’y mettre en pratique les théories fouriéristes. En quittant Réunion, il déclarait :
La Providence ne m’avait pas créé pour ces ruptures continuelles de relations auxquelles on est condamné pendant de longs voyages, mais bien plutôt pour les affections constantes et non interrompues d’une commune rurale associée comme celles dont Fourier nous a laissé l’admirable constitution [5].
Vœu pieux plus que constatation, puisque la commune telle qu’il la rêvait n’a jamais dépassé le stade du projet, formulé à maintes reprises, perfectionné et corrigé tout au long de sa vie [6].
Fouriérisme et comice agricole
Auguste Savardan est né à La Flèche, sous-préfecture de la Sarthe, le 7 septembre 1793 [7], d’un père marchand épicier, commandant de la Garde Nationale, tout acquis aux idées révolutionnaires. Une pieuse mère, des tantes religieuses et des oncles missionnaires, tout cela n’empêche pas que le jeune Savardan dans son enfance ait assisté à plus de célébrations républicaines qu’à des messes ou des vêpres ! [8] Après quatre ans d’études à l’hôpital de La Flèche, il devient officier de santé, mais prétendant n’avoir été reçu que parce qu’il n’avait fait aucune faute d’orthographe, il part à Paris pour entreprendre des études plus sérieuses : « si la médecine était ce que je savais je ne l’exercerais jamais, mais si elle était autre chose, je voulais essayer de l’apprendre [9]. » En 1818, il devient chirurgien militaire au Val-de-Grâce, où il reste jusqu’en 1831 après avoir soutenu une thèse sur les inflammations des poumons. Il se lie avec des saint-simoniens. En effet, il a cru un temps que
les disciples de Saint-Simon, si forts, si éloquents dans la peinture des misères sociales, si savants, si lumineux dans les hautes questions d’économie, nous réservaient une formule complète d’organisation nouvelle ; mais cette formule leur manquait et leur concile s’est dispersé sans conclure [10].
Quand découvre-t-il Fourier ? Peut-être à Arras où il rencontre un jeune juriste, Adolphe de La Fontaine-Solare, qui a monté un cabinet d’assurances mutualistes. Vers 1835, tous deux décident de se lancer dans un projet d’association agricole en achetant un bien national, le château de La Chapelle-Gaugain, une commune d’un peu plus de 700 habitants située à dix-huit kilomètres de Saint-Calais, dans le canton de La Chartre, à petite distance du Loir. Devenu maire de son village et contemplant ses arbres fruitiers et ses rosiers, Savardan voit avec joie refleurir ce domaine qui a appartenu à la famille de Ronsard :
puisse cet illustre poète, ce joyeux prieur de Saint-Côme de Tours, quand nous le rencontrerons dans une autre vie, nous accueillir avec le sourire d’un bon maître qui reçoit le fermier dont les travaux ont arrosé, planté, peuplé, fertilisé et orné la terre qui lui avait été confiée... [11]
Mais cet heureux propriétaire terrien, n’a pas pour autant renoncé à sa profession première :
le titre de docteur imprime comme celui de prêtre, comme celui d’ingénieur et même comme un titre de noblesse, un caractère indélébile qui oblige celui qui en est revêtu à payer de sa personne toutes les fois que la confiance fait appel à la science qu’on lui suppose. Il y a d’ailleurs la question de charité qui oblige tout le monde [12].
Ses théories médicales ont de quoi surprendre : les ventouses sont, selon lui, une panacée donnant des résultats inespérés aussi bien contre la phlegmonie pulmonaire que contre les hémorroïdes ou la surdité. Cela n’empêche pas Le Bonhomme manceau, journal des démocrates de l’Ouest, de voir dans le docteur Savardan « un bon et franc médecin de campagne qui passe son temps à être utile au peuple [13]. »
En janvier 1839, il est élu membre correspondant de la Société d’agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe. Donnant un avis éclairé sur l’éducation des vers à soie ou faisant don d’une médaille antique découverte dans ses champs, il est parfaitement à sa place dans cette illustre compagnie qui « réunit à peu près tout ce que le pays possède d’hommes cultivant les sciences et les lettres [14] », et échangeant dans leurs réunions mensuelles des informations sur la destruction du hanneton, la culture du prunier robe-de-sergent, ou l’utilité de la musique dans l’instruction primaire. Rien d’étonnant donc à ce qu’on le charge de faire un rapport sur l’état de l’agriculture à la Chapelle-Gaugain et dans les communes voisines, Ruillé-sur-Loir, Poncé et Lavenay. En effet, agriculture et agriculteurs végètent malgré de timides innovations : en 1838, on a suggéré l’introduction d’un meilleur système d’assolement, de nouvelles cultures, colza et betteraves, et comme le comice agricole est entré dans les mœurs sarthoises, on a décerné un prix à la plus belle jument et au plus beau verrat, mais on en est resté là.
On attend donc beaucoup du rapport demandé au docteur Savardan, et, à première vue, le sérieux de l’étude, présentée à la séance du 1e mars 1842, inspire confiance [15] : trente pages où rien n’est dissimulé d’une triste réalité, et qui traitent successivement des habitations, de la vie de l’agriculteur, de l’état du mobilier agricole, de la culture des terres. Un véritable mémoire, résultat d’observations faites à la fois par un médecin et par le premier magistrat d’une commune, une réflexion « conçue au milieu des soins et des habitudes vulgaires de la pratique médicale et de l’agriculture dans une pauvre commune rurale. » Sondant les reins et les cœurs, tout en prescrivant des ventouses, le docteur Savardan a observé la vie qu’on menait dans ces masures, noté ses conversations avec les paysans et il a constaté que toute proposition nouvelle en vue d’améliorer une agriculture en piètre condition se heurte à un refus motivé par la routine :
dans l’état d’isolement où chaque travailleur est réduit, dans l’obligation où il est, lui, pauvre laboureur, souvent peu intelligent et toujours si peu, si mal, ou point instruit, de se suffire toujours à lui-même dans les branches si variées de l’administration agricole ; de posséder à lui seul et quelque peu qu’il s’en doive servir, tous les objets nécessaires à une exploitation rurale, cet homme, Messieurs, ne peut vivre qu’au jour le jour, et lui parler d’améliorations, de changements de méthodes, d’achat de meilleurs bestiaux et de meilleurs instruments, enfin de sacrifices et d’avenir, c’est ce dont on n’a plus le courage, quand on a sérieusement pris la peine de compter avec lui.Et ne croyez pas, Messieurs, que ces obstacles à vos intentions ne se trouvent que chez le cultivateur presque pauvre ; ils se trouvent partout ; car partout l’homme, abandonné à ses propres forces, subit la dure nécessité de son isolement, et de son antagonisme.
Le bilan est affligeant. Un habitat rural dont la construction est « marquée au coin de l’imprévoyance et de l’ignorance les plus complètes » : des « cours servant d’égout aux fumiers et aux étables », des murs de terre, des « étables fangeuses » et leurs « miasmes putrides ». Des paysans nourris de pain noir, de mauvais fruits, de fromages infects, dormant dans une literie malsaine, et souffrant de phtisie, d’affections vermineuses, d’ophtalmies, de dartres, de scrofules et de rachitisme. Une mortalité « un dixième au moins plus grande qu’à Paris même. » Même misère sur le plan moral : un peuple sans instruction, livré à des maîtres d’école ignorants, qui ne respecte ni la justice ni la propriété et auquel manquent « la sollicitude, le zèle des hommes éclairés ». Un bétail en aussi mauvais état que le matériel, des méthodes de culture archaïques.
Mais Savardan ne saurait en rester là. A titre d’exemple, il fait, pour la seule commune de la Chapelle-Gaugain, une étude statistique où il évalue le capital. Après la morosité du premier constat, c’est l’allégresse du théoricien qui va enfin pouvoir vérifier ses hypothèses et passer à l’action. Évaluation des terres labourées, prairies, pâtures, landes, taillis, vignes, jardins, mares et viviers, des bâtiments et usines (210 maisons et leurs étables, 3 moulins à farine), du mobilier personnel, animaux et matériel agricole... il ne manque à cet inventaire que les volailles et les ruches ! Il lui faut aussi évaluer le travail : « celui de 125 hommes de 18 à 60 ans à 1 F par jour pendant 100 jours = 12 500 F, à 1,25 pendant 200 jours = 31 500 F, celui de 150 femmes à 60 c par jour pendant 100 jours = 9 000 F, à 75 c pendant 200 jours » et ainsi de suite... Même récapitulation des dépenses. Et c’est la surprise :
il reste donc pour triste résultat qu’avec un capital de quinze cent mille francs et un revenu de trois cent mille, deux cent familles, formant une population de 700 et quelques personnes, ne peuvent obtenir, par un travail pénible et continu, que des habitations insalubres, une nourriture malsaine, une instruction mauvaise, et enfin un état de vie qu’on ne calomnie nullement en le nommant la misère, la misère intellectuelle, morale et matérielle.
A ce moment de son exposé, il est temps pour le docteur de proposer le remède. C’est alors que sous les yeux inquiets de certains membres de la société savante le disciple de Fourier apparaît. Le propos devait porter sur l’agriculture et voilà qu’il est question d’harmonie, d’organisation sociale et de bonheur pour tous. Qu’ose-t-il dire de la religion :
en ne nous donnant pas elle-même la formule de l’organisation sociale la plus propre au bonheur immédiat de tous, et en nous disant : Cherchez et vous trouverez, [elle] a évidemment voulu, que tout en suivant ses préceptes, pour l’autre vie, notre intelligence eût, pour celle-ci, la liberté de chercher, le mérite de trouver.
Que prétend-il de la politique :
partout, sous tous les gouvernements, même les plus paternels, ce qu’on nomme le peuple est et a toujours été, à peu de choses près, dans le même état de mal aise, et la poule au pot d’Henri IV n’était que le rêve d’un bon roi, à moins qu’il n’ait emporté dans la tombe, le secret de nous faire produire plus, et de nous faire dépenser mieux.
Sont écartés de la même façon, comme inadéquats pour transformer une société rurale la réforme électorale, la république, le communisme et le système égalitaire : avant de voter, il faudrait d’abord que les paysans soient instruits.
Un seul remède donc : l’association du capital, du talent et du travail. « Supposons... » ce mot qu’il répète avec enthousiasme est un véritable sésame qui doit ouvrir devant les membres de la Société d’agriculture les portes d’un nouveau monde. Qu’ils supposent donc que les deux cents chefs de famille demandent à un notaire de rédiger un acte d’association et qu’une sage administration se constitue dans la commune... Tel Perrette comptant non pas ce que lui rapportera le lait, mais ce qu’il a rapporté, Savardan voit déjà vivre sa commune rurale sociétaire où on a construit un bâtiment aussi vaste que « l’école de La Flèche [16], l’hôtel des Invalides et le Palais-Royal de Paris », dans lequel ses villageois trouvent des logements en rapport avec ce que chacun peut ou veut dépenser. Une vaste cuisine, des salles de diverses dimensions pour les repas, les réunions, la lecture, les jeux, un établissement de bains, des écoles,
une seule cuisine, un seul moulin à farine, une seule boulangerie, une seule boucherie, une seule cave, alimentés presqu’uniquement des produits de la commune et les livrant au prix coûtant.
A chacun 750 g de pain blanc, 250 g de viande, des fruits, des légumes ou du laitage, un litre de cidre ou de piquette, un demi-litre de vin, en voilà pour 50 centimes par jour d’une nourriture « agréable, saine et abondante » qui remplace « l’espèce de poison lent avec lequel nos cultivateurs ne font presque aujourd’hui que tromper leur faim. »
Une seule écurie au lieu de 70, 3 ou 4 étables au lieu de 174, le cheptel s’est accru de belle façon, grandissant en nombre et en qualité, ainsi les moutons ne sont plus 450 mais 2 000... Et que dire d’autres moyens « d’accroître encore la prospérité de la commune par une foule de petites industries dont les cultivateurs intelligents savent tirer un grand parti ! » Il n’est pas jusqu’aux terres incultes du sommet des coteaux qui ne deviennent source de profit :
la commune sociétaire [...] s’est empressée de rayer ces 246 hectares du nombre des terres labourables, et d’y planter 30 000 châtaigniers greffés auxquels le sol de ces terres convient parfaitement et qui auront coûté 45 000 F. L’intérêt à 5 % de cette avance est largement couvert chaque année par des semis, entre les lignes d’arbres, de chicorée sauvage, de piloselle, de centaurée noire, de boucage, de pimprenelle, de sanguisrobe et surtout de topinambours, qui fournissent pour les bestiaux, et presque sans culture, d’abondants et précieux aliments.
L’étude se termine en apothéose. Savardan ne suppose plus, n’imagine plus, il s’est projeté dans l’avenir, il contemple son œuvre :
dans le court espace de vingt ans, nous avons remédié au déboisement des sommets de nos coteaux, nous avons créé des abris pour nos autres terres contre les mauvais vents, nous les avons préservées des grandes sécheresses qui détruisent si souvent, en été, nos moissons ; nous avons élevé 30 000 conducteurs naturels du fluide électrique, 30 000 paratonnerres, et exercé ainsi une miraculeuse influence sur notre climature...
La conclusion s’impose, et enfin, le nom redouté est prononcé : « ce qu’il faut à notre société, pour en guérir le dangereux malaise, c’est une organisation plus complète et plus puissante, organisation dont la formule tout entière, existe dans les livres de Fourier et dans les enseignements de son école. » La péroraison est triomphale :
réunis dans l’intérêt de l’agriculture, ne perdons pas notre temps en efforts stériles. Pour moi, persuadé qu’il y aura de l’honneur, beaucoup d’honneur pour le premier comice qui élèvera la voix en faveur d’un essai d’association communale, je n’hésite pas à vous proposer d’émettre le vœu que tous les comices renoncent d’un commun accord, à la part qui leur est faite dans le budget de l’état, et qu’ils y joignent leurs subventions particulières, à la condition que la somme entière soit consacrée à l’établissement du premier phalanstère.
Bien entendu, le triomphe est de courte durée. Des journaux sarthois crient au scandale devant ces conceptions « puériles » empruntés à « des utopistes ». Le phalanstère, remède aux plaies sociales ? allons donc ! autant vouloir guérir les plaies du corps avec de l’eau de Cologne ! A la séance de fin d’année, pourtant, faisant le bilan des travaux de la Société, le secrétaire félicite le docteur Savardan qui a dressé cette statistique « avec un talent et une précision d’éloges », et il nuance les réserves que l’audacieux rapport a pu susciter :
si les utopies que suggèrent ainsi les vives impatiences de M. Savardan semblent à votre société des innovations périlleuses, il n’en reste pas moins établi qu’il est urgent d’apporter des réformes, partielles, sinon générales, qui puissent venir en aide à notre agriculture [17].
Le texte sera publié dans le bulletin, c’est inévitable ; toutefois, par prudence on y ajoute une note qui se termine ainsi : « quant au fouriérisme dont l’auteur propose l’application comme moyen de remédier aux souffrances qu’il signale, la Société n’entend prendre aucune solidarité sous ce dernier rapport. »
La tiédeur de l’accueil ne décourage pas Savardan qui va reprendre, perfectionner, peaufiner son projet de phalanstère dont il a vite compris par où il pêchait. Il lui suffit de regarder sa commune « telle qu’elle est » pour comprendre ce qu’il faudrait faire pour la transformer. La description qu’il donne du monde rural [18] préfigure celle que Zola fera dans La Terre. Enfants d’une saleté repoussante, dévorés par des porcs ou des rats, vieillards qu’on laisse mourir sans autre commentaire que « si le Bon Dieu en a besoin, faut pas qu’il s’en prive », ivrognes qui ont « la cruelle et stupide idée de faire boire aussi et d’enivrer leurs pauvres enfants », femmes « fanées, ridées, édentées » vieillies par un labeur épuisant, paysans chicaniers, âpres au gain comme celui dont la femme est malade et qui vend son bois à un menuisier en disant à celui-ci : « va pour le prix que vous m’offrez, mais par-dessus le marché, vous me ferez le cercueil de ma femme ! »
S’appuyant sur chacun des Dix Commandements, Savardan fait le point sur la misère, l’ignorance, la détresse, l’immoralité, ou les pratiques superstitieuses des villageois : « Dieu y est redouté sous la forme de ce vieillard à longue robe et à longue barbe, qui, les bras étendus, chasse Adam et Eve du paradis terrestre, lance sur la terre, pour la punition des méchants et souvent pour éprouver les bons, le tonnerre, la grêle, etc. » L’Église n’offre à ses fidèles « qu’une cérémonie totalement incomprise où l’on dort le plus souvent » ; les amours villageoises fourniraient maints exemples de manquement au IXe commandement ; le bien d’autrui n’est guère respecté ; le prochain n’est pas considéré comme un frère, et l’égoïsme règne en maître. Curés et maîtres sont donc impuissants devant une telle situation qui perdure depuis des siècles :
c’est en vain qu’on prêche l’amour de Dieu et du prochain, contre lequel luttent sans cesse, avec les plus tristes succès, des passions et des besoins qui, faute d’organisation, n’ont pu être satisfaits jusqu’ici qu’au bénéfice de l’égoïsme et au détriment de la charité.
C’était là le point faible de son premier projet : comment des individus qui souffrent dès l’enfance pourraient-ils échapper à une véritable détérioration matérielle et morale ? Si l’on veut que tout change, si l’on veut vraiment venir à bout du paupérisme, il n’y a qu’un seul moyen : l’éducation sociétaire des enfants. Mais il faut les soustraire à la contagion des adultes, à l’exemple lamentable donnée par la famille.
L’expérience sera donc menée avec des orphelins. D’où un projet d’asile rural pour les enfants trouvés, qui a retenu l’attention du Conseil général de la Seine en 1847 mais qui n’a pas été mis en pratique [19]. D’où ces ouvrages (sans parler des articles et de certaines études reprises en 1866 dans le dernier livre de Savardan, Avenir) : c’est d’abord en 1848, l’Asile rural des enfants trouvés. Crèche, salle d’asile, école primaire, école professionnelle, ferme modèle, association libre des élèves à leur majorité, puis l’année suivante Défense des enfants trouvés et de leur asile rural. Observations soumises à MM. les membres de la commission départementale de la Seine, et enfin, en 1860, L’extinction du paupérisme réalisée par les enfants, ou La Commune telle qu’elle est et telle qu’elle pourrait être. Il s’agit de créer « une grande famille dans laquelle l’éducation religieuses, intellectuelle et industrielle sera soumise à une direction unitaire » et c’est une expérience de longue haleine : « un édifice qui n’a pour base que des berceaux ne peut pas être jugé avant la majorité des enfants auxquels ces berceaux sont destinés. » On en devine la structure : une crèche modèle, une salle d’asile, puis l’école primaire et enfin une école professionnelle pourvue d’ateliers, de dortoirs, d’un restaurant, de bibliothèques. Plus de morcellement des terres mais une exploitation en commun, des cités agricoles et des associations de familles, car il va de soi que dans ce projet à long terme, les orphelins du début de l’expérience se marieront, auront à leur tour des enfants. Plus d’ouvriers ignorants mais des « travailleurs instruits, bien élevés et rendus heureux par les bienfaits de l’association », plus de fils reprenant sans goût le métier du père : « toute vocation étouffée est un malheur individuel ainsi qu’une perte et un danger pour la société » (et comme il aime étayer sa démonstration d’exemples concrets, il raconte l’histoire du petit bûcheron qui aurait tant voulu être horloger et qui en est réduit à voler des outils, alors que « dans un meilleur ordre de choses » il aurait pu « être, très honnêtement, un Vaucanson ou un Bréguet. ») Dès leur plus jeune âge les enfants pourront s’informer sur les différentes professions, en regardant travailler un maçon, un forgeron etc. :
afin qu’aucune des aptitudes que Dieu a créées ne puisse, faute d’aliment, s’égarer et se perdre, et que les natures exceptionnelles, les génies que la Providence sème quelquefois aussi volontiers dans les chaumières que dans les palais, ne soient pas étouffés ou viciés dès leur naissance et qu’il soit possible de les diriger plus tard vers les écoles supérieures qui doivent les compléter et les aider à accomplir, dans l’intérêt de l’humanité, toute leur destinée.
S’il est utopique, le projet de Savardan n’est pas fantaisiste. Comme celui qui concernait la transformation de l’agriculture à La Chapelle-Gaugain, il est soigneusement chiffré et fourmille de détails minutieusement élaborés. Ainsi, pour économiser la main d’œuvre, les berceaux de la crèche sont équipés de poulies et de cordons de telle façon qu’une seule nourrice puisse bercer plusieurs bébés en même temps sans quitter sa chaise ou son lit. Tout est évalué, le coût du chauffage et des vêtements, le salaire des nourrices et celui de leurs maris qui sont employés sur la propriété, aussi bien que les bénéfices apportés par les menus travaux des enfants :
un double décalitre de glands se vend en moyenne 75 c. J’ai vérifié que des enfants de 2 à 3 ans en ramassaient en s’amusant un litre en 20 minutes. Qu’on répète deux fois par jour seulement un pareil exercice, et de même pour des noix, des cormes etc...
Même précision en ce qui concerne la nourriture : potages gras, œufs, un peu de viande, légumes frais, purées de légumes secs, fruits cuits, le tout pour « la modique somme de 3 700 F »...
Comme à la salle d’asile l’enseignement sera mixte à l’école primaire, la preuve a déjà été faite, par exemple en Suisse, que « l’éducation simultanée des deux sexes et leur réunion fraternelle dans les travaux, offrent, au lieu de grands inconvénients [...] de précieux avantages que ne produit jamais leur séparation. » Les enseignantes auront été formées au Cours pratique pour la direction des salles d’asile créé par Marie Pape-Carpantier [20] :
elles savent rendre le travail attrayant, en le variant, en n’y consacrant que de courtes séances, en l’entremêlant de jeux et de chants, en étudiant les aptitudes, les vocations, en aidant à leur éclosion et en les dirigeant, sans contrainte, par attrait, dans leurs justes développements.
Et voici un Savardan féministe qui apparaît et qui n’entend pas confiner les femmes auprès des tout-petits à l’école maternelle. N’y a-t-il pas déjà des institutrices à l’école primaire, et d’une valeur telle qu’elles ne font pas regretter les instituteurs ! Allons donc plus loin et ouvrons-leur « de nouvelles carrières remplaçant celles que les hommes leur ont enlevées » :
si elles ont été, presque partout, bannies du commerce, où des hommes passent bravement leurs journées à auner et à plier des étoffes, il appartient au gouvernement, au fur et à mesure des retraites des instituteurs de réserver pour les femmes 30 à 40 000 places qui commenceraient à les dédommager peu à peu des empiétements si nombreux dont elles sont les victimes.
D’où une nouvelle évaluation dans sa commune modèle : 9 à la crèche, 7 à l’école primaire, 7 à l’école secondaire = 23 femmes. 23 femmes dans les 34 000 communes rurales de France = « 782 000 places assurées aux femmes ! » Et à ceux qui ressasseront les habituels arguments sur l’infériorité féminine, Savardan donne une réponse concrète et imparable :
le travail d’une cuisinière est-il à mérite égal, inférieur à celui d’un cuisinier ? assurément non et partout il est toujours beaucoup moins payé. La femme qui soigne une basse-cour, une laiterie, une fromagerie rend-elle moins de services que le jardinier qui bêche ou arrose un jardin ? La femme, attachée à des services plus délicats en doit-elle tirer moins de produit que l’homme chargé de travaux qui ne demandent que plus de force matérielle et moins de délicatesse ?
On s’attend presque à le voir réclamer la parité ! Inutile de préciser que la revendication de Savardan n’est pas plus entendue que celles qui concernaient l’agriculture...
L’évêque et le phalanstère
En conclusion de son étude sur la commune « telle qu’elle pourrait être », Savardan écrit qu’il avait voulu démontrer que l’extinction du paupérisme « n’est ni un rêve ni une transgression de la loi de Dieu. » S’il insiste ainsi dans ce texte publié en 1860, c’est pour faire écho à une querelle qui s’inscrit dans les combats menés contre les phalanstériens et qui l’a opposé en 1845 à l’évêque du Mans.
Bien entendu, l’évêque est au premier rang des adversaires du fouriériste de La Chapelle-Gaugain. La situation se complique même du fait que les deux hommes se connaissent bien : Mgr Bouvier a été le professeur du jeune Savardan qui, devenu maire, le reçoit solennellement en avril 1842 dans sa commune ; le prélat, dans son homélie, expose alors « la nature et la similitude des devoirs dans toutes les positions sociales et le bonheur qui résulte de leur accomplissement [21] ». Cette même année Savardan publie un petit opuscule où il reprend le texte de son rapport à la Société d’agriculture sous le titre : De l’association appliquée aux communes rurales. Naïveté, malice, ou plutôt désir de convaincre envers et contre tout, il l’envoie à son ancien maître... Nous ignorons les réactions immédiates de l’évêque mais, en 1845, dans son mandement pour le temps du Carême lu en chaire dans toutes les paroisses, il met violemment en garde ses paroissiens contre les disciples de Fourier :
Grâce à Dieu, le nombre des Insensés qui s’épuisent en vains efforts pour expliquer, par d’absurdes systèmes, les merveilles dont le monde est rempli, n’est pas grand dans nos provinces ; ils se cachent et n’osent révéler au grand jour leur doctrine s’ils en ont une. Nous ne chercherons pas, Nos Très Chers Frères, à vous conduire au travers des ténébreuses régions intellectuelles où se discutent de fantasques opinions heureusement inconnues parmi vous. Vous ne comprendriez pas même les sonores dénominations de Panthéistes, de Phalanstériens, de Socialistes et autres semblables de création récente ; nous vous en félicitons [22].
L’évêque ne recule pas devant les contre-vérités ! Même s’ils ne sont pas très nombreux, les fouriéristes existent en Sarthe : les amis de la pédagogue Marie Pape-Carpantier [23] - le Fléchois J.-F. Philippe de Neufbourg, des Manceaux comme le professeur de mathématiques Jules Chassevant ou le poète Félix Milliet, orateur d’une loge maçonnique - ne font pas mystère de leurs opinions, surtout lorsqu’ils les exposent dans ces journaux si souvent saisis, Le Bonhomme manceau ou Jacques Bonhomme. Au cours de joyeuses parties de campagne en famille, Chassevant prend même un malin plaisir « à scandaliser la galerie par des paradoxes les plus osés » et à développer devant les mines effarées des paysannes « les terribles théories de Fourier sur l’amour et le mariage [24]. » Quant à la presse locale, on y découvre de temps en temps des placards publicitaires pour la librairie sociétaire de Paris qui propose les Œuvres complètes de Fourier, l’Almanach phalanstérien ou la Théorie de l’éducation naturelle et attrayante de Considerant. Savardan envoie à l’évêque une de ces longues lettres dont il a le secret, une lettre d’autant plus longue qu’il a l’intention de la publier pour que nul n’en ignore. Lettres de l’un, réponses de l’autre, l’affaire s’étale sur deux ans avant d’être présentée, en 1846, par Savardan dans un petit livre de trente pages au titre provocateur, Monseigneur l’Evêque du Mans et le phalanstère. Correspondance avec l’évêché suivie d’un chapitre intitulé Le Curé, extrait d’un travail inédit ayant pour titre La Commune rurale (Ce qu’elle est et ce qu’elle pourrait être). Circonstance aggravante aux yeux de l’ecclésiastique, le volume est vendu un franc au profit de l’œuvre phalanstérienne.
L’exergue donne le ton, une phrase de l’Evangile selon saint Mathieu : « ego autem dico vobis : qui autem dixerit fratri suo fatue, reus erit gehennae ignis [en vérité je vous le dis : qui dit à son frère insensé, périra dans les flammes de l’enfer]. » Puisqu’il s’adresse à son ancien maître, et tout en multipliant les protestations de respect, Savardan va lui montrer qu’il n’a pas oublié son latin, pas plus qu’il ne méconnaît l’enseignement du Christ. Devrait-il, comme Saint Pierre a renié Jésus, renier les insensés avec lesquels l’évêque le range ? Pas du tout ! « Du reste, Monseigneur, le coq a pu chanter sans troubler ma conscience » s’écrie-t-il avant d’énumérer toutes les raisons qu’il aurait pourtant eu de pleurer : parce que l’évêque a voulu déconsidérer « ceux qu’anime la charité évangélique [...] qui consiste à vouloir du bonheur pour tous, et aussi bien dès ce monde... », parce que son jugement et sa prudence habituels ont succombé « à cette espèce d’idéophobie qui rend aujourd’hui le clergé catholique si agité et peut-être si agitateur » puisque celui-ci persiste « à refuser sans examen, à injurier et à persécuter, comme au temps de Galilée, au lieu de s’en aider, toute vérité qu’il n’a pas inventée ou qui ne lui a pas demandé la permission de naître ». Pour expliquer l’aveuglement de l’évêque, une seule raison : il ne l’a pas lu ! Sinon, il aurait vu que
préoccupée uniquement de cette charité, de cette fraternité universelle pour le triomphe de laquelle le Christ a dicté l’Evangile et s’est laissé crucifier, la doctrine phalanstérienne, sans dénier autrement au clergé ses droits à diriger l’humanité dans la recherche du Royaume de Dieu a pour but d’apporter au monde la réalisation de tout ce reste qui nous a été, non moins solennellement, promis par surcroît, et dont, faute de mieux, l’Eglise n’a su encore que conseiller, comme un devoir, l’abnégation au peuple.
Mgr Bouvier répond brièvement le 24 mars 1845 et prétend n’avoir eu aucune intention politique ; il n’avait que des préoccupations religieuses : « il ne suffit pas que des écrivains empruntent quelques vérités à la foi catholique qu’ils exploitent ensuite à leur gré pour qu’un évêque ne se croie pas obligé de repousser leurs erreurs, mais en les condamnant, il se fera toujours un devoir de respecter les personnes. » Aurait-il marqué un point ? Non, car Savardan relance la polémique. En janvier suivant, c’est à dire quelque temps avant le Carême de 1846, le voilà qui ironise : en prononçant le nom de « phalanstérien », l’évêque a « ouvert infailliblement dans les esprits la porte au démon de la curiosité », les paroissiens vont vouloir en savoir plus et d’ailleurs, journaux, idées et livres phalanstériens se sont « notablement répandus dans le diocèse » depuis un an. Il faut donc que, dans son prochain mandement, Mgr Bouvier fasse une distinction entre les phalanstériens qui veulent détruire les principes du Christ, et ceux qui « comme [Savardan] respectent la religion tout en se vouant à l’étude d’une science destinée à changer en bonheur les maux qui désolent l’humanité. » L’occasion est bonne de se lancer dans une profession de foi : cette science « a pour base les lois établies par Dieu pour maintenir l’ordre dans l’univers. » Suit un exposé sur l’harmonie, accompagné de citations d’Isaïe et d’un semblant de confession :
on vous dira peut-être, Monseigneur, que les phalanstériens ne sont pas tous des catholiques très fervents et peut-être moi-même, aurai-je ma part de ce reproche, mais qu’importe à la science ?
Devrait-on également repousser les progrès de la médecine sous prétexte qu’Hippocrate adorait les faux dieux ?
Cette fois, c’est plus que Mgr Bouvier ne peut en entendre. Il se tait officiellement et charge son vicaire général de répondre, ce qui ne trompe personne. Commence alors une attaque en règle des doctrines fouriéristes traitées d’« idées fantasques » et de « rêveries bizarres » :
ce n’est pas parce qu’on aura jeté ça et là, les noms de religion, de Dieu, de vertu, dans plusieurs volumineux ouvrages, où il n’est question que de voluptés érotiques et gastronomiques qu’on pourra dire qu’une doctrine répond aux besoins moraux de l’homme.
Le vicaire ne veut pas en dire plus, certaines citations « le font rougir » : « les mœurs phanérogames et gastrosophiques ne sauraient conduire à la vertu ni au bonheur, ni dans ce monde ni dans l’autre. » Voilà qui pourrait consterner Savardan : en fait, il n’attendait que cela. S’épanouissant manifestement dans la polémique, il répond par une lettre de neuf pages :
y aurait-il donc tant de mal à adapter un ordre de choses dans lequel les passions de la chair, les cinq sens du pauvre [...] seront tous les jours honnêtement récréés comme le sont ceux du riche, un ordre de choses dans lequel le pauvre, cessant d’être entouré du hideux et douloureux cortège de sa misère, pourrait, comme le riche, mais dans de justes proportions et de justes bornes fixées d’après l’apport de chacun en capital, en travail et en talent, s’initier chaque jour par l’exercice perfectionné de ces cinq sens aux idées du bon et du beau en toutes choses, idées auxquelles (ce me semble, et si j’en crois ce saint qui manquait toujours de ferveur quand il avait faim ou froid) ne pourrait que gagner le développement du sentiment religieux ?Y aurait-il du mal encore à adapter un ordre de choses dans lequel l’amitié, l’amour proprement dit, puis l’amour de la gloire ou l’ambition, et l’amour des enfants, ces quatre passions du cœur, évidemment encore sorties de la main de Dieu pour le bonheur de l’homme, trouveraient la possibilité de se développer librement et religieusement, sans rencontrer les obstacles actuels des intérêts divergents et de l’envie, des alliances de toute nature appréciées et contractées au seul poids de l’or, et enfin des éducations telles que le hasard ou le caprice les fait au sein des familles ?
[...] y aurait-il donc du mal à adopter un ordre dans lequel, toujours sous la haute direction des lois de la religion et de la morale, ce faisceau de passions, qui est l’homme tout entier, pourrait trouver un juste et libre essor ?
Si l’évêque et son vicaire général rougissent devant certains passages de Fourier, Savardan, lui, ne craint pas de revenir sur les théories sexuelles de celui-ci :
qu’importe donc que Fourier, dans son immense imagination, ait trouvé une cosmogonie, une analogie universelle, qui pour votre esprit prévenu et défiant, comme l’esprit de tout le clergé à l’endroit des idées nouvelles, ressemblent à des folies ou à de coupables erreurs, qu’importe donc qu’il ait pensé que le mariage pourrait ou devrait dans quelques centaines d’années subir, mais à condition du consentement universel, sous la sanction des pères et des prêtres d’alors, des modifications qui, dans ce même esprit de progrès et de justice auquel nos lois durent les séparations et le divorce, en feraient disparaître les inconvénients, le dégoût et l’ennui, l’oppression d’un des conjoints par l’autre, la discorde, l’hypocrisie, la haine, l’adultère, l’empoisonnement et le meurtre. Qu’importent que ses idées à ce sujet fussent même immédiatement condamnables, puisqu’elles sont totalement en dehors de la théorie sociétaire, qu’elles n’en font aucunement partie, ce que Fourier et son école ont maintes fois et hautement déclaré de la manière la plus formelle.
Comme si de tels arguments n’étaient pas suffisants, il en ajoute un dont l’effet ne pourra être que désastreux : « Jésus-Christ, lui aussi, pour son indulgence envers la Magdeleine et la femme adultère ne fut pas à l’abri du reproche d’immoralité, d’impureté et de corruption. »
Mais puisqu’il faut revenir à la doctrine phalanstérienne qui était à l’origine de la controverse, Savardan affirme à nouveau qu’elle a pour but le bonheur de l’humanité, et cela, sans attendre la félicité promise dans une autre vie. Soudain, plus de précautions oratoires, plus de protestations de respect ; il passe littéralement à l’attaque, ou plutôt il riposte :
quel avantage le clergé trouve-t-il donc à n’être pour ce monde, comme Jérémie, qu’un prophète de douleurs et de misères ? Les textes sacrés qui nous promettent le bonheur ici-bas seraient-ils donc moins sacrés que ceux qui nous parlent des souffrances de l’humanité ? Ne serait-ce pas un aveu tacite d’insuffisance que de nier ou de dénaturer le sens des textes d’espérance et de consolation et de proclamer l’éternité des souffrances ?Et n’est-il pas évident, Monsieur, que dans nos citations opposées, celles que j’ai choisies ont l’avenir pour objet, tandis que les vôtres se rapportent au temps où vivait Jésus-Christ ?
Pour finir, il conseille au vicaire, et, bien entendu, à travers lui à l’évêque, de relire (de lire ?) Fourier et les derniers numéros de La Phalange, ce qui leur éviterait des allusions erronées au traité d’association. Et surtout, que l’évêque retire sa condamnation de ceux qu’il a appelé des Insensés :
j’ose attendre de votre esprit de justice que vous chercherez dorénavant les grandes idées fécondes et saintes vérités répandues à pleines mains dans les œuvres de Fourier, que vous les chercherez et que vous les étudierez avec autant de zèle que vous en avez mis à y trouver des erreurs et des énormités qui n’y sont pas.
On devine que Mgr Bouvier ne répondra pas à cette suggestion, pas plus qu’il ne fera amende honorable dans son mandement de Carême. Toutefois, c’est Savardan qui a le dernier mot. Et quel mot ! il ajoute à la suite de la citation de saint Mathieu qu’il a placé en exergue, les dernières paroles de Jésus : Consumatum est...
Il y a du Don Quichotte chez Auguste Savardan et les moulins à vent n’ont pas manqué sur son chemin : violence haineuse des ouvriers agricoles prenant pour une guillotine destinée à les supprimer la machine à battre qu’il avait achetée ; hostilité de ses confrères de la Société de médecine de la Sarthe devant son étude sur l’organisation d’un service médical pour les pauvres des campagnes (mémoire aussi précis que celui qu’il a présenté à la Société d’agriculture), ou devant son Dernier examen de conscience d’un médecin, où il osait leur prescrire de faire cet « examen de conscience » qui peut seul
empêcher de se routiner, de persister et de s’endormir dans des pratiques malheureuses et qui porterait encore de plus précieux fruits, s’il pouvait [...] nous amener tous, à déposer de temps en temps sans réserve notre bilan médical et à nous confesser ainsi les uns aux autres [25] ;
Et aussi : incompréhension rencontrée par tous ses projets, qu’il s’agisse d’un phalanstère ou plus modestement d’une salle de réunion où les jeunes du village pourraient chanter, danser et lire le dimanche. Seules une boulangerie sociétaire dans un village voisin, Bessé-sur-Braye, et une société de secours mutuels semblent avoir vécu quelque temps. Pour compléter son portrait, il faudrait relire, il faudrait citer, il faudrait...mais il y a tant de choses à découvrir chez ce fouriériste si mal connu !
A son ami anonyme qui rédigea la notice citée plus haut, il répondait lorsque celui-ci lui demandait pourquoi, à son âge, il s’embarquait pour le Texas :
ces idées sont ma foi politique. Bien établies, je les crois capables plus qu’aucunes autres, de rendre les peuples heureux. C’est l’amour, la liberté, l’égalité, la justice en un mot, régnant sur l’espèce humaine, mauvaise peut-être, mais plus par l’éducation qu’on lui fait que par sa propre nature. Eh bien ! je veux vérifier par moi-même si l’établissement et le triomphe de cette religion sociale peut se réaliser aujourd’hui. Je suis vieux, me dites-vous, c’est précisément pour ce motif que je suis pressé d’agir sans retard. Je comprends les missionnaires chrétiens, l’esprit de prosélytisme qui les pousse aux plages lointaines, inconnues, barbares, où ils prévoient cependant qu’une mort plus ou moins cruelle les attend presque toujours. Eh bien, nous devons les imiter. Apôtres d’une foi nouvelle, pour la prêcher avec succès, avec une autorité digne d’être écoutée, nous devons payer d’exemple. Je veux voir, je veux essayer, et je pars sans regarder en arrière. L’avenir est au socialisme, soyez en sûr, quelles que soient les péripéties dans le présent, un jour viendra. Je vais tâcher de le hâter suivant mes forces. Adieu, Monsieur, adieu, belle et chère France, patrie bien-aimée, qui ne croit pas être encore mûre pour le règne de la justice. Du reste, le monde est ma patrie, tous les hommes sont mes frères.
